En 2005, l’office des publications officielles européennes publiait un livre d’images pour enfant « Mathias et Amadou »[1] qui avait pour objectif d’expliquer à des enfants de dix ans les principes de la coopération au développement. Destiné aux enseignants qui veulent « en savoir plus sur la coopération et participer à la lutte contre la pauvreté », on y croise Mathias, un petit européen qui rêve d’Afrique, de ses animaux et de ses habitants. Dans son rêve, il y part et se lie d’amitié avec Amadou qui lui fait découvrir sa vie quotidienne, les transports, les plantations, l’école, les dispensaires. Mathias explique à ses petits amis Africains qu’il va les aider en collectant des matériels. A son retour à la réalité et à l’école, il n’est plus le même, il porte une chemise africaine et il sait qu’il travaillera dans la coopération. Le livre est introduit par un petit texte du commissaire européen de l’époque. On y voit Louis Michel[2], patelin, qui parle depuis l’intérieur d’un poste de télévision dessiné posé sur une petite table basse, il explique : « ce petit livre raconte une histoire comme j’aimais en raconter à mes deux enfants. Aujourd’hui, ils sont devenus grands[3] et moi je suis chargé de la coopération au développement et de l’aide humanitaire, ces mots peuvent te paraître étranges (…) il est normal que ceux qui sont plus riches aident ceux qui sont plus pauvres, chacun à sa manière. (…) Comme nous, les grands, tu auras vite envie de faire quelque chose ». Bref, de la pure propagande caritative, Hergé et Brel, Tintin au Congo qui tricote des pulls couleur caca d’oie pour reconnaître ses pauvres à soi[4]. Cette niaiserie de la communication de la Commission prêterait simplement à sourire si elle n’était l’illustration presque allégorique du discours compassionnel et caritatif en décalage béant avec les pratiques de la Commission Européenne : des dispensaires, des écoles mais fini les droits économiques et sociaux. Au delà de l’aide au développement, c’est ce décalage entre le discours et le réel qui en fin de course affaiblit le projet politique d’une construction européenne démocratique et solidaire.

Agrandissement : Illustration 1
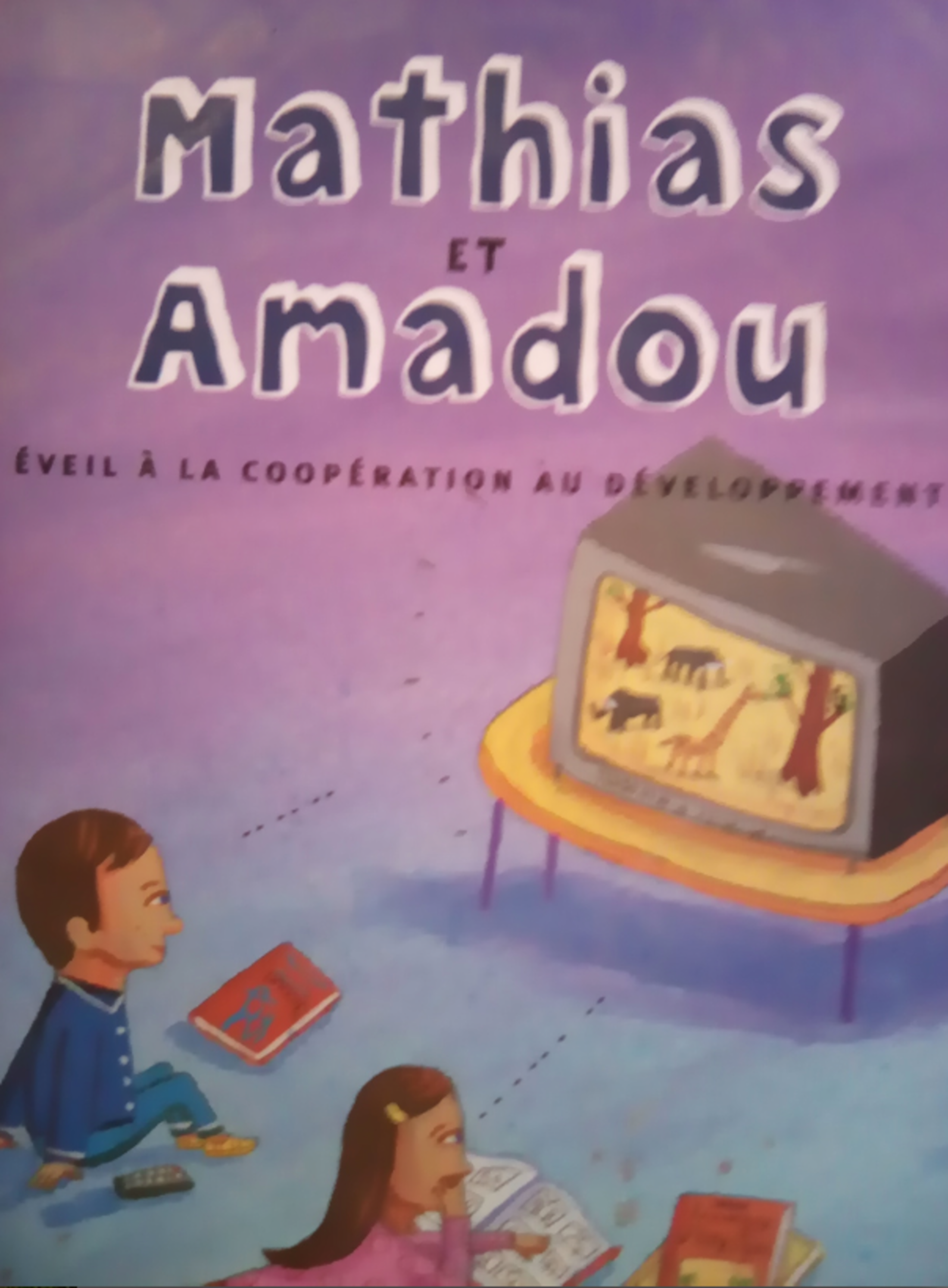
L’Union Européenne est le premier contributeur mondial de l’aide au développement. Elle le fait au nom de ses valeurs démocratiques, de l’Etat de droit et de la défense des droits de l’homme. Il est facile et fréquent d’expliquer également qu’elle continuerait sous une forme moderne une sorte de néocolonialisme des Etats membres qui auraient mutualisé leurs anciennes colonies dans la catégorie des pays ACP[5]. Cette critique politique est classique, elle mérite débat, mais elle reste sur les vieux schémas d’explication de domination impérialiste et surtout elle évacue un peu vite l’analyse des situations concrètes contemporaines, par exemple celle des dispositifs de l’aide qui montrent une bureaucratie néolibérale[6] hors sol qui fonctionne en auto allumage, sans pensée ni contrôle démocratique. En effet les méthodes et moyens de l’aide au développement de l’Union Européenne mis en œuvre parla direction générale de la coopération internationale et du développement de la Commission européenne (DG DEVCO)fonctionnent par l’utilisation systématique de normes, de règles, de procédures, de codes ou de catégorisations, en définitive de formalités principalement issues des logiques de marché et qui envahissent le quotidien des développeurs mais surtout celui des supposés bénéficiaires de l’aide.
Au travers de son principal instrument financier d’aide au développement, le Fonds Européen de Développement (FED), l’Union Européenne consacre des montants financiers considérables aux pays ACP. Le 10e FED (2008 -2013) a été doté de 22,7 milliards d’euros. Le 11e FED (2014 – 2020) s’élèvera à environ 30 milliards d’euros. L’UE apporte son appui financier et technique aux gouvernements des pays ACP dans tous les secteurs : développement rural, santé, environnement, justice, société civile, droits de l ‘homme, transport, pêche, etc. Les lois du marché (transparence, choix du moins disant financier, égalité d’accès aux financements) appliqués à l’aide au développement amènent les prestataires de l’aide à réduire leurs coûts, ce qui n’est pas critiquable en soi, mais comme dans d’autres secteurs économiques, ces économies se font sur la main d’œuvre locale en contournant leurs droits sociaux.
Les délégations de l’Union Européenne dans les pays ACP n’ont pas les ressources humaines suffisantes pour gérer les nombreux projets de développement qu’elles montent dans le cadre du FED. Dans beaucoup de cas ces projets sont en régie indirecte, c’est à dire que l’Union Européenne est le financeur et la délégation de l’UE dans le pays concerné demande alors, dans le cadre d’une convention de financement, à l’administration locale (le ministère de l’économie en général) d’être l’ordonnateur (celui qui engage les dépenses) de la subvention européenne correspondante au projet : en moyenne cinq à quinze millions d’euros par projet. En général, une structure administrative ad hoc, financée également par l’Union Européenne, est créée au sein de l’administration du pays concerné pour « appuyer » l’ordonnateur national sur tous les projets en cours. C’est cette structure administrative qui a la charge de recruter l’expertise nécessaire à la mise en œuvre d’un projet. Elle le fait par appel d’offre international. Des cabinets spécialisés, européens, qui font de l’achat pour revente d’experts internationaux, présentent une offre technique et financière, dans le cadre d’un contrat commercial : des prestations contre factures. Ces cabinets gèreront, pendant la durée du projet (3 à 5 ans) pour le compte de l’administration, les fonds mis à disposition si le contrat est régie en indirecte privée, sinon ils appuieront techniquement le ministère technique concerné pour la mise en œuvre de la convention, si le contrat est en régie indirecte publique. La pratique montre que ce dispositif ne protège pas de la corruption et que certains cabinets européens en lice dans les appels d’offre internationaux ont mis en place dans chaque pays des systèmes d’accompagnement des fonctionnaires locaux pour l’attribution des marchés.
Sur le 9e FED, que ce soit en régie publique ou privée, les salariés locaux en appui à l’équipe de gestion du projet (secrétaires, administratifs, chauffeurs, gardiens) étaient recrutés sur la régie, c’est à dire sur la subvention et leurs contrats devaient obéir aux règles du code du travail local (grilles de salaire de la fonction publique, sécurité sociale, contrat de travail etc.). Les droits économiques et sociaux des salariés des projets étaient donc assurés. Seuls les experts internationaux étaient payés par le cabinet international, adjudicataire de l’offre, qui facture l’ordonnateur national en prenant une marge commerciale sur les honoraires qu’il verse à ses experts. La gestion des salariés locaux et le droit du travail avaient un coût (cotisations, indemnités conventionnelles, indemnité de rupture etc.) qu’il fallait intégrer dans le budget de fonctionnement du projet payé sur la subvention, mais surtout c’était une contrainte administrative.
Pour simplifier tout cela, la DEVCO, dans un souci de rationalisation bureaucratique décida pour le 10e FED que le coût du personnel d’appui serait transféré de la régie de la convention vers le cabinet qui gèrerait lui même cette question en l’intégrant dans ses coûts. L’idiome européen de la DEVCO parle maintenant d’experts internationaux « habillés » à livrer par le cabinet, c’est à dire que le cabinet met en place une unité de gestion du projet complète : experts, équipements bureautique et informatique, bureaux, personnel d’appui, véhicule. Cette simplification administrative a une conséquence, les cabinets ne paient plus de cotisations et se sentent dégagés du droit du travail local. En effet, les cabinets à quelques exceptions près ne sont pas installés dans le pays du projet, ils n’ont pas la personnalité juridique et ne peuvent donc être employeurs. Alors que ces personnels sont astreints à des horaires et qu’ils dépendent hiérarchiquement des experts internationaux, caractéristiques suffisantes du contrat de travail, le cabinet leur fait signer des contrats de prestation de service. Le personnel local (secrétaire, chauffeur, gardien) facture le cabinet tous les mois et remplit des feuilles de temps, à sa charge de se débrouiller avec les obligations sociales. Les contrats de service permettent de rompre le contrat à tout moment sans préavis, dans certains cas il est expressément précisé qu’en cas d’accident pendant le temps de service, la responsabilité du cabinet est dégagée. Le paiement de congés est laissé au bon vouloir du cabinet. La Commission Européenne réintroduit en douce en Afrique, comme au bon temps des colonies, le paiement à la tâche et l’individualisation des rapports de travail en dehors de tout droit collectif.

Agrandissement : Illustration 2
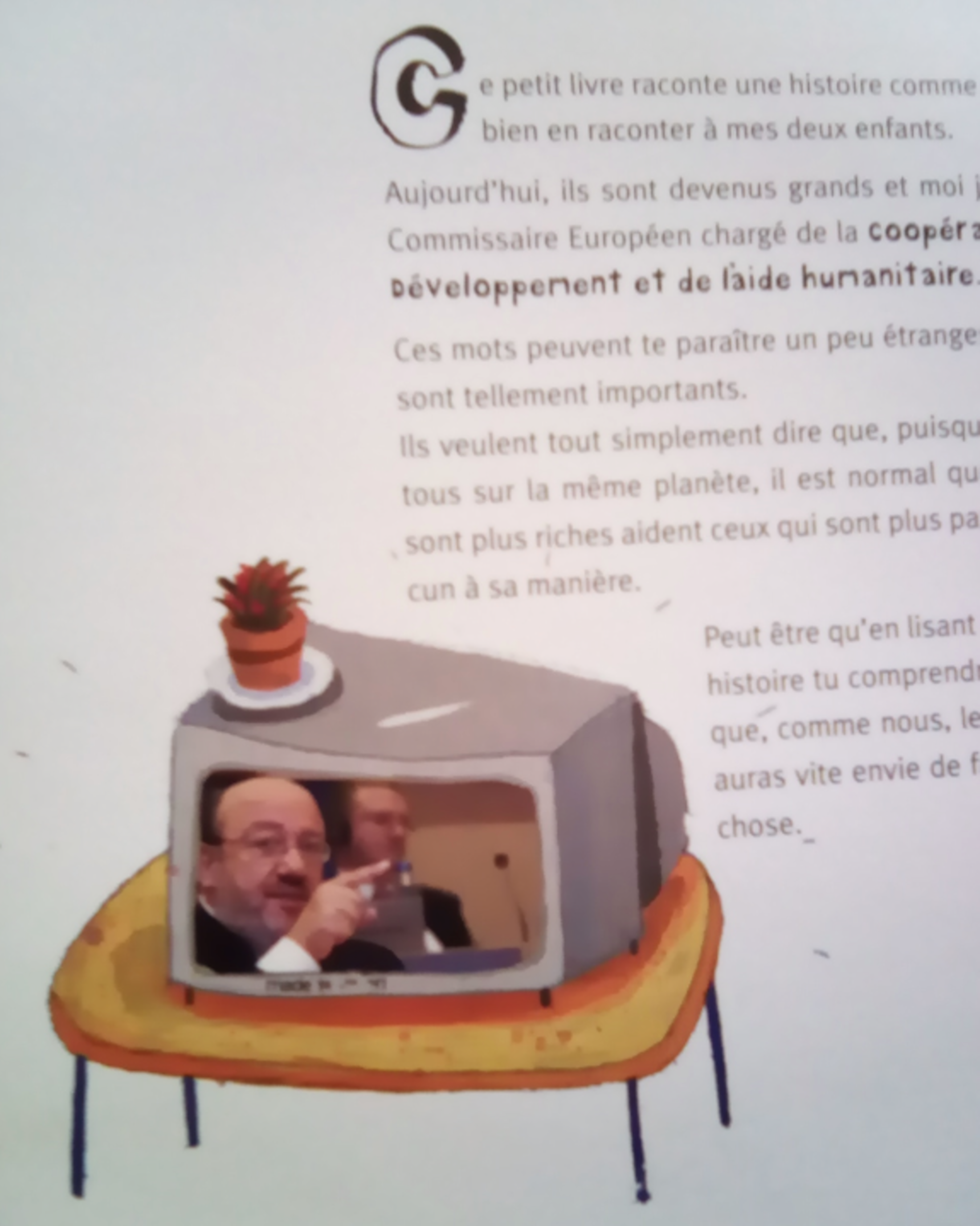
Cet anéantissement des droits sociaux de plusieurs centaines de travailleurs en Afrique, s’est fait sans bruit, à partir d’une simple injonction bureaucratique décidée dans un bureau de la rue de la Loi, mal nommée, à Bruxelles. Personne n’a bougé. Dans le contexte de l’emploi en Afrique, les salariés locaux se taisent. Aucun cabinet, parmi ceux qui défendent encore une certaine éthique, ne bougera, ils prendraient le risque en cas de contentieux avec la Commission européenne de ne plus accéder aux appels d’offre. Les syndicats de travailleurs dans les pays concernés ne se mobiliseront pas pour quelques dizaines de travailleurs, finalement mieux nantis financièrement que le commun des salariés de la fonction publique locale.
[1] Mathias et Amadou : Eveil à la coopération internationale au développement. Commission Européenne, Direction Générale de le Communication, Unité information et Communication. Bruxelles 2005. Illustrations Philippe de Kemmeter. Textes Ariane Lefort, Valérie Michaux.
[2] Louis Michel. Homme politique Belge, ministre des affaires étrangères de 1999 à 2004. Commissaire européen à la coopération internationale et à l’action humanitaire de 2004 à 2008.
[3] Un des fils de Louis Michel, Charles est maintenant premier ministre de Belgique
[4] Jacques Brel : Les dames patronnesses.
[5] Pays Afrique Caraïbe Pacifique. Les 80 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signataires des accords de Cotonou, fixant les modalités de l’aide de l’Union Européenne.
[6] Lire Béatrice Hibou : La bureaucratisation néo libérale. La Découverte 2013, collection Recherches.



