François Purseigle et Bertrand Hervieu, Une agriculture sans agriculteurs. La révolution indicible, Presses de SciencesPo, 2022.
Il y a soixante ans, des chercheurs nous annonçaient une France sans paysans, « l’inévitable réduction de la population agricole » et la généralisation de « l’entreprise agricole à forme capitaliste classique » conséquence de la disparition de la petite exploitation1. Et dix ans plus tôt, Henri Mendras soulignait que la modernisation de l’agriculture remettait « en question les fondements de la société paysanne traditionnelle, la personnalité sociale des paysans et leur vision du monde. Il ne s’agit pas d’un simple problème d’investissement ou d’éducation, mais du remplacement d’une civilisation par une autre »2.
Aujourd'hui, deux sociologues, François Purseigle et Bertrand Hervieu, nous parlent d'Une Agriculture sans agriculteurs dans leur dernier livre publié par les Presses de SciencesPo. Avouons-le, le titre est intrigant, mais il traduit bien ce que la révolution agricole actuelle fait à notre perception d’un monde appelé jadis paysan, qui a toujours été diversifié selon les territoires et les productions.
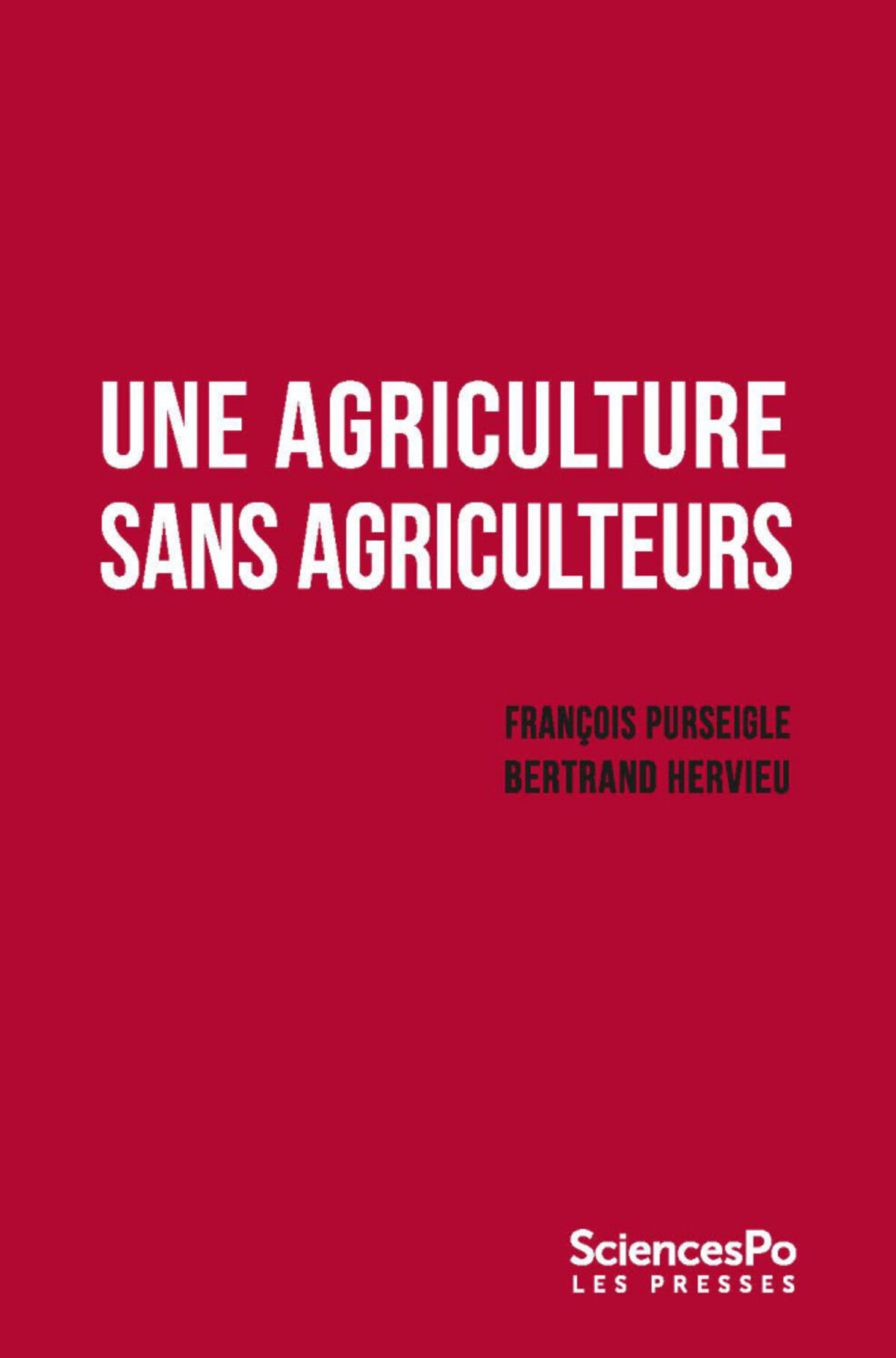
Agrandissement : Illustration 1
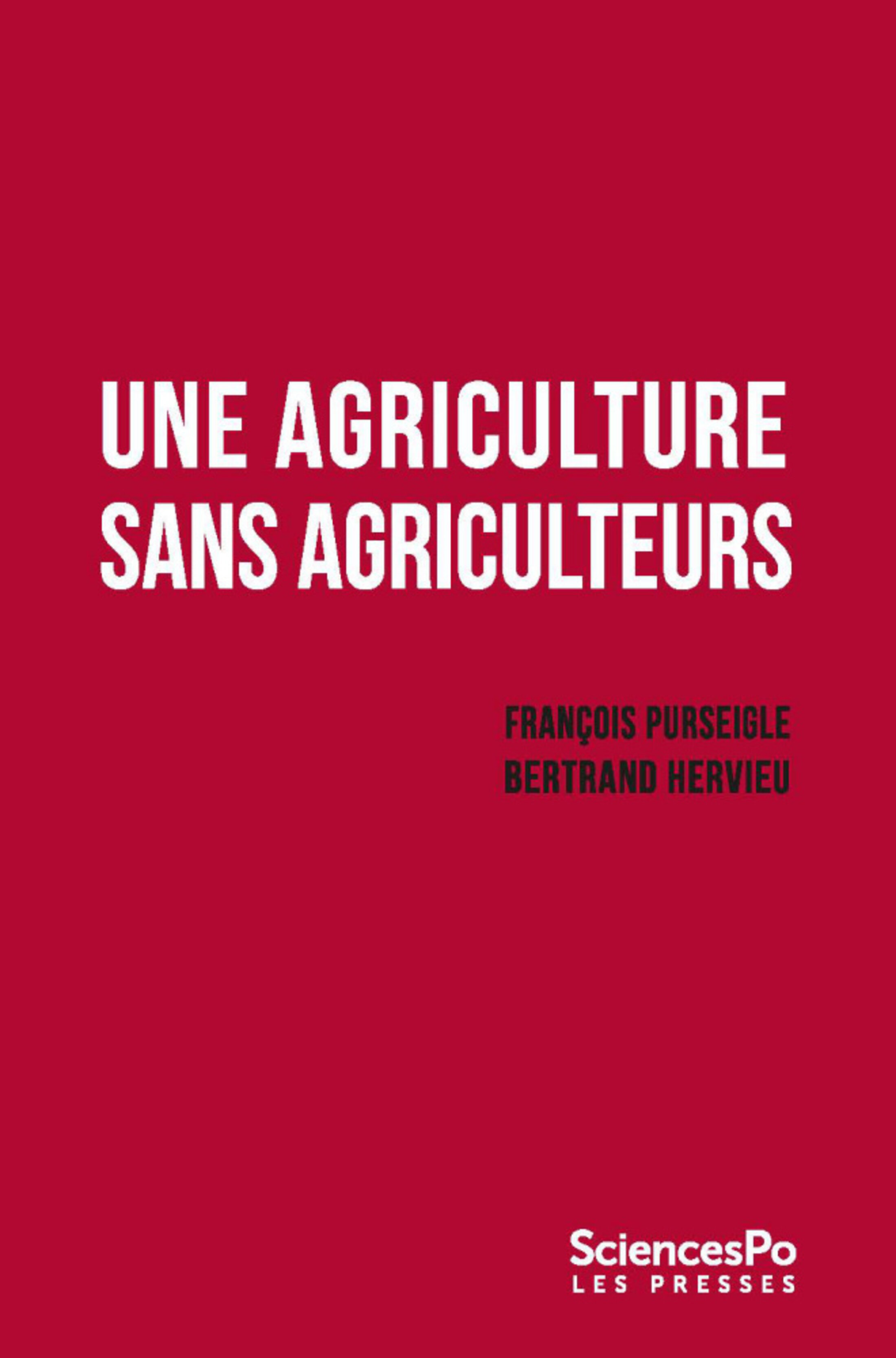
L’intérêt que la société porte aux questions agricoles, des pesticides aux mégabassines, est inversement proportionnel au nombre d’agriculteurs que compte encore le pays.
L’agriculteur-type est un homme vieillissant qui se fait rare, célibataire ou dont l’épouse gagne son pain à l’extérieur, travaillant seul ou entouré de salariés, et, pour une part non négligeable, tire le diable par la queue.
Avec les évolutions technologiques, le travail est devenu plus technique (d’où le recours à la sous-traitance), les exploitations se sont agrandies (par rachat des victimes du système), tout comme se sont accrus l’endettement et la dépendance aux aides publiques.
On compte autant de moyennes et grandes exploitations que de micro et petites fermes. De cette « pluralisation des modèles d’exploitation » retenons l’agriculture de firme qui, avec ses mille vaches, ses milliers de salariés et l’étendue de ses activités, est devenue un acteur central de l’agriculture productiviste nationale ; et le profil de l’actuel président de la FNSEA est à son image.
Le monde rural n’est plus un monde paysan où règnent le coq matinal et la chasse du dimanche, d’où des problèmes de coexistence avec des personnes « porteuses de visions différentes et divergentes de la gestion de ces espaces ».
Le monde, ou plutôt les mondes agricoles sont en crise. Crise identitaire profonde, crise de vocations et crise de perspectives. Les auteurs l’affirment avec raison : « les agriculteurs se trouvent en panne de projet collectif », ce qu’illustre la fragmentation du syndicalisme paysan3.
Paysan ? Est-ce d’ailleurs le bon terme ?
Pour comprendre le monde agricole qui advient, Hervieu et Purseigle, très pragmatiques, écrivent qu’il « faudra parvenir à nommer précisément les producteurs agricoles dans leur diversité et à considérer leurs capacités plurielles à prendre part à cette histoire »4. Mais une « coexistence pacifique » entre ces différents modèles est-elle possible, voire même souhaitable, à la fois pour les écosystèmes, les agriculteurs et les consommateurs ?
Notes
1 Servolin, Gervais, Weil, Une France sans paysans, Seuil, 1965.
2 Henri Mendras, Les paysans et la modernisation de l’agriculture, CNRS, Paris, 1958.
3 Historiquement, cette fragmentation a un demi-siècle avec l’émergence notamment d’une gauche paysanne (les paysans-travailleurs). Aujourd’hui la droitière Coordination rurale est aussi forte électoralement que la Confédération paysanne.
4 Je vous renvoie à la lecture des Cahiers français n°431 (01/2023, L’agriculture à l’heure des choix).



