David Graeber, Valeur, politique et démocratie aux Etats-Unis, PUL, 2025
Véronique Dutraive (sldd), Penser et agir avec David Graeber. Construire des ponts entre les sciences sociales, PUL, 2025.
Le 2 septembre 2020, l’anthropologue et activiste américain David Graeber décédait brutalement, à l’âge de 59 ans. Les Presses universitaires de Lyon lui rendent hommage avec deux livres très dissemblables.
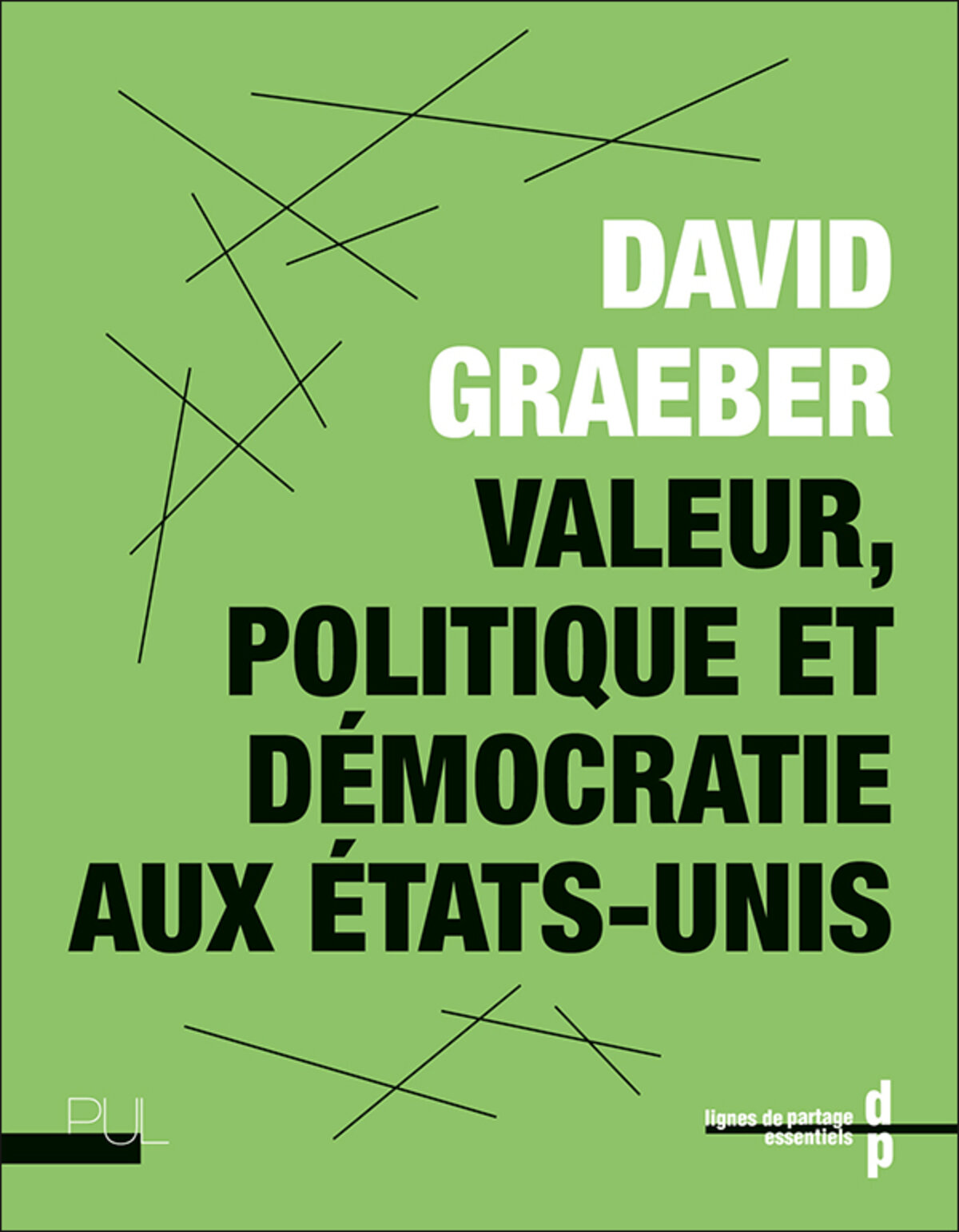
Agrandissement : Illustration 1
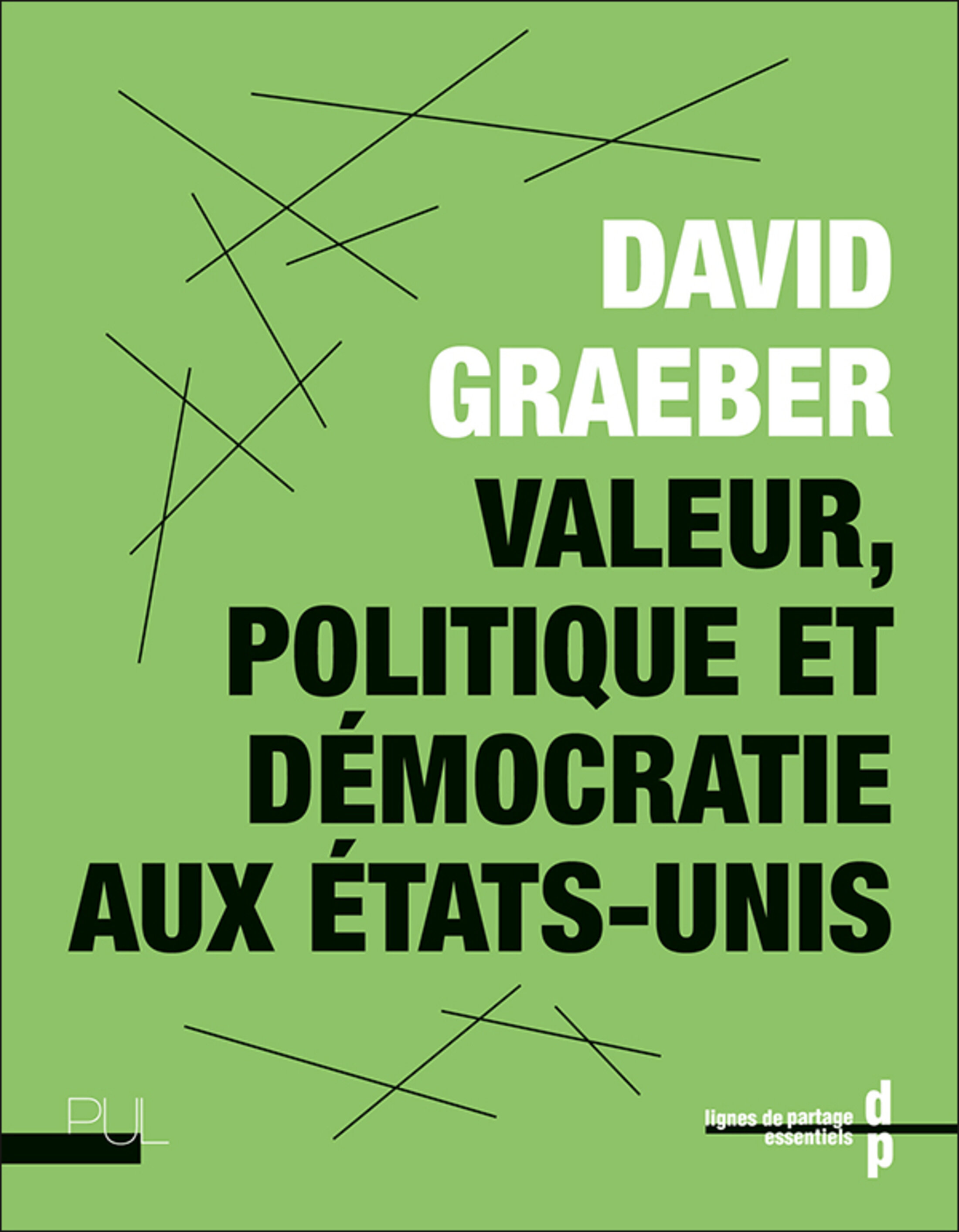
Le premier est une courte brochure comprenant un texte inédit de Graeber, Valeur, politique et démocratie aux Etats-Unis, texte sorti initialement en 2011 et dans lequel il revenait sur l’élection de Georges Bush en 2004, et sur un paradoxe apparent : une fraction des classes populaires avait voté pour un fils à papa dont le programme ne pouvait rien lui apporter de positif. Il n’était évidemment pas le seul à se poser la question1, mais son approche fut très originale, et le demeure. Pour comprendre ce comportement électoral, Graeber nous propose d’enrichir l’« approche purement politico-économique » et d’interroger le fameux couple égoïsme/altruisme et la question classique en sociologie du don et du désintéressement2. Il souligne que la société américaine, société de plus en plus castée, est plutôt « fondée sur une lutte pour l’accès au droit de se comporter de manière altruiste » : « Si vous n’êtes dotés d’aucune richesse (…) ni ne possédez un certain capital culturel (…) ce qu’on vous refuse, au bout du compte, c’est la noblesse » ; « être noble, c’est être généreux, élevé moralement, altruiste »3. Or, pour Graeber, « les individus aspirent tous tendanciellement à d’autres valeurs qu’aux valeurs mercantiles. »
Le second ouvrage, coordonné par l’économiste Véronique Dutraive, s’intitule Penser et agir avec David Graeber. Construire des ponts entre les sciences sociales. Auteur prolifique4, Graeber avait le goût de la transdisciplinarité, et ses travaux ont immanquablement stimulé les réflexions de chercheurs venant d’horizons différents. Ils sont une vingtaine à avoir contribué à ce livre, et ils l’ont fait avec un regard critique et non hagiographique.
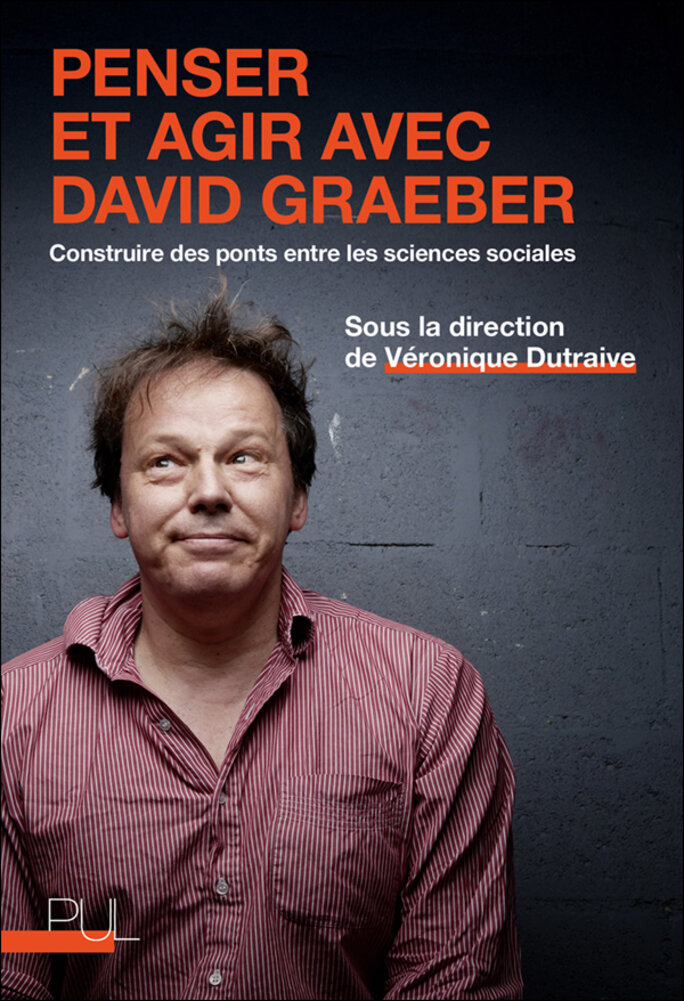
Agrandissement : Illustration 2
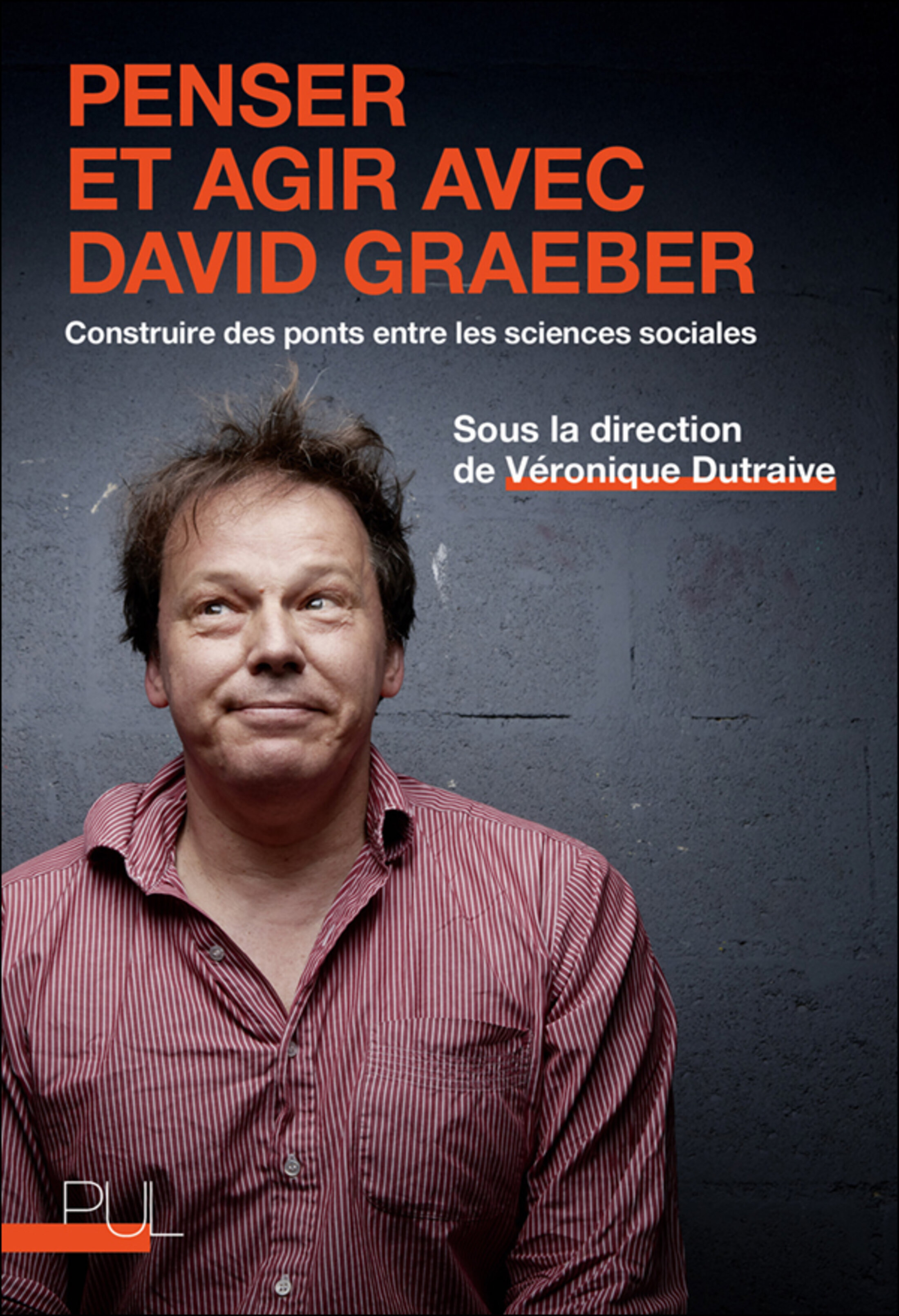
En 300 pages, au contenu souvent ardu, on y évoque l’histoire de la dette et des formes multiples qu’elle a prises à travers les siècles, l’apparition de la monnaie et celle du capitalisme, la place prise par le travail salarié dans nos vies quotidiennes ou encore les rapports de pouvoir au sein des sociétés humaines, problématique qui parcourt toute son œuvre. Libertaire, David Graeber a toujours porté une attention particulière à cette « faculté d’expérimentation sociale et d’auto-création » des êtres sociaux et moraux que nous sommes. C’est pourquoi il comptait sur les mouvements sociaux pour stimuler les imaginaires radicaux. Optimiste, David Graeber était persuadé que « dès qu’il y a suffisamment de personnes libérées des chaines qui entravent l’imagination collective, on sait que même nos opinions les plus profondément ancrées sur ce qui est ou non politiquement possible s’effondrent du jour au lendemain. »5
[version audio disponible]
1 Je pense par exemple aux écrits de Thomas Frank (Pourquoi les pauvres votent à droite ?, Agone, 2013 [initialement 2004]), Chris Hedges (Les fascistes américains. La droite chrétienne à l’assaut des Etats-Unis, Lux, 2021 [initialement 2007), Nicole Morgan (Haine froide. A quoi pense la droite américaine ?, Seuil, 2012) ou Sylvie Laurent (Poor white trash. La pauvreté odieuse du Blanc américain, PUPS, 2011).
2 Sur cette question, il trouve Pierre Bourdieu trop économiciste. Lire de Pierre Bourdieu, L’intérêt au désintéressement. Cours au Collège de France 1987-1989, Seuil, 2022.
3 Sur la philanthropie des élites américaines, je vous renvoie au livre de Nicolas Guilhot, Financiers, philanthropes. Vocations éthiques et reproduction du capital à Wall Street depuis 1970 (Raisons d’agir, 2004). Je vous renvoie également à la lecture du livre de Christopher Lasch La révolte des élites et la trahison de la démocratie (Flammarion, 2007).
4 Parmi tous ses écrits, citons Pour une anthropologie anarchiste (Lux, 2004), Dette, cinq mille ans d’histoire (Les liens qui libèrent, 2011), Bureaucratie (Les liens qui libèrent, 2015), Bullshit jobs (Les liens qui libèrent, 2018), Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité (Les liens qui libèrent, 2021).
5 David Graeber, Comme si nous étions déjà libres, Lux, 2014.



