Alternatives sud, Obsolètes, les réformes agraires ?, Centre tricontinental/Syllepse, 2025.
Longtemps, elle fut l’étendard brandi par les mouvements émancipateurs. Elle était promesse de justice sociale et de développement économique. Puis le néolibéralisme s’en est saisi pour l’accommoder à sa sauce… L’excellente revue Alternatives sud, qui donne la parole à des chercheurs et militants de ce que l’on appelait jadis le tiers-monde, pose la question : Obsolètes, les réformes agraires ? Pour se faire, elle nous emmène en Afrique, en Indonésie et en Amérique latine...
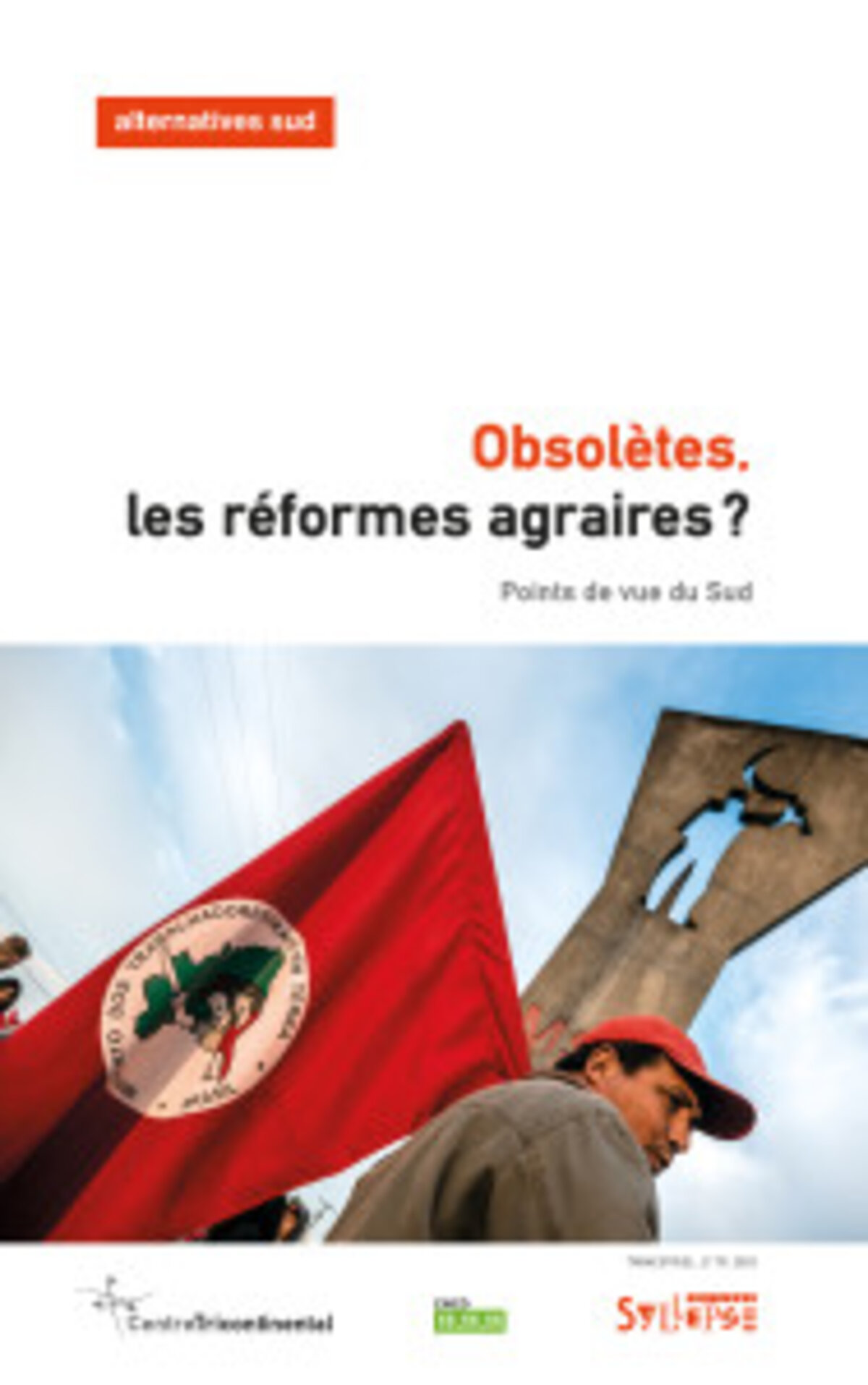
Jadis donc, c’est pour elle que les peuples se sont révoltés, et quand ce n’était pas en son nom, elle n’était jamais très loin. Devenir propriétaire revenait à sécuriser, en l’absence de filets sociaux de protection, un quotidien marqué par l’incertitude. Portée par des mouvements populaires, des gouvernements, des partis révolutionnaires et d’autres qui l’étaient beaucoup moins, la revendication d’un accès à la terre pour la masse des gueux fut centrale jusqu’aux années 1980 et ce, sur tout le globe. Puis sa dimension « idéologique » fut mise au rencard, et la Banque mondiale pesa de tout son poids pour que les Etats privilégient désormais une « approche technicienne et dépolitisée. (…) Il ne (s’agissait) plus de repenser les structures agraires, mais d’organiser les marchés fonciers et de garantir leur bon fonctionnement ». Pas question de s’attaquer aux grands propriétaires terriens, la conflictualité sociale devait céder devant la promotion des « transactions libres et volontaires ».
Et ce qui devait arriver arriva. Les élites rurales ont profité à plein de la nouvelle donne grâce à leurs relais politiques et économiques, au détriment des petits propriétaires, condamnés à s’endetter pour acquérir de nouvelles terres, pendant que les plus fragiles économiquement étaient condamnés à céder leurs propriétés contre monnaie sonnante et trébuchante.
Mais que faire de ces terres ? De l’agriculture vivrière, respectueuse des écosystèmes et destinée au marché local ? Evidemment pas. Selon les endroits, ces terres ont servi ou servent à l’agriculture industrielle, aux agro-carburants, à la monoculture d’exportation, avec toutes leurs conséquences sur la qualité des sols. Cet accaparement des terres a servi également à développer des projets miniers dont on connaît les multiples impacts sur les territoires impactés. Enfin, une partie de ces acquisitions sont des projets de compensation carbone destinés à lutter contre le réchauffement climatique. Le business, c’est du business, même teinté en vert1…
Ces réformes agraires ne règlent en rien le problème de la misère rurale : elles fragilisent et sont des éléments de discorde au sein des communautés paysannes qui, rappelons-le, ne furent jamais des espaces sans conflit ; elles accentuent les conflits entre sédentaires et nomades ou encore les conflits d’usage. Rappelons-le : la terre ne peut être vue seulement comme espace productif ou « simple ressource économique » : elle est « au coeur des identités et des cultures », ici comme ailleurs.
Tout cela ne sous-entend pas que les anciennes réformes agraires n’avaient pas leurs défauts. Pour le chercheur et militant brésilien Joao Pedro Stédile, la « réforme agraire populaire », qu’il appelle de ses vœux et qui repose sur l’agriculture familiale, doit mettre au centre de son action non plus comme jadis le travail du paysan, mais « la production de nourriture pour l’ensemble de la société » : « La réforme agraire populaire c’est pas seulement une réforme paysanne. Il ne s’agit pas de seulement de résoudre le problème de la pauvreté des sans-terre. C’est une réforme agraire qui pense la société. »
[Version audio disponible]
1Je vous renvoie à la lecture édifiante d’un autre numéro récent d’Alternatives sud : Business vert en pays pauvres, Centre tricontinental/Syllepse, 2025.



