Jacques Tupinier, Main d’oeuvre au Cameroun, Classiques Garnier, 2024
On connaît peu de choses de Jacques Tupinier. Ce Parisien né en 1897, devenu inspecteur des colonies trente ans plus tard, est au coeur de « Main-d’oeuvre au Cameroun », livre singulier présenté par l’historien du droit Jean-Pierre Le Crom et publié par Classiques Garnier. Singulier car ce livre compile trois rapports consacrés à la question du travail et de la mise au travail des autochtones dans ce territoire confié en partie à la France par la Société des nations.
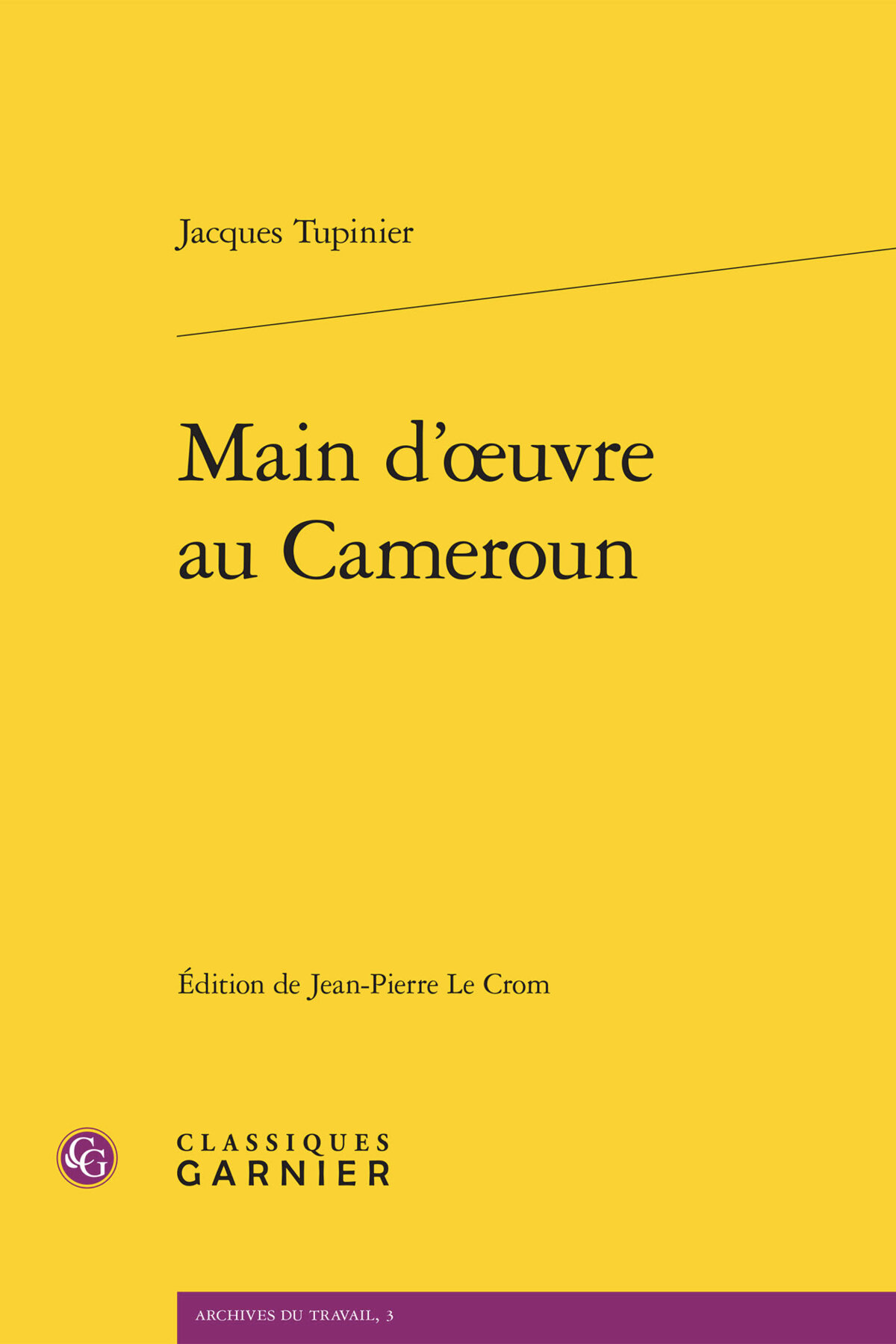
Agrandissement : Illustration 1

Tupinier pose ses valises à Douala en décembre 1938 et une poignée de mois plus tard, il rend compte de la façon dont les Camerounais travaillent ou sont mis, ou pas, au travail par les colons.
Une phrase issue de la conclusion résume à elle seule la pensée de Jacques Tupinier : « L’administration doit remplir son rôle d’éducatrice et de tutrice vis-à-vis des autochtones en les persuadant qu’ils ne pourront s’élever à une condition meilleure que par un labeur assidu, mais aussi en les protégeant, le cas échéant, contre les abus que les employeurs seraient tentés de commettre à leur égard. »
Educatrice et tutrice. Tout au long de ces rapports, Tupinier défend la mission civilisatrice de la France et tance la cupidité des entrepreneurs coloniaux qui les empêche de « s’attacher les indigènes d’une façon durable » ; des indigènes qui peuvent venir de loin puisque les entreprises réclamant des bras étant installées dans des zones peu peuplées, il faut faire venir la main-d’oeuvre d’autres régions.
Salaires indécents, parfois non versés, absence de contrats de travail, conditions de travail déplorables, travail forcé, logements collectifs insalubres, rations alimentaires insuffisantes… rien n’est fait pour transformer le « noir indolent » en salarié conscient de ses droits et de ses devoirs, et comme « aucune tradition n’est jamais venue donner aux autochtones l’habitude d’un travail assidu et régulier »1, la productivité est très faible et les désertions, nombreuses ! Recrutés souvent de force, une partie de la main-d’oeuvre s’enfuit à la première occasion, et celle qui reste travaille le moins possible...
Tupinier en est persuadé : si le droit du travail était respecté, le noir abandonnerait sa « nonchalance coutumière », travaillerait avec l’ardeur qui sied et il serait alors inutile d’aller recruter dans d’autres régions des travailleurs. Tout le monde serait gagnant, notamment le salarié qui pourrait s’élever dans l’échelle sociale grâce à son labeur. Mais pas trop haut tout de même ! Tupinier se réjouit que le gouvernement ait mis des freins au développement du « capitalisme indigène ». S’il dit oui au projet gouvernemental de « colonisation indigène », il s’inquiète que les paysans camerounais accédant aux bonnes terres s’enrichissent rapidement, se transforment en rentiers employeurs de main-d’oeuvre, retrouvant ainsi le chemin de la paresse.
Pour Jean-Pierre Le Crom, l’approche de Jacques Tupinier est fidèle à la « doxa coloniale républicaine » voire socialiste, qui cherche à « concilier l’exploitation économique et sociale (…) avec une approche humaniste de la colonisation »2. Comme l’a dit Léon Blum, il s’agit d’« extraire du fait colonial le maximum de justice sociale et de possibilité humaine », ce qui n’exclut nullement une approche paternaliste et culturaliste des rapports sociaux.
[Version audio disponible]
1 Tupinier et le gouverneur général (qui annote régulièrement le rapport) se posent d’ailleurs en défenseurs de la femme. Ce dernier écrit : « Il faut mettre les hommes au travail et alléger la lourde tâche des femmes qui – sur tous les plans - sont à protéger et à élever. »
2 Cf. Claude Liauzu, Histoire de l’anticolonialisme en France du 16e siècle à nos jours, Pluriel, 2010 ; Gilles Manceron, Marianne et les colonies. Une introduction à l’histoire coloniale de la France, La Découverte, 2003.



