Martin Buber, Utopie et socialisme, L’Echappée, 2025.
Né à Vienne en 1878 et mort 87 ans plus tard à Jerusalem, Martin Buber fut une des figures importantes et atypiques du monde intellectuel juif contemporain. Michael Löwy a écrit qu’il incarnait une « religiosité romantique et mystique, imprégnée de critique sociale et de nostalgie communautaire. »1 La réédition par les Editions de l’Echappée de son livre « Utopie et socialisme » en porte témoignage ; il en est de même avec « Une terre et deux peuples »2, ensemble de textes sur la Palestine dans lesquels Martin Buber défend un sionisme singulier, « moral et spirituel » disait-il, pacifiste, anti-nationaliste, favorable à une alliance entre Juifs et Arabes, et à un Etat binational reposant sur des communautés de travail oeuvrant pour le bien commun3.
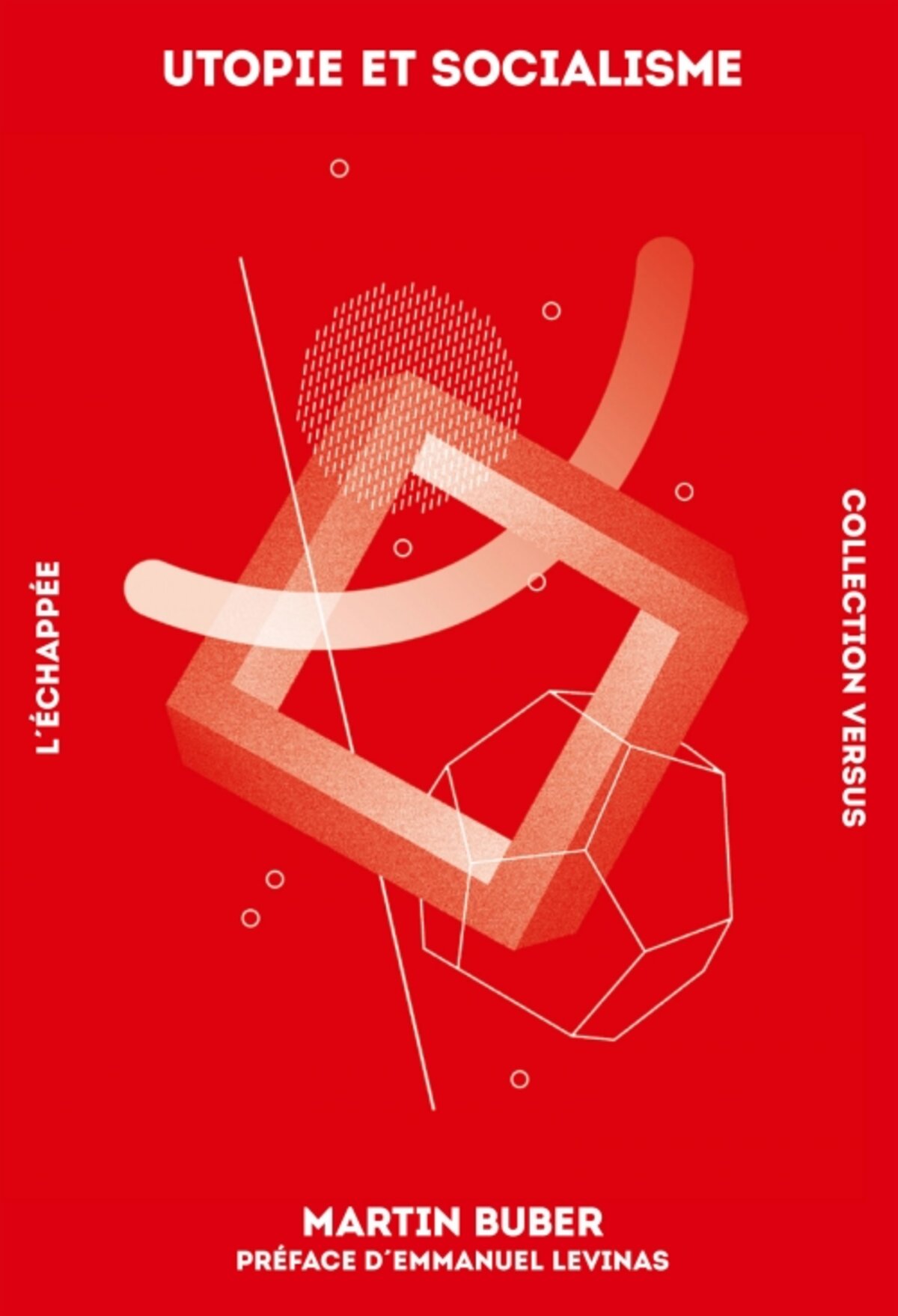
Agrandissement : Illustration 1
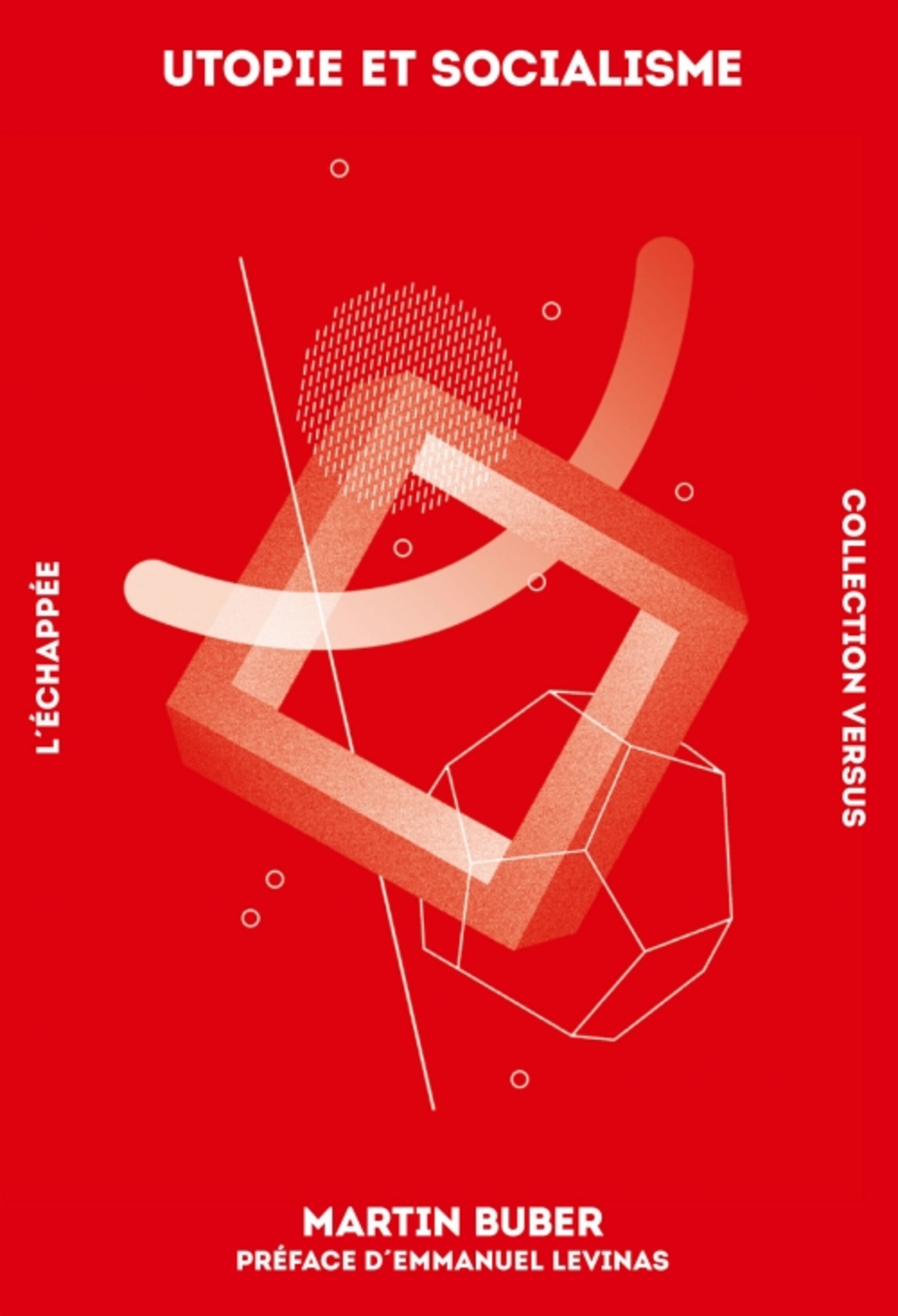
Dans « Utopie et socialisme » publié initialement en 1947, Martin Buber nous ramène au 19 siècle où le socialisme se construit dans le dialogue, mais plus souvent dans l’affrontement. Avant que ne règne le socialisme scientifique porté par le marxisme et sa critique radicale du monde industriel capitaliste qui se construit sous ses yeux, il y eut un socialisme utopique, marqué par les mentalités pré-industrielles, l’idéal communautaire, la valorisation de l’expérimentation sociale. « Est tenu pour utopique tout socialisme volontariste » écrit ainsi Buber.
Ce qui intéresse Martin Buber dans le socialisme utopique, c’est sa défense des capacités créatrices des hommes et femmes, des producteurs. Qu’ils aient pour noms Saint-Simon et Fourier, Robert Owen et Pierre-Joseph Proudhon, de Pierre Kropotkine et Gustav Landauer, ils veulent construire le socialisme par en bas, ici et maintenant. Il en est ainsi du mouvement coopératif où, écrit Buber, « l’homme réel se rapproche de l’homme idéal (…) au moment où est exigé de lui l’accomplissement de tâches dont il n’était ou ne se croyait pas jusqu’alors à la hauteur. »
Pour l’anarchiste Landauer, grand ami de Buber, « L’État est une relation, un rapport entre les hommes (…). On le détruit en contractant d’autres rapports. ». Car l’ennemi, c’est l’État. Cet Etat qui, en terres capitalistes comme en URSS stalinienne, a atomisé, englouti la société : le capitalisme ne veut avoir à faire qu’à des individus isolés les uns des autres ; le stalinisme les a absorbés dans la grande machinerie autoritaire et bureaucratique. C’est pourquoi Martin Buber s’oppose à ce qu’il nomme le principe politique qui ne peut que réduire la spontanéité sociale : « les liens autonomes deviennent sans signification, les relations personnelles se dessèchent, même l’esprit devient fonctionnaire ».
Pour Buber, c’est avec Marx « que commence le mouvement d’un socialisme où le principe social n’existe plus que comme fin ultime [la société sans classe ni Etat] et non pas à l’intérieur même du projet réel et pratique. » Cette assertion est à relativiser : outre que Marx a toujours porté un regard intéressé sur les pratiques sociales ouvrières, il a consacré les dernières années de sa vie à étudier les modes d’organisations communautaires pré-capitalistes4.
Pour Buber, le socialisme ne peut être qu’éthique. Et je pense qu’il aurait souscrit à ces mots de Maximilien Rubel, fin connaisseur de l’oeuvre de Marx : « Le socialisme n’est une nécessité historique que dans la mesure où il est pensé et voulu comme nécessité éthique (…). Le socialisme est conscience de l’utopie ou il n’est rien. »5
[Version audio disponible]
1Michael Löwy, Rédemption et utopie. Le judaïsme libertaire en Europe centrale, PUF, 1988, p. 63.
2Martin Buber, Paul Mendès-Flohr, Une terre et deux peuples. La question judéo-arabe, Lieu commun, 1983. Je ne crois pas qu’il ait été réédité depuis.
3La pensée de Buber fut évidemment évolutive et mon essai de synthèse de ses positions sur un sujet aussi sensible ne peut être que très réductrice.
4Kolja Lindner, Le dernier Marx, L’asymétrie, 2019. Ces brouillons de Marx étaient inconnus de Buber.
5Maximilien Ruberl, Révolution et socialisme. Pages de Karl Marx pour éthique socialiste, 1970, p. 13.



