CIRA, Refuser de parvenir, Nada Editions, 2024.
Il y a près d’une décennie, les éditions Nada publiaient un ensemble de textes réuni sous le titre de Refuser de parvenir. Idées et pratiques. Elles nous proposent aujourd’hui, judicieusement, la réédition de la partie historique et théorique de ce travail. Judicieux ? Oui, puisqu’il ne vous aura pas échappé que, depuis une poignée d’années, des jeunes à fort capital culturel et scolaire, et souvent issus des classes moyennes et supérieures, ont décidé de « bifurquer », d’abandonner leurs études et leurs promesses de postes à responsabilité avec le salaire qui va avec, pour s’investir dans des activités ayant à leurs yeux « du sens ». Certains salueront ce choix courageux, d’autres se gausseront de cette possible passade pour la radicalité qui leur rappellera peut-être la trajectoire de certains soixante-huitards…
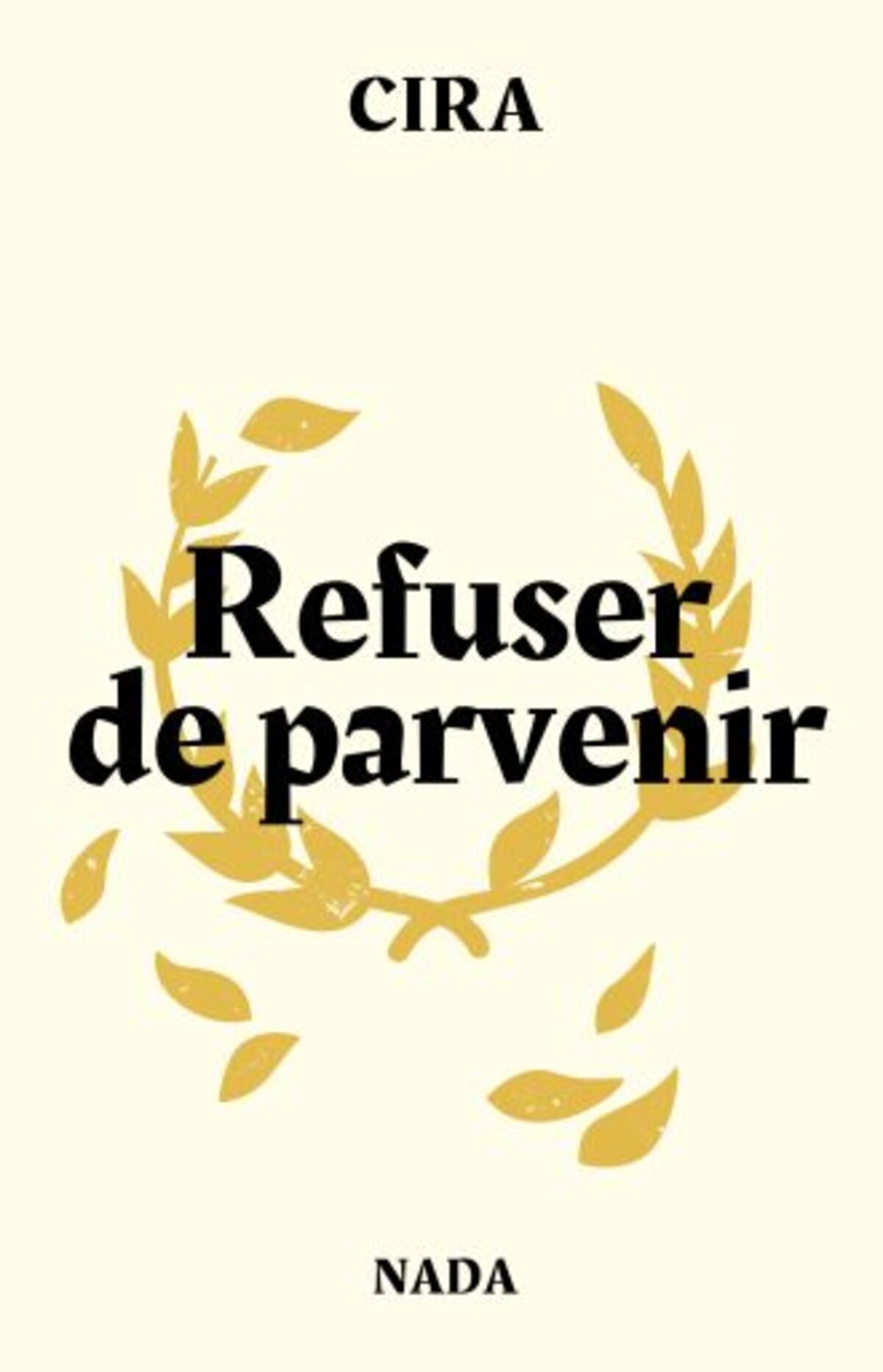
L’ouvrage s’ouvre sur un chapitre consacré à Albert Thierry, fils d’ouvrier maçon, brillant étudiant qui, par conviction, a choisi de rester un humble instituteur ; un instituteur qui déteste les programmes, l’émulation, la discipline, qui a conscience que la défiance des élèves est une défiance de classe ; un instituteur qui veut repenser l’éducation en transformant le travail scolaire.
Nous sommes avant 1914, Albert Thierry a lu Proudhon, Sorel, Pelloutier, Tolstoï, et il est convaincu que s’extraire de sa condition sociale ne peut qu’entraîner la trahison, le reniement, les compromis : « Il est impossible à un véritable révolutionnaire de parvenir à quoi que ce soit, dans la société telle qu’elle est » écrit-il ; plus pondéré, le célèbre historien Jules Michelet, fils de typographe, avait souligné que la difficulté « n’est pas de monter, mais, en montant, de rester soi. »
Le refus de parvenir est donc un choix éthique qu’on ne saurait réduire à sa dimension ascétique et sacrificielle : par amour de la classe ouvrière, je renonce à faire carrière, je dénonce la méritocratie républicaine et ses distinctions, et je me fais serviteur désintéressé du prolétariat. L’intellectuel doit « aller dans le peuple », comme le clamait Bakounine en son temps, mais pas pour s’en faire le tuteur. Le refus de parvenir est porté par la conviction que le prolétariat peut s’émanciper en prenant conscience de son malheur, et c’était l’une des fonctions dévolues aux bourses du travail d’alors qui s’efforçaient de « mettre à la portée des ouvriers toutes les connaissances du temps présent dans tous les domaines ». Il est aussi un « moyen d’entretenir la culture de classe » au moment où le syndicalisme, passé sa phase révolutionnaire, s’institutionnalise et se fonctionnarise… tout comme le socialisme.
Un siècle a passé. La posture ouvriériste n’est plus tenable à l’heure de la massification scolaire et de la transformation continue des modèles productifs, même si l’université recrache chaque année des milliers de diplômés dont la machine capitaliste n’a pas besoin. Mais dans un monde qui confond liberté et code-barre, dans une société où narcissisme, frustration, dépression et cupidité s’emparent des écrans, refuser de parvenir ou, pour le dire avec les mots d’Albert Thierry, « refuser de vivre et d’agir pour soi et aux fins de soi », n’a rien perdu de sa pertinence subversive.
[Version audio disponible]



