Jean-Pierre Chrétien, Combattre un génocide. Un historien face à l’extermination des Tutsi du Rwanda (1990-2024), Le Bord de l’eau, 2024.
Il y a trente ans, des centaines de milliers de Rwandais étaient massacrés par un pouvoir aux abois. L’historien Jean-Pierre Chrétien est l’une des voix françaises qui dénonça aussitôt le pouvoir génocidaire et son fidèle allié, la France alors mitterrandienne. Combattre un génocide. Un historien face à l’extermination des Tutsi du Rwanda (1990-2024), publié par Le Bord de l’eau, lui rend hommage en proposant un ensemble de textes, d’interventions et de courriers produits avant, pendant et après le génocide ; car l’affaire rwandaise fut l’objet de violentes controverses franco-françaises1.
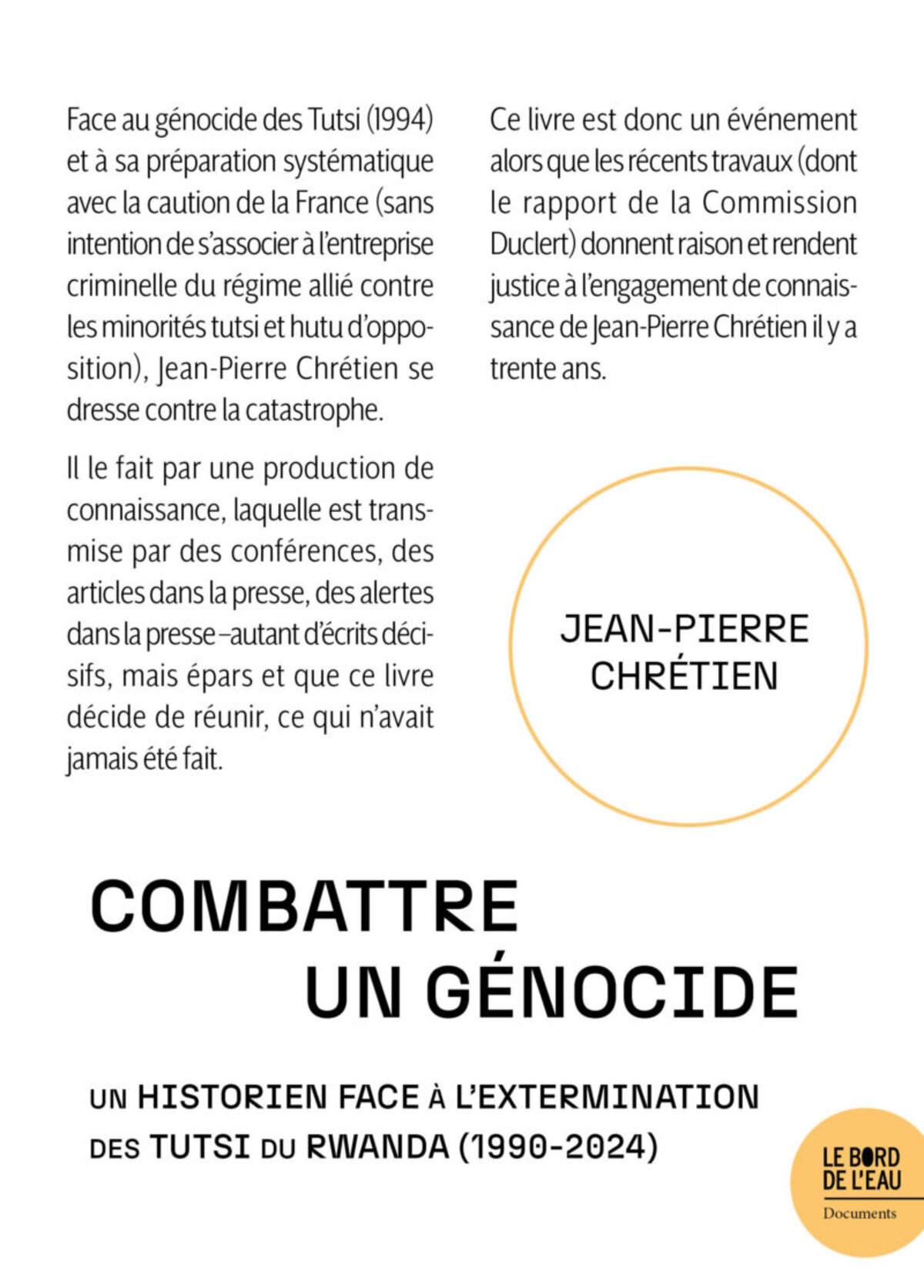
Agrandissement : Illustration 1
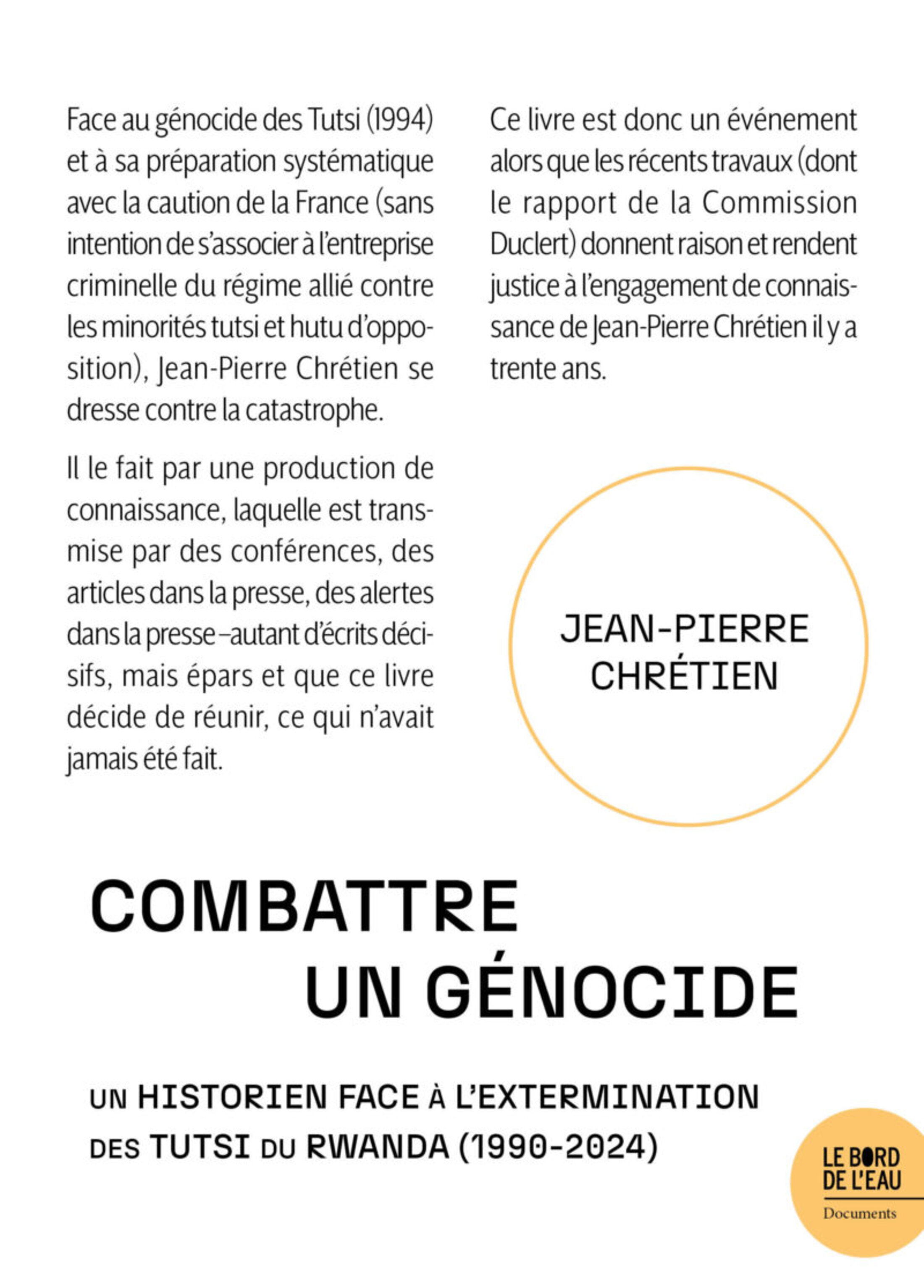
Jean-Pierre Chrétien est un spécialiste reconnu de la région des Grands Lacs auquel il a consacré l’essentiel de ses travaux2 ; des écrits qui ont permis de mieux comprendre ce que l’on nous présentait trop souvent comme un conflit de plus opposant deux tribus, Hutus et Tutsis, unis depuis la nuit des temps par une détestation commune. C’est contre cette grille de lecture qui doit tant à l’idéologie coloniale qu’il s’est élevé, en dénonçant la politique autoritaire du pouvoir rwandais tenu par un clan affairiste, prêt à tout pour conserver le pouvoir politique, condition sine qua non pour consolider sa domination économique ; une politique reposant sur une rhétorique nationaliste et raciste faisant d’un partie de la population, les Tutsis, des ennemis de l’intérieur, pire même, une race à exterminer : « Expliquer le génocide rwandais par des haines traditionnelles, écrit Jean-Pierre Chrétien, reviendrait à expliquer Auschwitz par une lutte interethnique entre Aryens et Sémites ».
Le génocide fut l’oeuvre d’extrémistes hutus issus des cercles du pouvoir, militaires, curés, journalistes, intellectuels, planificateurs des tueries qui ensanglantèrent le pays et dans lesquelles ils impliquèrent une partie de la population locale. Les Tutsis ne sont pas morts à cause d’un « atavisme inéluctable et répétitif » mais parce qu’une fraction de l’élite hutu a fait de leur liquidation physique la condition de sa survie politique et de celle de la Nation.
Jean-Pierre Chrétien s’est élevé contre cet « intégrisme ethnique », ce « nazisme tropical », et contre le soutien que lui apportèrent les autorités françaises y compris quand il prit la forme d’une intervention dite humanitaire pour stopper les massacres (et opportunément exfiltrer le gouvernement), ou quand nos dirigeants, toute honte bue, se mirent à défendre la thèse d’un double génocide, à rendre responsable la rébellion d’un tel déchaînement de haine et surtout, à absoudre le Pays des droits de l’homme de toute responsabilité.
Il faut lire Jean-Pierre Chrétien pour mieux comprendre ce qui s’est joué dans ce petit pays du coeur de l’Afrique, pour prendre la mesure de ce que fut à l’époque la « politique africaine de la France ». Il faut le lire pour se rappeler que les Africains n’ont pas attendu la colonisation pour avoir une histoire, et que « l’immuabilité de la tradition africaine n’a jamais existé que dans l’esprit des Européens »3 : pour le meilleur et pour le pire, les populations africaines font de la politique. Le pire est advenu au Rwanda en 1994.
[Version audio disponible]
1Je vous renvoie à la lecture de Politique africaine n°166 (France-Rwanda : rapports, scènes et controverses françaises), Karthala, 2022.
2Citons l’indispensable L’Afrique des Grands Lacs. Deux mille ans d’histoire (Aubier, 2000), ainsi que Rwanda, racisme et génocide. L’idéologie hamitique (écrit avec Marcel Kabanda, Belin, 2013).
3Ces mots de Jean-François Bayart sont issus d’un livre publié sous la direction de Jean-Piere Chrétien : L’Afrique de Sarkozy. Un déni d’histoire, Karthala, 2008.



