Samuel Moyn, L’Affaire Treblinka. 1966. Une controverse sur la Shoah, CNRS, 2024
Au printemps 1966, un livre fait sensation : il s'intitule Treblinka, et son auteur est Jean-François Steiner. L’historien américain Samuel Moyn nous en dit plus avec L’Affaire Treblinka. Une controverse sur la Shoah, livre sorti en anglais il y a vingt ans mais seulement récemment en français grâce à CNRS Editions.
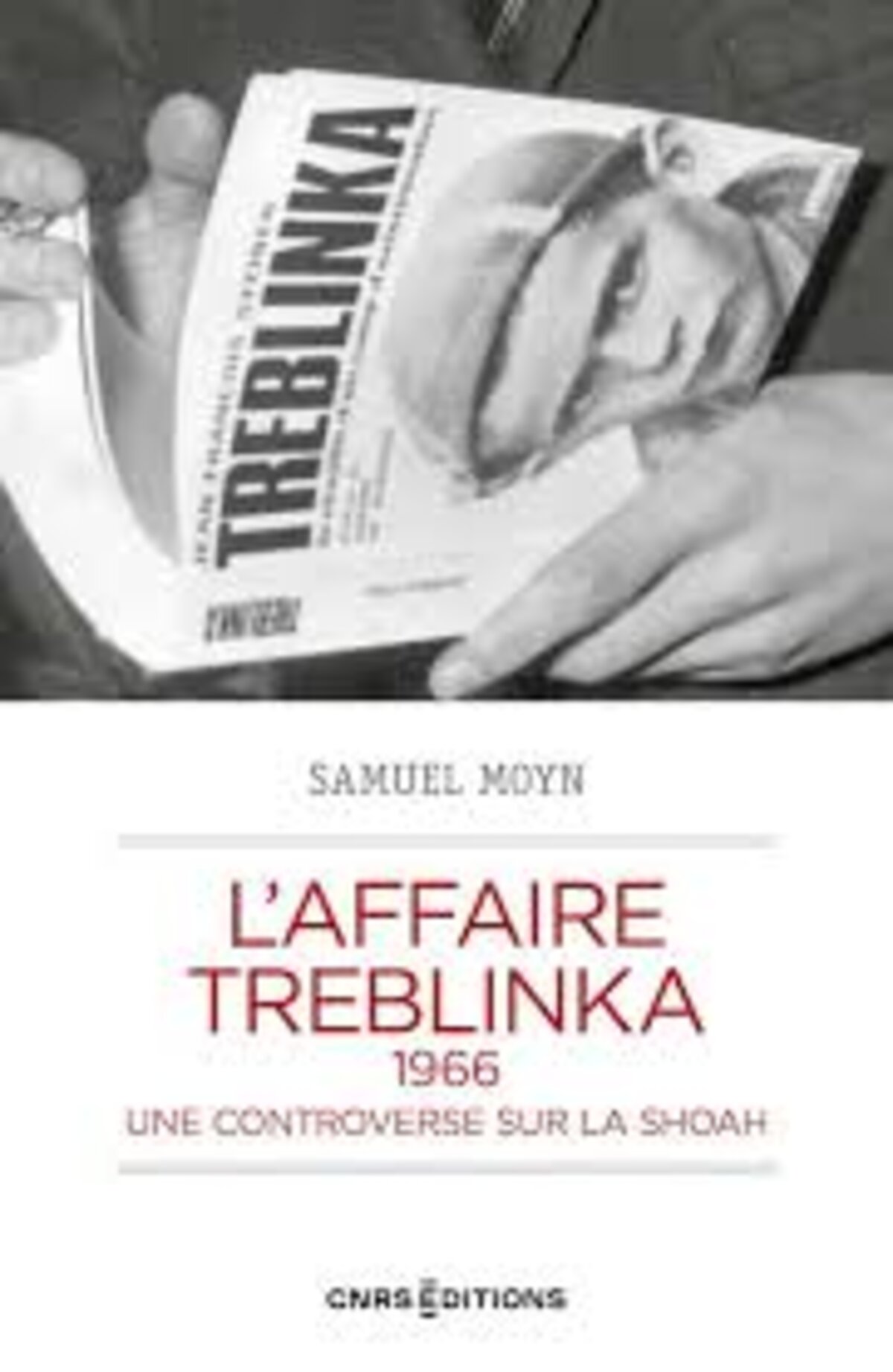
Jean-François Steiner est un personnage singulier. Il est Juif, fils d’un sioniste réactionnaire, déporté et mort dans un camp de Silésie. Il a vécu dans un Kibboutz puis s’est engagé chez les parachutistes et participé à la guerre d’Algérie. Il n’est pas historien,mais journaliste et il n’a pas trente ans lorsqu’il commence ses recherches sur le camp d’extermination de Treblinka et la révolte héroïque qui le secoua en août 1943. Il en tire un livre hybride où se mêlent témoignages des rares survivants, archives et éléments fictionnels. Porté par une campagne publicitaire tapageuse et provocatrice, le livre, préfacé par Simone de Beauvoir, connaît un vif succès, mais ne tarde pas à provoquer la polémique.
Pour la comprendre, il faut, souligne Samuel Moyn, la recontextualiser. Dans les années 1950, on distingue peu les victimes juives des autres victimes du nazisme : un déporté est un déporté, qu’il soit Juif ou résistant, et la Shoah n’est qu’une des manifestations de la barbarie nazie. Dans les années 1960, avec le procès Eichmann, on commença à distinguer, au sein de l’univers concentrationnaire, les camps de la mort1. Treblinka, c’est 800 000 morts en moins de deux ans. On y entre pour y être tué, et ne survivent que ceux dont la machine exterminatrice a besoin.
Si l’ouvrage de Steiner fit polémique, c’est qu’il rendait les Juifs complices des bourreaux, ce qui réjouissait notamment la droite, l’extrême droite et les antisémites. Complices parce qu’affectés sous peine de mort aux sonderkommandos, ils devenaient un des rouages de la machine à tuer. Complices parce que les élites juives, via les conseils juifs2, avaient facilité la déportation des leurs, en lien avec les nazis. Complices parce que prisonniers de « l’esprit de ghetto », ils étaient allés à l’abattoir comme des moutons : le Juif du ghetto, non-violent, était l’antithèse du Juif bâtisseur, figure centrale du projet sioniste ; et Jean-François Steiner, porté par le culte de la force et le virilisme, avouait avoir honte d’être « l’un des fils de ce peuple » si lâche et docile. Il comparait ainsi la révolte du ghetto de Varsovie, révolte du désespoir contre l’imminence de l’anéantissement, à la révolte de Treblinka dont le but n’était pas de mourir les armes à la main mais de vivre.
Samuel Moyn nous entraîne au coeur de cette polémique aussi rude, violente que riche et éclairante où l’on croise des intellectuels, spécialistes ou non de la Shoah, comme Vidal-Naquet, Marienstras, Rousset, Poliakov, Hilberg ou encore Lévinas, mais aussi des rescapés de la Shoah, interviewés par Steiner et qui dénoncent la façon dont leurs propos ont été interprétés par l’auteur. Dans cette controverse, étaient discutées autant l’expérience concentrationnaire que la supposée nature juive éternelle ou encore la soi-disant passivité des Juifs. Car combien de révoltes collectives non juives ont-elles perturbé l’ordre concentrationnaire nazi ?
Samuel Moyn l’avoue : « Les croyances et motivations de Steiner (...) sont impossibles à cerner complètement, et elles sont loin d’être le point le plus intéressant dans l’histoire de l’accueil du livre ». Son travail l’a amplement prouvé.
[Version audio disponible]
1 Les survivants se sont-ils tus ou a-t-on fait le choix de ne pas les entendre ? Cette question est toujours discutée...
2 Cette « complicité » est présente dans le livre de Hannah Arendt (Eichmann à Jérusalem : Rapport sur la banalité du mal, 1963). Maurice Rasjfus analysera également l’attitude des élites juives françaises dans son Des Juifs dans la collaboration. L’UGIF 1941-1944 (1980, rééd. Editions du Détour 2001).



