Noam Chomsky et Vijay Prashad, Le retrait. La fragilité de la puissance des Etats-Unis : Irak, Libye, Afghanistan, Lux, 2024.
Alors que Donald Trump vient de poser ses valises, sa grossièreté, son arrogance et Elon Musk à la Maison blanche, avec les conséquences que cela est censé avoir sur la politique étrangère du pays, il peut être judicieux de lire les échanges entre Noam Chomsky et l’historien Vijay Prashad1 réunis dans Le retrait. La fragilité de la puissance des Etats-Unis : Irak, Libye, Afghanistan.
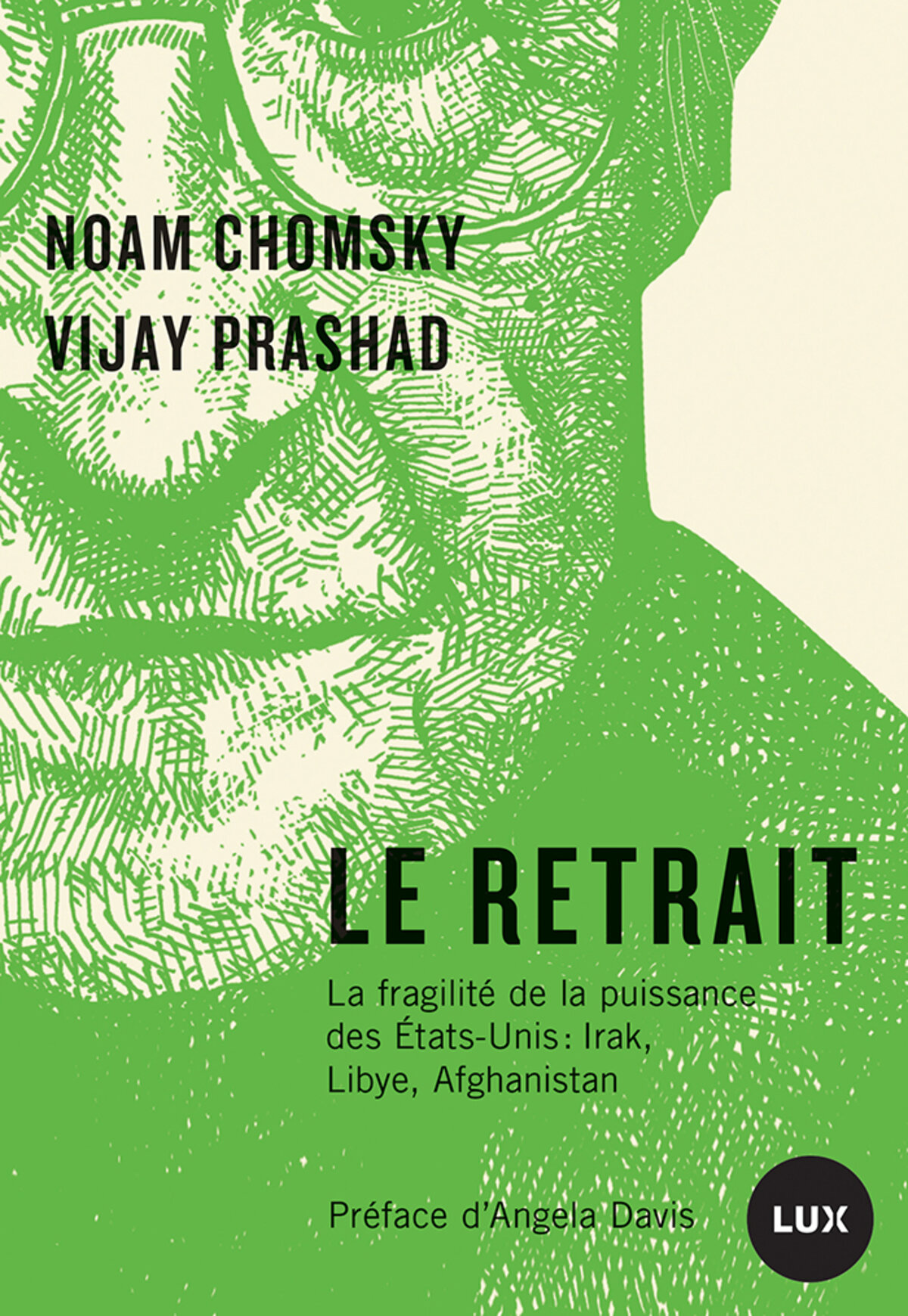
Agrandissement : Illustration 1
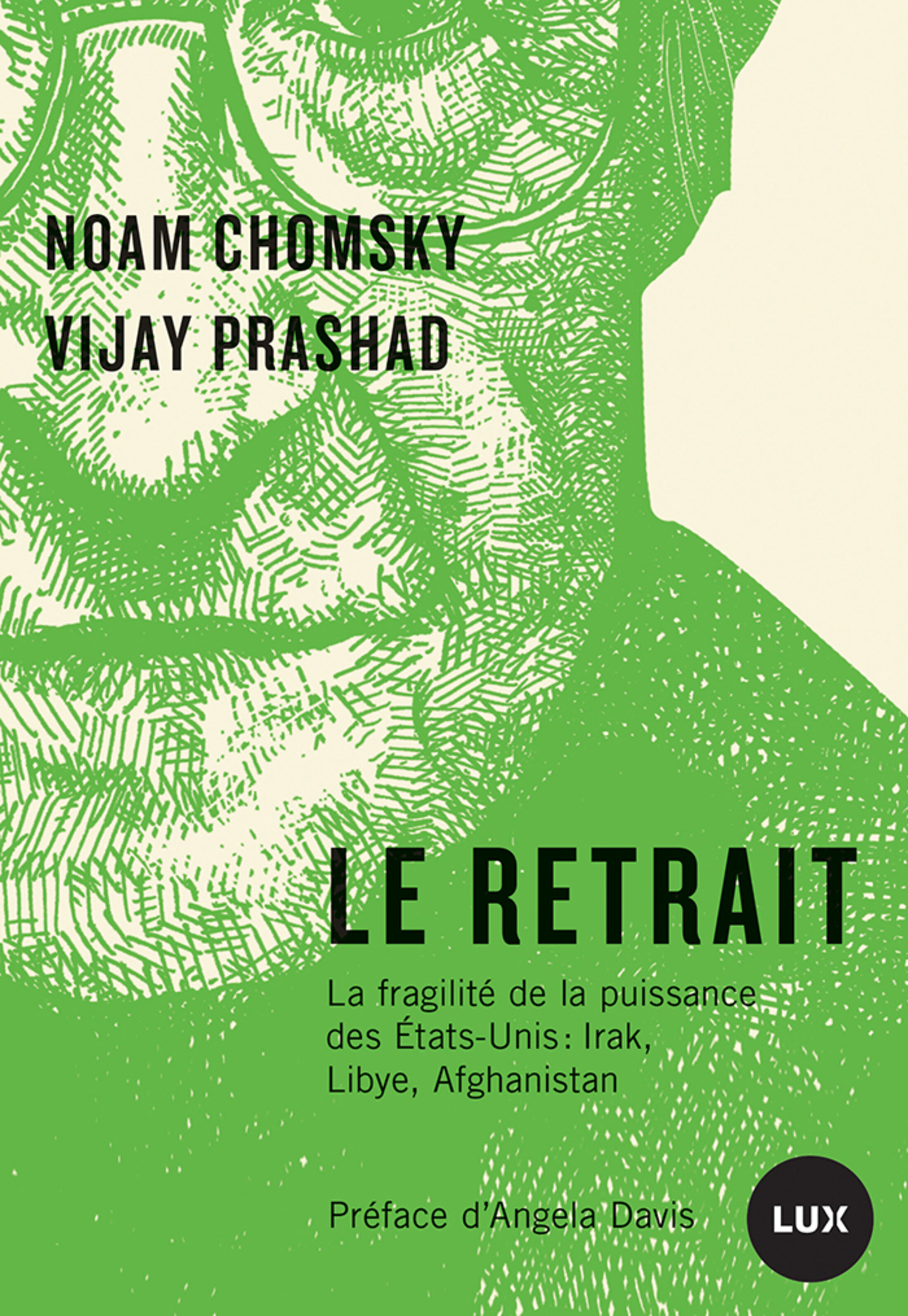
Depuis plus d’un demi-siècle2, Chomsky n’a de cesse de « rejeter l’exceptionnalisme américain » et de dénoncer « l’incroyable désinvolture avec laquelle le massacre délibéré de vies humaines ordonné par l’État se trouve minimisé sous l’effet de l’idéologie américaine ». Au nom de la défense de la Liberté et du business, les Etats-Unis et le monde dit libre ont ainsi massacré des millions de personnes à travers le monde depuis la fin du second conflit mondial, mais nos grands médias, autre cible de Chomsky avec les intellectuels médiatiques, ne pointent que les crimes « communistes », une sorte de reductio ad Stalinum, en somme. C’est au nom de l’anticommunisme que l’Asie du sud-est fut noyé sous les bombes, et Chomsky, comme beaucoup d’Américains, a été profondément marqué par la guerre du VietNam…
« Personne ne peut rien exiger du parrain, qui décide de tout et prend ce dont il a besoin » nous dit Chomsky. Puissance impériale majeure, les Etats-Unis règnent sur le monde et s’octroient le droit de « faire la guerre préventive à volonté » : « Défier les Etats-Unis exige un peu de courage et d’indépendance. Voilà qui est trop demandé aux dirigeants européens. Ils se contentent d’obéir aux ordres du parrain ». La formule est rude et non dénuée de vérité mais elle a aussi ses limites : les relations internationales ne sont jamais à sens unique, et les acteurs étatiques tentent toujours de négocier au mieux de leurs intérêts leur position subalterne3.
Hier comme aujourd’hui, les mensonges, repris par les médias, sont au coeur du dispositif impérialiste : il faut « fabriquer du consentement ». Que n’inventerait-on pour justifier une intervention militaire ou en préparer une ? Des armes de destruction massive d’un côté, un risque nucléaire de l’autre : « la propagande est à la démocratie ce que la violence est au totalitarisme »4.
Dans l’oeil du viseur chomskyen, il y a également l’OTAN qui, le danger soviétique écarté, a été « restructurée de façon à permettre aux Etats-Unis d’asseoir leur domination sur la planète », au risque, par exemple, de « provoquer une escalade des tensions avec la Chine. »
« Une fraction du budget militaire (américain) suffirait (pour) rénover les infrastructures vétustes et répondre aux plus urgents besoins sociaux » se désole-t-il. Nonagénaire, Chomsky pose un regard très pessimiste sur son pays : « On ne peut survivre à cette société dysfonctionnelle. C’est impossible », dit-il avant de se reprendre et d’affirmer qu’il « est possible d’éviter la catastrophe et de faire advenir un monde meilleur ». Mais voilà : en 2020, parlant de Donald Trump, Noam Chomsky a écrit : « L’idée que le destin d’un pays et du monde soit entre les mains d’un bouffon sociopathe est particulièrement inquiétante5. »
[Version audio disponible]
1 Vijay Prashad, Une histoire politique du tiers-monde, Ecosociété, 2019.
2 Noam Chomsky et Edward Herman, Economie politique des droits de l’homme, Albin Michel, 1981.
3 Soulignons la réédition en poche du livre de Bertrand Badie, Intersocialités. Le monde n’est plus géopolitique (CNRS Editions, 2024).
4 Noam Chomsky, Contrôler l’opinion publique, 1996 ; Noam Chomsky et Edward Herman, La fabrique de l’opinion publique, 1988.
5 Noam Chomsky et Marv Waterstone, Les conséquences du capitalisme. Du mécontentement à la résistance, Lux, 2021.



