Edouard Morena, Paysan, Anamosa, 2024.
Le paysan est un taiseux qui n’en pense pas moins. Le paysan est un plouc arriéré, avare et cupide, sensible aux discours réactionnaires ou populistes. Le paysan, parce qu’enraciné, porte en lui la vérité de la Nation… Le paysan est ceci et cela.
Avec Paysan publié par Anamosa dans sa collection Le mot est faible, l’historien Edouard Morena nous rappelle que « les sens communément attribués au mot paysan traversent l’histoire et les clivages politiques ». C’est un « mot fourre-tout » qui désigne aussi bien celui qui gratte la terre pour en tirer un modeste revenu que le céréalier cossu employeur de main-d’oeuvre.
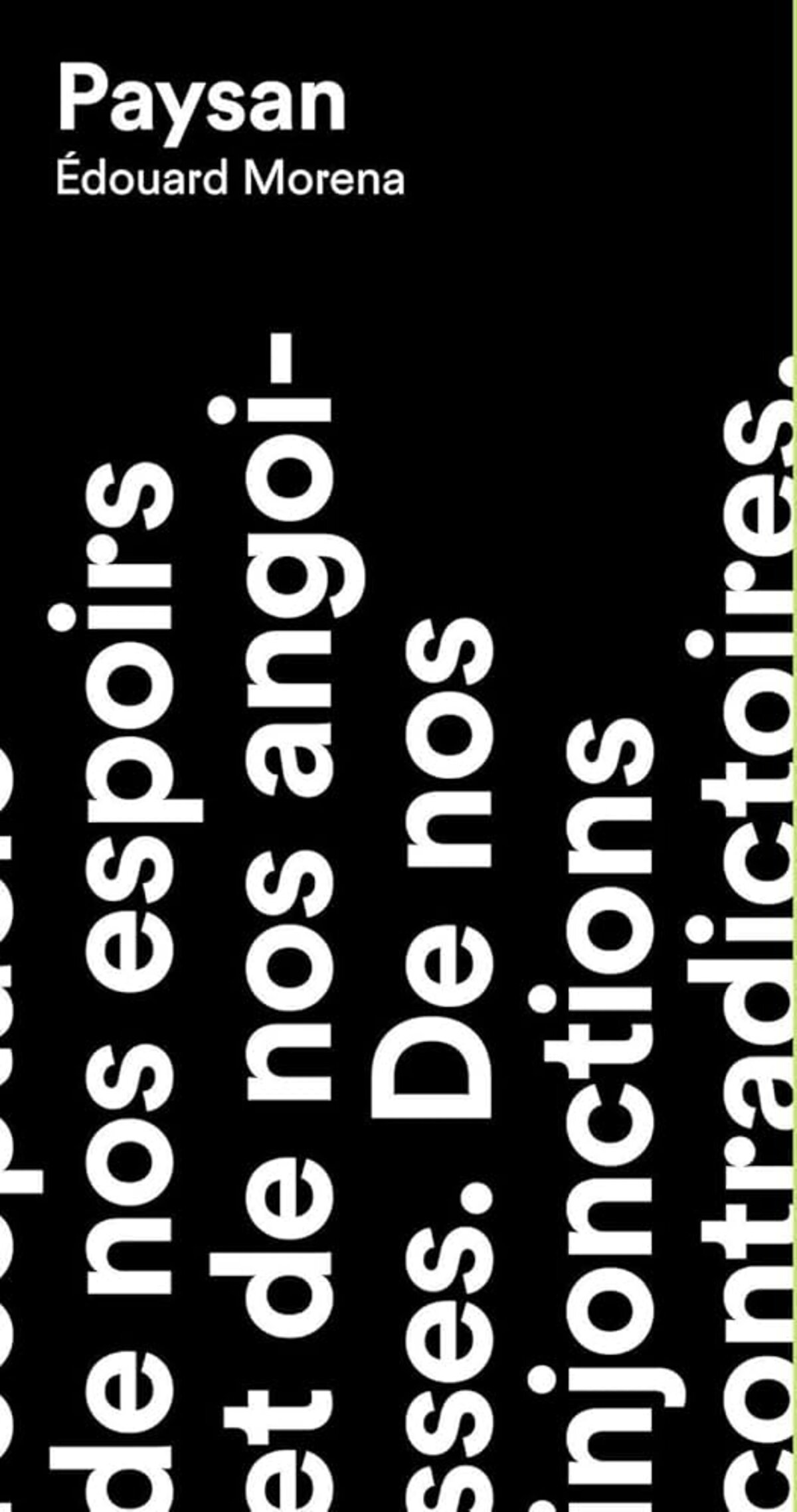
Agrandissement : Illustration 1

Au 19e siècle dans une France en phase d’industrialisation mais encore rurale et agricole, les élites monarchistes, républicaines, socialistes développèrent toute une rhétorique susceptible de leur attirer les suffrages des cul-terreux, pécores, croquants et autres pedzouilles.
Pour les premières, le paysan incarne la France éternelle, pieuse, laborieuse et respectueuse des hiérarchies naturelles ; il est le socle sur lequel bâtir son hégémonie politique. Pour les secondes, il faut enraciner l’idéal républicain dans les caboches rurales, autrement dit ne pas les effrayer avec un discours collectiviste et anticlérical. Pour les troisièmes, il faut convertir le paysan individualiste, attaché à la propriété de la terre au socialisme et à ses promesses de félicités.
Alors, on le pare de toutes les qualités, notamment à droite. Le paysan a du bon sens et il est vertueux. Il est authentique et attaché aux traditions évidemment immémoriales. Sa culture est folklore.
Il a le sens de la famille et il a le respect des aînés. Il est le vrai peuple de France, bien plus que la canaille rouge prolétarienne des villes. Et puis, cette terre qu’il travaille du matin au soir, n’est pas seulement la terre qui peut l’enrichir, elle est une portion du territoire national que tout homme doit défendre. Le paysan incarne également la méritocratie car sa réussite ne tient qu’à lui, qu’à sa capacité à s’élever dans l’échelle sociale grâce au labeur. Discours politiques, romans, publicités, peintures, musées, études ethnologiques… le paysan est célébré, et le bouseux ennemi du progrès est mis de côté.
Discours d’hier, discours d’aujourd’hui. La France n’est plus un pays de paysans. Ils étaient des millions, ils ne sont plus que quelques centaines de milliers. Lors des Trente-Glorieuses, les chercheurs annonçaient déjà sa mort et celle de la « civilisation » dont ils étaient porteurs. Mais à chaque Salon de l’agriculture, on sent bien que le monde agricole a un poids symbolique et politique bien plus important que sa force numérique ne peut le laisser entendre.
Dans les années 1970, la gauche radicale redécouvre le « paysan », figure de la résistance à l’agro-business, figure écologiste ennemie du productivisme et de la chimie, figure potentiellement révolutionnaire pouvant prendre la relève d’un prolétariat accablé, frappé de plein fouet par la désindustrialisation.
A raison, l’auteur souligne que « le mot paysan obscurcit les différences, les tensions et les rapports de domination qui traversent, et qui ont historiquement traversé, la population agricole ». Parce qu’il est « sans valeur analytique », Il nous invite à abandonner le mot qui « obscurcit plutôt qu’il n’illumine ».
[Version audio disponible]



