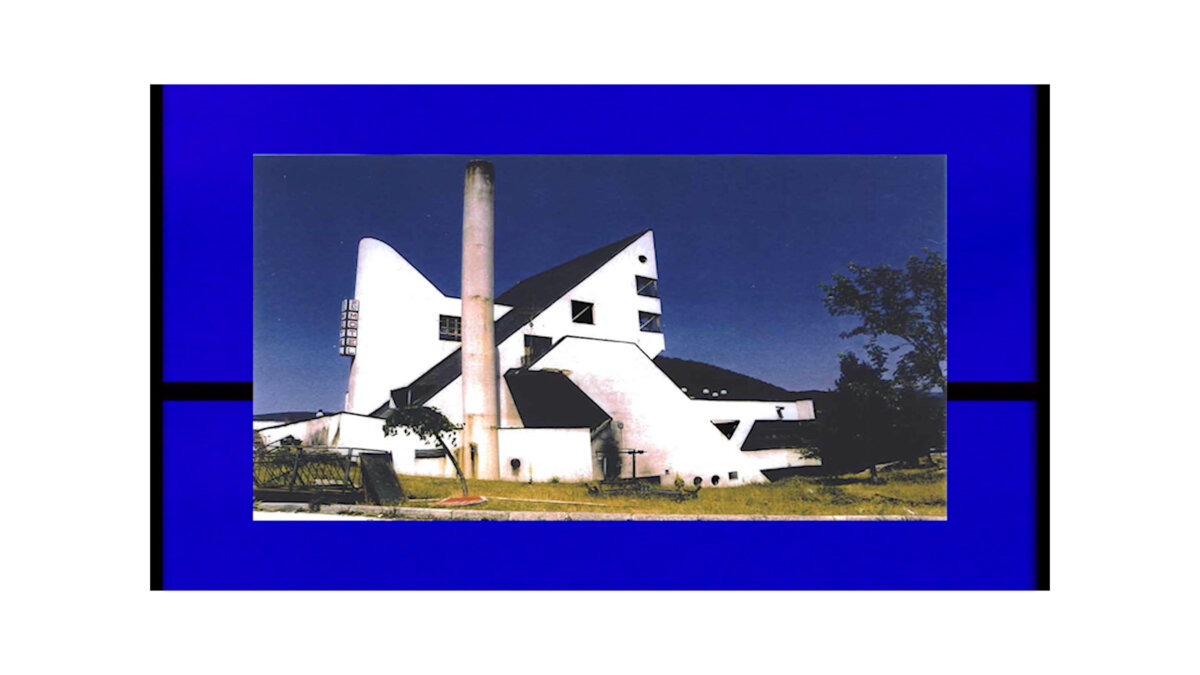
Agrandissement : Illustration 1
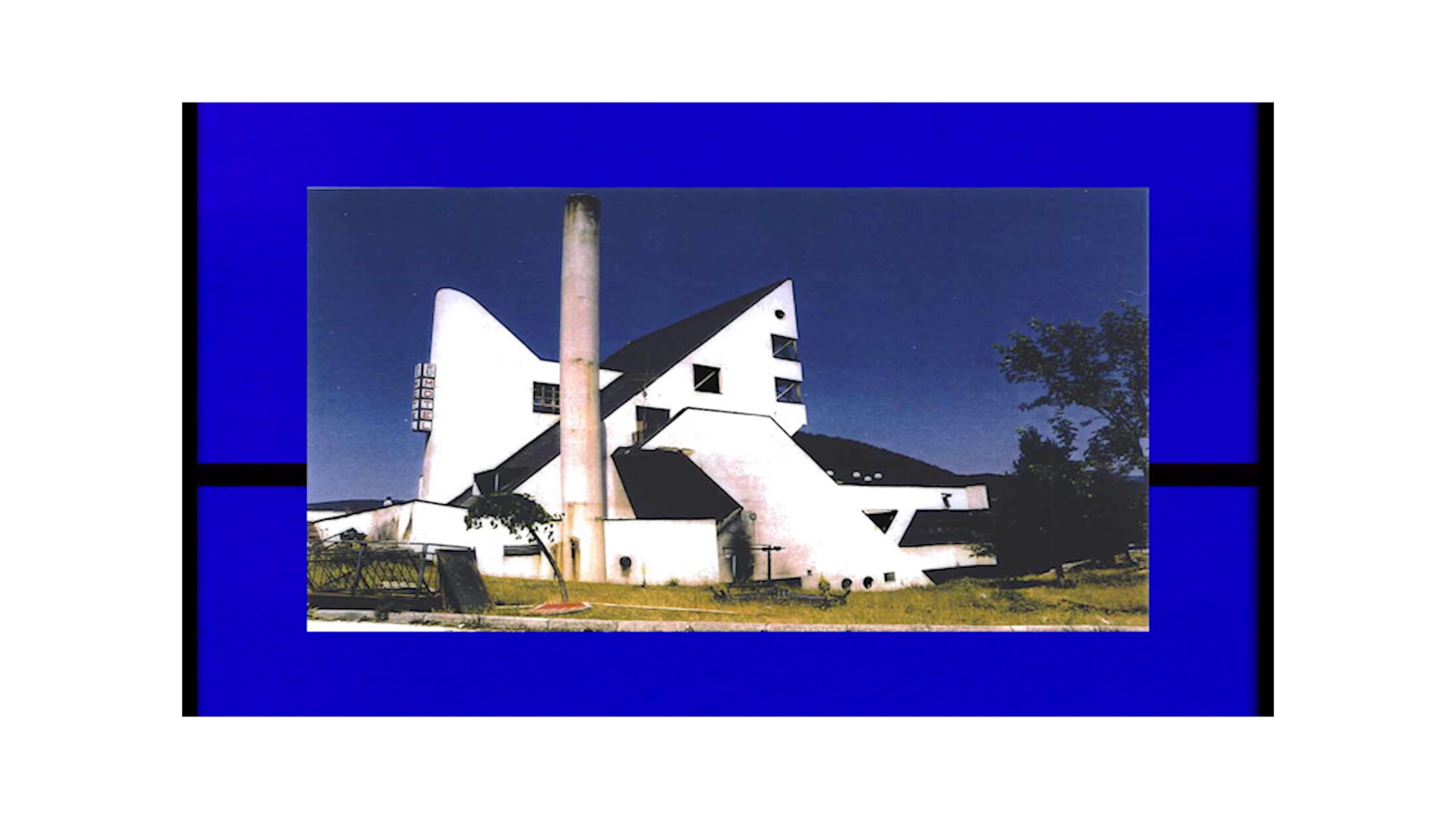
Silence of Reason est la troisième réalisation de Kumjana Novakova. Lauréat en 2023 du Prix des Droits Humains au Festival du film de Sarajevo et du Prix Envision de la meilleure réalisation au Festival international du film documentaire d'Amsterdam (IDFA), de la Mention spéciale au Meilleur documentaire et du Prix Ghandi Glasses au Festival du film de Turin (TFF), le documentaire revient sur le procès du camp de viol de Foča (Macédoine du Nord, Bosnie-Herzégovine). Grâce aux 132 témoignages, le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) est le premier à reconnaître le viol systématique et l’esclavage sexuel subi par les victimes comme crimes de guerre contre l’humanité. Mais de l’histoire officielle du cas Kunarac et al., si pionnière, déborde le traumatisme des chairs et des mémoires rompues. Kumjana Novakova veut relire les archives pour réécrire l’histoire, en faisant du silence sa matière filmique.
Pour moi, de manière générale, la réalisation d'un film est une question de recherche. Je me considère comme une travailleuse du cinéma, qui opère sur différents segments : non seulement en tant que cinéaste, mais aussi en tant que curatrice et conférencière. Toute mon activité est fondée sur la pratique de la recherche, car il est capital que les arts et le cinéma soient des lieux où les processus sociaux et politiques sont discutés, élargis ; le cinéma est expérimental comme un laboratoire, on regarde à travers la caméra comme à travers un microscope.
Après plusieurs années de travail sur mon précédent film avec Guillermo Carreras-Candi, Disturbed Earth – rien que sa réalisation nous a pris sept ans – le covid est arrivé alors que nous entrions à peine dans la phase de montage. L'impossibilité de revenir au tournage agissait comme une limitation créative : nous avons compris que la matière tournée, seule, ne faisait pas de film ; c'est un mur que j’ai pris en tant que cinéaste, puis contourné en effectuant des recherches dans les archives.
Comparé à Disturbed Earth, le cadre de production initial était très différent : j'ai reçu une très petite subvention pour réaliser un court essai de dix à quinze minutes, qui a ensuite été transformé en Silence of Reason.
C'était ma première rencontre avec les archives du TPIY. Ouvertes à tous, elles préservent la plus douloureuse histoire récente et les mémoires collectives de l'espace géographique d'où elles proviennent. Mais elles restent des archives judiciaires : ordonnées juridiquement, situées géographiquement à l’extérieur de la région, rédigées en langues étrangères ; ainsi elles nous appartiennent en même temps qu’elles nous échappent. Les langues locales sont présentes tant que les ressources originales en font partie des archives en tant que documents originaux, mais c’est tout. Ce sont donc des archives paradoxales et très attrayantes pour l'espace de recherche qu’elles ouvrent sur nos récits très difficiles.
Par quels choix artistiques et narratifs s’incarne une matière archivistique aussi froide et prétendument neutre que les expertises médico-légales ?
J’ai travaillé dans les sciences sociales pendant plus de dix ans avant d’entrer dans le cinéma. J'étais très jeune, au sein d’un espace masculin extrêmement hiérarchisé. Ma façon de me rebeller fut d’aller vers un imaginaire hors de l’espace conventionnel des scientifiques : l'art. Ce qui relève pour eux presque d’un divertissement est pour moi un acte de rébellion.
En parallèle, cela fait plusieurs années que je projetais de mener une expérience féminine de l’histoire. Pas spécialement en temps de guerre – la guerre et la paix sont les deux faces d’une même pièce. Depuis la fin du XIXe siècle, nous passons cycliquement par des guerres ; l’expérience féminine de la guerre a toujours été considérée au travers du regard masculin, jamais par la subjectivité de la femme.
Le travail archivistique croisé avec le sujet de l'expérience féminine de la guerre m’a poussée à regarder de plus près ces archives en particulier. Ce fut un moment charnière, face à des archives très difficiles : elles sont ouvertes à tous, mais les comprendre implique de se familiariser avec le système juridico-légal, dense et technique.
Mes premières recherches brassaient large : je me suis penchée sur de nombreuses expériences différentes, pas uniquement sur la Bosnie mais aussi la Yougoslavie. Un jour, je suis tombée sur l'une des témoins les plus présentes dans le film, la n°87. J'ai lu son témoignage en entier et ce fut si fort qu'il ne pouvait plus s'agir d'autre chose. C'est à ce moment-là que le corpus a été réduit.
Pour expliquer simplement la manière dont je travaille avec les archives : j’ai ré-archivé l'affaire Kunarac et al. dans un inventaire qui répondait à la logique du champ. Je travaille beaucoup avec les archives et je suis très attirée par elles, mais en général, chacune s’organise selon ses politiques et ses hiérarchies propres. Afin de les contourner, nous avons passé beaucoup de temps à les repenser afin de les contrer et de créer nos propres contre-archives et contre-histoires.
Cela impliquait de placer les témoins comme sujets principaux, de manière à décentrer l'accusé. Les archives d'un tribunal sont polarisées entre l’accusation et la défense. Je voulais redonner le pouvoir aux témoins, qui sont les vrais sujets dans cette affaire : par leurs témoignages, ce sont elles qui ont infléchi le cours de notre présent et de notre avenir politiques. Ce procès, comme vous l'avez peut-être compris avec le film, a changé le système juridique ; je l'ai donc ré-archivé avec les femmes qui ont témoigné pour protagonistes, avec toutes les sources organisées dans le respect de leurs logiques. Ensuite, nous en avons tiré une linéarité à partir de leurs expériences, de sorte que la chronologie historique n'était plus celle suivie par le temps de l’histoire officielle mais tel qu'il est raconté par les femmes. J'ai suivi deux ou trois protagonistes principaux, en plus du n°87 : le n°75, les n°51 et 52 – mère et fille – et ainsi de suite.
Il y a aussi les témoins manquants : il y a dans les archives des présences marquées par le silence et l'absence, comme AB qui est l'une des protagonistes bien que son corps soit toujours introuvable.
Cette complexité d'expériences définit en quelque sorte un personnage unique : la femme dont nous avons construit la subjectivité. La source médico-légale permet aux témoins de passer de sujets victimes à survivantes ; la survie est ce qui pénètre l'espace filmique du début à la fin, voire tout mon travail. C’est un positionnement féministe, mais aussi de l'histoire des géographies auxquelles j'appartiens : si vous venez de la périphérie, vous êtes constamment racontée par les autres comme une victime et non comme une survivante.
Voici les piliers fondamentaux de la constitution du regard. Mais si vous voulez une réponse unique, l'objectif de ce travail réalisé avec l’équipe était de créer nos archives. Une nouvelle archive qui parle, à travers les voix des survivantes de violences sexuelles à nos futures nous-mêmes. Nous descendons de générations de corps violés ; nous sommes aussi des survivantes, et on nous a refusé le droit d'apprendre des survivantes qui nous ont précédées. Pourquoi devrions-nous faire ce film ? C’est ce que la monteuse m’a demandé ; c’est une question politique très importante. Nous avons toutes les deux une expérience personnelle et familiale très proche : nous descendons de grands-mères qui ont survécu à des violences sexuelles, à différents endroits de la Bosnie, mais du même type. C'est une expérience qui nous relie tous, même si on nous a refusé le droit de nous souvenir d'elles comme des survivantes. Nous avons été élevés et éduqués dans un système de victimes et de procureurs.
Nous voulions briser cette ligne et créer un espace défini par nous-mêmes, pour notre avenir : voilà l'objectif principal du film. Bien sûr, chaque cinéaste est différent, mais dans mon travail et dans celui de beaucoup de mes collaborateurs, l’objectif est toujours beaucoup plus complexe qu'un film ; ou, à l'inverse, le film complexe a pour objectif de susciter un acte social et politique.
Je retrouve dans vos mots ceux de Saidiya Hartman ; dans l’un de ses essais « Venus In Two Acts », l’écrivaine et universitaire américaine se méfie de l’intention naïve de « redonner la parole » aux opprimées et aux subalternes occultées par les archives – par exemple les nombreuses esclaves de la traite atlantique confondues sous le nom de Vénus. En effet, la fiction ne peut réparer la violence documentaire en venant simplement combler le « silence dans l’archive ».
Je vous suis très reconnaissante de mentionner Saidiya Hartman, car elle est l'une de mes principales références et une sorte de mentore sur le plan méthodologique. Son influence imprègne fortement un nouveau projet en cours, mais la méthode de travailler avec et contre les archives a guidé Silence of Reason. C’est essentiel pour moi de travailler à ce que l’imagination autorise en opposition à la réalité qu’on nous soumet, tout en ayant conscience que tout effort de « donner une voix » est vain. C'est à ces écrivaines de premier plan des années 70 comme Saidiya Hartman et Tillie Olson que revient le mérite d'avoir introduit les silences dans la littérature et dans les arts. Elles contredisent en quelque sorte l'idée féministe selon laquelle nous pouvons donner une voix à quelqu'un, une question très problématique.
C'est sur cette base que Silence of Reason a réfléchi à la multi-vocalité et à la pluralité de ce personnage unique, qui est à la fois chacun d'entre nous et aucun d'entre nous. »
Outre sa gravité, la forme de Silence of Reason place le film à l'opposé du divertissement. Qu’implique le double rôle de réalisatrice et de productrice dans son engagement à contre-courant du cinéma en tant qu'industrie ?
« Il y a de moins en moins de place pour les pratiques critiques et indépendantes – qu'il s'agisse d'écriture, de cinéma, d'arts vivants ou que sais-je. En résulte une position précaire qui ne vous laisse pas le choix de continuer ou non. Certes, cette polyvalence offre une grande liberté et beaucoup d'autres avantages ; mais en fin de compte, elle cache mal l'impossibilité de trouver les bonnes conditions et le soutien nécessaires. On est donc confronté à un perpétuel dilemme : certains continuent et survivent longtemps, mais beaucoup aussi abandonnent la pratique et changent de mode de vie, parce que c'est extrêmement fatigant et instable.
En ce qui concerne plus particulièrement Disturbed Earth et Silence of Reason, je vais essayer d'être illustrative : ces deux films sont des films impossibles pour l’industrie du cinéma. Très difficiles à financer, ils proviennent d'une région dépourvue de marché – la Bosnie est une sorte d'impossibilité dans le paysage de la production européenne, elle n'apporte pas de divertissement, ni en général, ni dans ce cas.
La seule façon pour nous de faire un film est donc de tisser un réseau de solidarité avec les collaborateurs et de considérer le film comme une œuvre d'art collaborative, tant sur le plan artistique que sur le plan de la production. D'un côté, cela soulève beaucoup de questions et demande davantage de travail que pour une œuvre d'art produite de manière conventionnelle, mais d'un autre côté, cela apporte aussi des perspectives, des libertés et des joies inédites. Pour Silence of Reason, je dirais que c'était plus facile parce que cela nécessitait une équipe plus petite et moins de fonds que pour Disturbed Earth, puisque tout le film reposait sur les archives : l’équipe se réduisait donc à la monteuse, le monteur son, la designer et moi. Nous nous sommes engagés ensemble dans ce film pour ce qu’il allait partager avec nous : sa valeur créative plutôt que lucrative. D’un côté, ce n'est pas une situation dont je suis fière : il est très difficile d'aller voir ses amis pour leur demander du temps et du travail, parce qu’on reproduit le système qui agit sur nous. Mais d’un autre côté, j'espère que ce genre de collaborations, d'amitiés et d'amour nient le fait que la seule façon de créer est celle du marché.
J'ai travaillé très dur pour changer cette logique dans le cadre de mon prochain projet ; j'espère qu'il sera financé dignement. Cependant, j’insiste sur mon mot d’ordre : je ne céderai jamais sur les méthodologies et les langages auxquels je crois au prix d’un plan de production. Pour moi c'est primordial et tous les collaborateurs avec lesquels je travaille partagent cette conviction.
Par exemple, c'est le quatrième film sur lequel je travaille avec la monteuse Jelena Maksimović, une de mes plus proches amies ; et je sais que nous sommes guidées par les mêmes principes. Il relève de chacun d'entre nous, compatriotes créatifs, de faire un front commun. Parce que c'est une lutte.
Je pense qu'il est encore possible de subvertir l’industrie qui réduit l'espace collectif de création, grâce aux espaces de création existants et très inspirants : il y a des festivals publics, des institutions publiques qui font entendre leur voix critique à de nombreux égards. Des moyens subsistent, mais nous devons insister sur ce point : se battre pour l’indépendance de l'espace public, et non pas d’une seule production, d’un seul film ou d’un seul auteur. Je pense que la clef est là.
Je vais aller droit au but : je pense que nous vivons une crise particulière, où se manifeste l’obsolescence de nos paradigmes. Les sciences manquent d'imagination et de liberté pour rompre avec les anciens paradigmes oppressifs et extractivistes. Je vois dans l'art un espace qui œuvre pour ce que les sciences échouent à faire. Dans cette idée, le documentaire est plus efficace que d'autres formes d'art en tant qu’il met en présence des connaissances très distinctes.
Ma réflexion est aride, autant que la réalité du système dans lequel nous vivons : chaque jour, nous repoussons nos limites éthiques, politiques et sociales – en ce moment même, nous vivons le pire des crimes imaginable : un génocide d'enfants.
Face au pire, toutes les normes hiérarchisées et établies de production de savoirs sont en échec : la réduction des connaissances par les moyens les plus conventionnels prouve que nos systèmes ne fonctionnent tout simplement pas.
Je ne sais pas si les artistes s'en sortent mieux, si une solution existe, mais il y a au moins une liberté en puissance que nous pouvons encore revendiquer au nom de l'imagination. Ma génération couve un potentiel que nous devons tenter d'activer, parce que tout le reste est en train de faire défaut : il en va de notre responsabilité de ne pas seulement dénoncer cette défaite. Je ne veux pas être pessimiste. Je pense que nous devons essayer de changer le système, par des solutions à l’extérieur des systèmes scientifiques, juridiques et politiques.
Il faut s'engager dans la réalité telle qu'elle est et nommer les choses, d’autant que nous vivons dans une sorte de réalité fabriquée qui empêche d'être critique d'une manière productive et créative. Et pour moi, ne pas reconnaître les limites des disciplines qui pensent la société est juste irresponsable ; en ce sens, la départementalisation actuelle est en soi un mode de fonctionnement hiérarchique.
Ma conviction et mon optimisme reposent sur les convergences entre les différents domaines, et sur la liberté qu’offre leur mise en relation – qu'il s'agisse de la science et de l'art, de la musique et de l'escalade, ou une infinité d'autres choses encore. Les réseaux tissés par la force de l’imagination entre des espaces inimaginables ensemble, promettent de nouvelles façons de faire et de penser pour faire naître l’espace de notre survie, de notre avenir.
Propos recueillis par Emma Chauprade-Ricard
Projections à Cinéma du réel
Lundi 25 mars à 17h au Centre Pompidou, Cinéma 1
Mercredi 27 mars à 21h au Forum des Images
Mardi 26 mars à 19h15 à la Bulac



