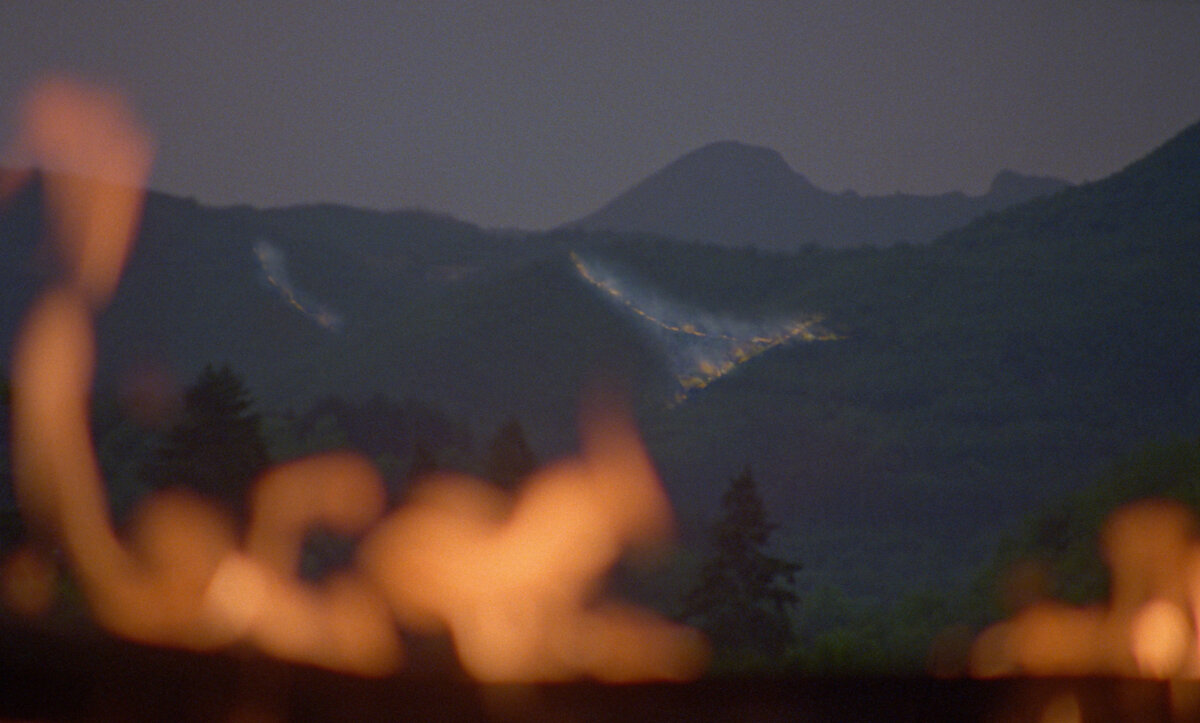
Agrandissement : Illustration 1
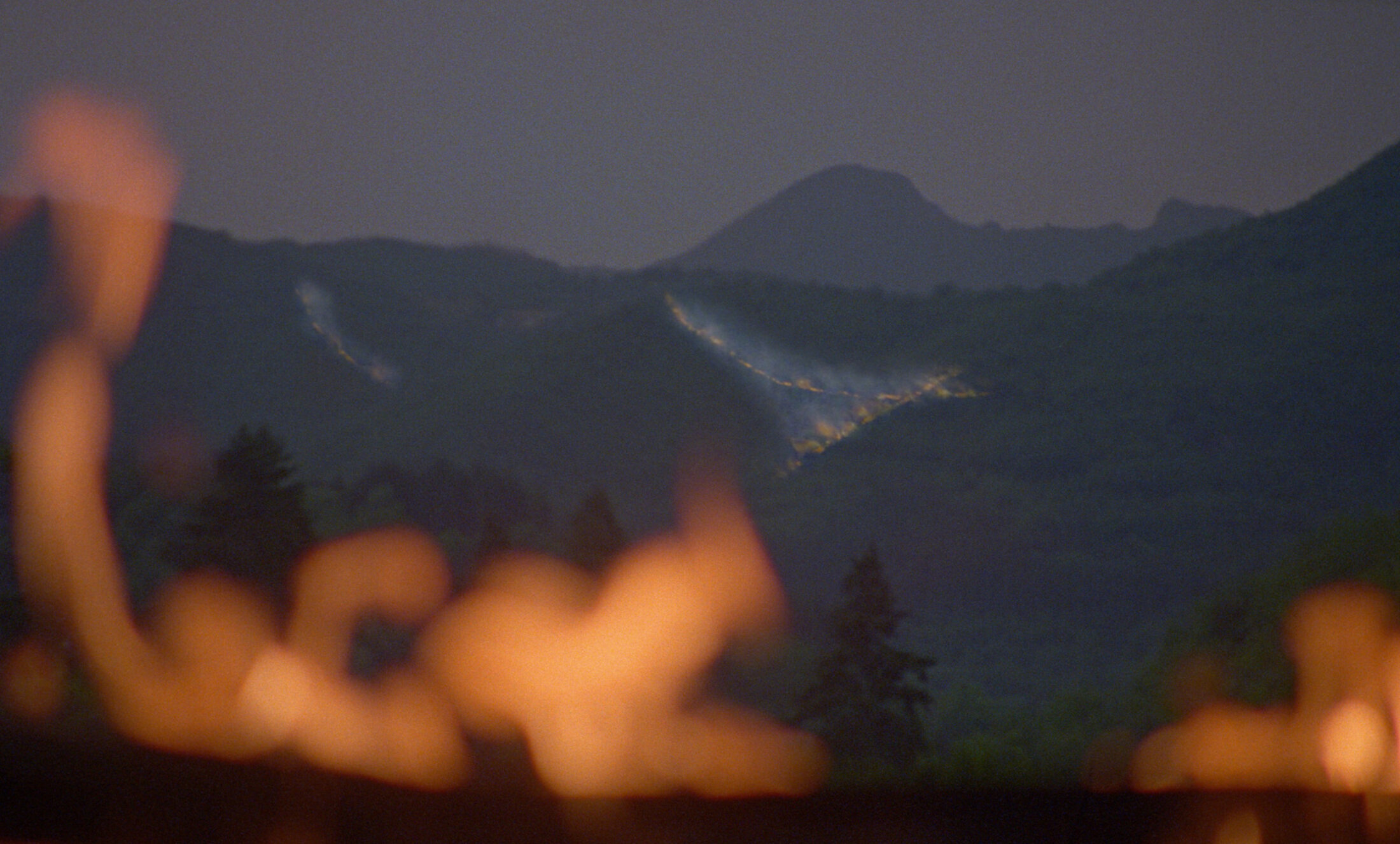
Genèse
Il y a quelques années, Elsa s’installe dans les Cévennes, dans une maison située dans une ancienne châtaigneraie qui n’a pas de clôture. La nuit, elle entend des bruits qui s’approchent de la maison : des sangliers. Un bruit qu’on entend la nuit, c’est pour la plupart des gens une menace, pas pour Elsa, qui y voit l’opportunité de questionner, avec un film, un certain nombre de normes sociales.
Histoire de la privatisation de l’espace
Le film débute avec la reconstruction fictionnelle d’une révolte paysanne du 16e siècle tournée en pellicule. Au Moyen-Âge, une utilisation commune et partagée des terres, y compris celles qui appartiennent aux seigneurs, est permise sous certaines conditions. Les villageois peuvent pour leur subsistance glaner du bois, chasser du petit gibier : les frontières de la propriété sont relativement souples. À la fin du Moyen-Âge, les terres sont progressivement clôturées, c’est le début d’un usage exclusif de la propriété par ceux qui la possèdent, ce qui engendre de fortes contestations paysannes. Elsa documente sa mise en scène en s’appuyant notamment sur le travail de Silvia Federici (Caliban et la Sorcière, 2004), qui s’intéresse à ce grand bouleversement et le lie à l’asservissement des femmes. Elsa imagine alors une révolte de femmes paysannes qui s’associent depuis la Forêt Noire, où vient d’être écrasée le Guerre des Paysans, jusque dans les Cévennes pour contester la fin des Communs.
La propriété privée aujourd’hui
Dans la seconde partie du film, alors que la nuit est tombée, Elsa met en scène une forme plus contemporaine de la propriété privée : la caméra de surveillance. Annie surveille un chantier en cours dans la forêt où ont eu lieu les luttes paysannes il y a plusieurs siècles.
Cette partie du film qui s’attache à faire sentir le quotidien de cette femme a été tournée en petite équipe, à son rythme, sur un temps long, dans la veine du travail de Pedro Costa.
Marginalisation des sangliers et rapports de propriété
Au moment où Elsa commence à étudier les sangliers pour préparer le film, une forte pression pèse sur eux, en raison de dommages causés par leur passage sur des propriétés privées. Les sangliers sont même qualifiés de « nuisibles », catégorie juridique désignant les animaux pouvant être détruits en-dehors des cadres règlementaires de la chasse. Elle mène un important travail de recherche historique et mythologique pour cerner les contours de cet animal et les retranscrire. La plupart des sangliers qui existent aujourd’hui sont issus de l’hybridation entre sangliers et cochons domestiques, provoquée par les humains. Cette hybridation commence dans les années 80 alors que les sangliers sont en voie de raréfaction et elle multiplie grandement leur nombre. Il existe un riche imaginaire du sanglier puissant, viril, solitaire, destructeur. Pourtant d’un point de vue éthologique, c’est un animal qui a un mode de vie pluri-matriarcal, qui se déplace en bande nocturne menée par les femelles. Face au paysage fragmenté par les clôtures qu’il traverse, face à des modes de vie diurnes, par le caractère « impur » de son hybridation, il interroge la peur de la nuit, de l’altérité et de l’invasion.
Un questionnement apparaît : qui aurait intérêt à se mettre du côté des sangliers ?
"Le conte est à la racine de l’oppression" (Edouard Glissant)
Dans un film qui oscille librement entre documentaire et fiction, il est question de révéler des histoires enfouies (littéralement dans le film, puisque les paysannes enterrent leurs revendications), souvent sans traces écrites, et de choisir ce que l'on raconte, de se réapproprier la narration.
Faire vivre le hors champ
Quelques mots sur le son pour terminer par ce qui a initié le film. Les Sanglières navigue entre continuités et ruptures. Le son ne fait pas exception et permet de lier les différentes parties du film, tout en apportant des éléments dissonants, comme par exemple l’avion qui surplombe Annie, qui tranche avec la première partie du film. À travers le travail sur le son, Elsa s’attache à faire vivre les hors champs et la nuit noire qui accueille la bande des Sanglières.
Avec pour point de départ son terrain de vie immédiat, Elsa explore l’histoire au sens large et lie les êtres et les paysages. Du bruit des pas de sangliers jusqu’aux luttes paysannes du 16e siècle, elle tisse des parallèles inédits, érige des ponts éclairants pour repenser les outils et les conditions de la contestation.
Charlotte Renucci
Le film sera projeté :
dimanche 23 mars à 18h30 au Reflet Médicis
jeudi 27 mars à 16h à l'Arlequin 1



