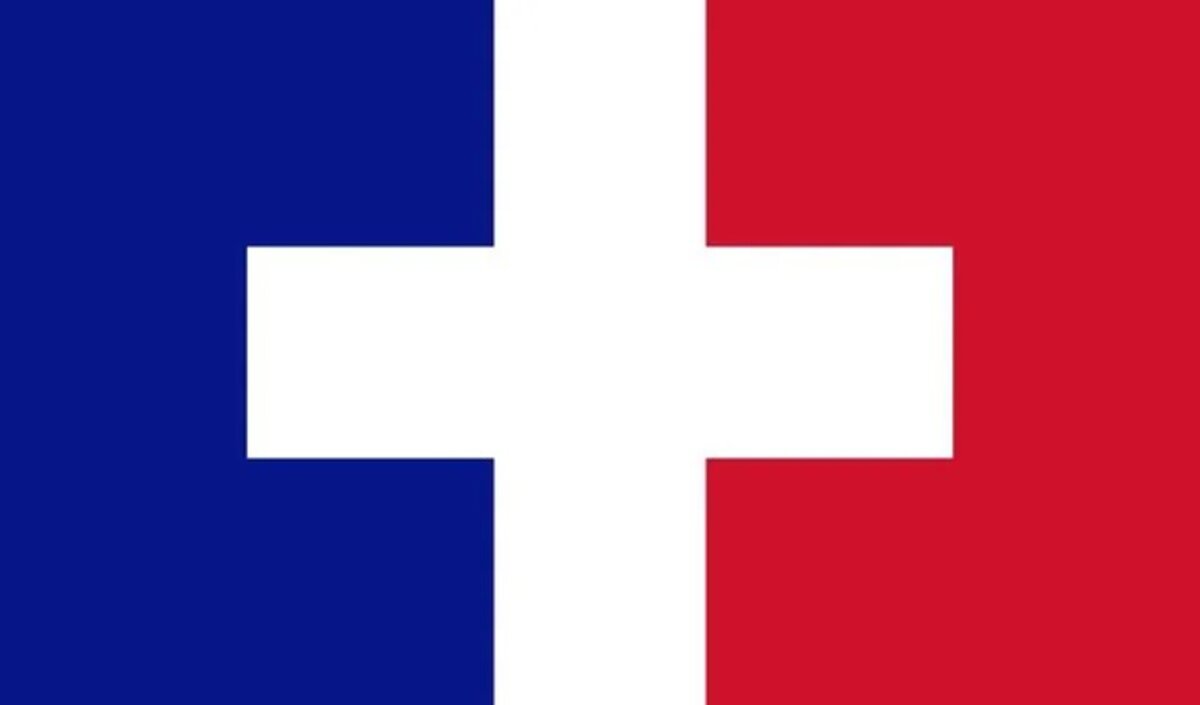
Agrandissement : Illustration 1
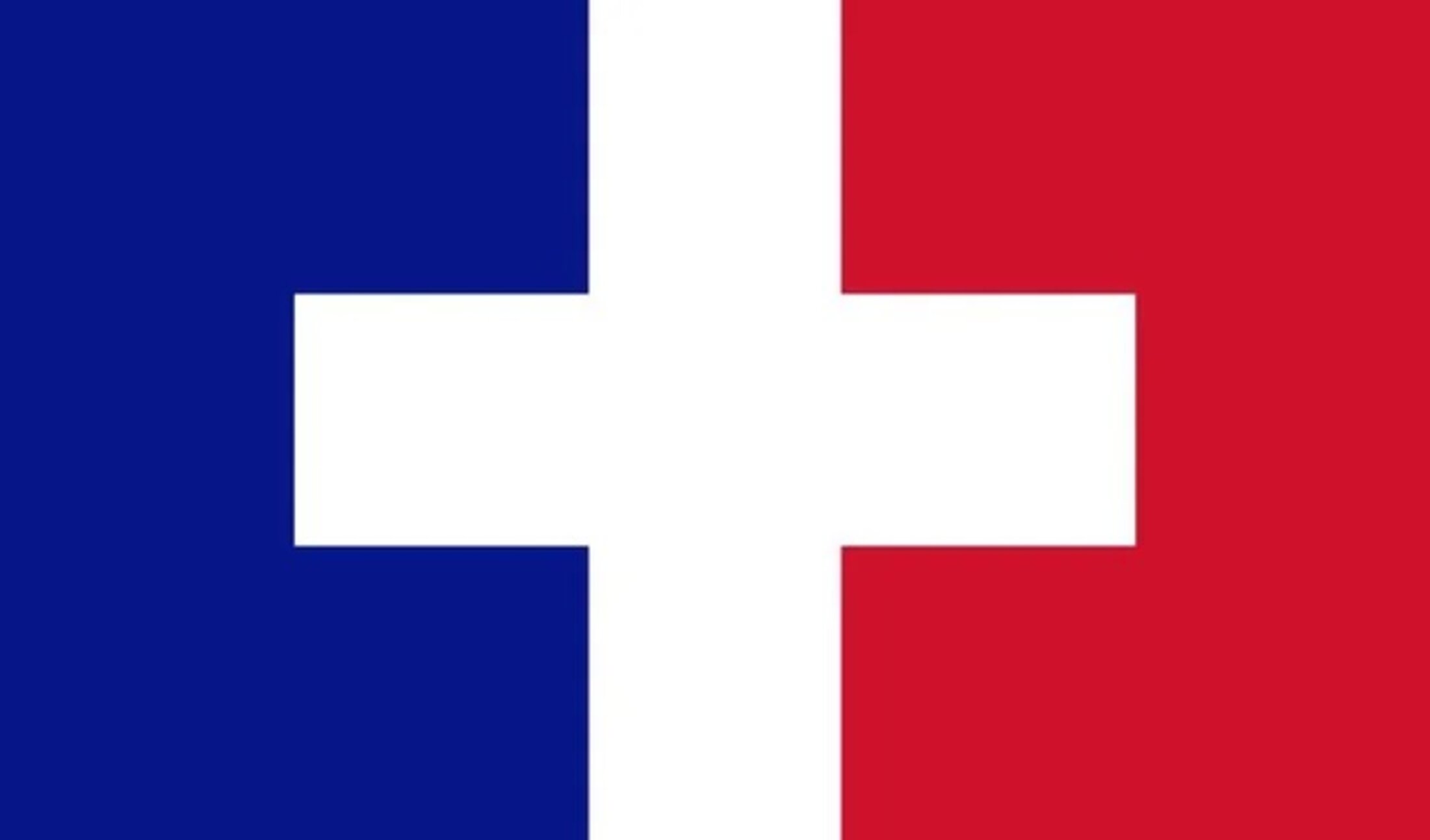
En est-il soulagé ou un brin vexé? Voire les deux? En tout cas, Jean-Louis Borloo échappe à la corvée de Matignon. Il n’aurait même pas reçu un coup de fil pour l’y harponner!
Sous une tempête de ricanements, c’est le pauvre Sébastien Lecornu qui s’y colle pour la seconde fois d’où son surnom donné par le Canard Enchaîné: « BisCornu ». Un sobriquet qui est appelé à un grand succès sur la Toile Vibrante des réseaux sociaux.
Cela n’empêche nullement Jean-Louis Borloo d’élaborer son programme au cas où s’ouvrirait la porte vers les plus hautes destinées. Il tient à diffuser ses idées en labourant en premier lieu le terrain des élus locaux et régionaux que le président Macron a sottement méprisé. L’ancien maire de Valenciennes y bénéficie d’une grande estime.
« Un Etat fédéral à la française »
Il fut ainsi la vedette de la Convention des intercommunalités qui s’est déroulée près de Toulouse, à Aussonne, du 8 au 10 octobre dernier et y a démontré qu’il avait de la Suisse dans les idées.
Selon Le Monde, « La priorité d’un gouvernement Borloo serait la réorganisation du pouvoir par l’instauration d’un Etat fédéral à la française, seule voie possible du redressement. Car on est au bout d’un système, analyse-t-il : « Nous sommes dans l’organisation publique la plus émiettée au monde.»
Et Le Monde de poursuivre citant toujours Jean-Louis Borloo: « Dans son idée, un Etat puissant, agile serait responsable de la sécurité, de l’équité territoriale, de la justice, de la recherche… Et le reste, c’est la province, a-t-il conclu, estimant l’amélioration de la performance à 120 à 150 milliards d’euros.
Le Plouc helvète qui vit en France depuis de nombreux lustres ne peut que saluer un tel objectif. Sa Suisse d’origine a largement démontré l’efficacité de son régime fédéral depuis des siècles. En France, la Confédération est systématiquement citée quand la question fédéraliste est posée. Or, elle l’est de plus en plus souvent.
L’émiettement centralisé
Il est vrai que l’architecture étatique de l’Hexagone donne le tournis, même aux Français. La concentration parisienne du pouvoir cohabite mal avec l’émiettement des instances en province(1) entre les compétences attribuées aux communes, communautés de communes, cantons, départements, régions. A l’excès de centralisation, la France administrative répond donc par l’émiettement, ce qui est moins paradoxal qu’il n’y paraît. On voulait l’ordonnance des jardins à la française, on obtient la jungle de l’inextricable paperasse.
Jongler avec les quadratures du cercle
Souvent, ces entités locales et régionales doivent jongler avec des quadratures du cercle (exercice qui exige une grande souplesse mentale pour éviter les déchirures cérébrales!) entre un Etat central généreux à leur endroit lorsqu’il s’agit de leur imposer de nouvelles charges et radins quant aux moyens alloués pour les assumer.
Paris apparaît donc comme un mauvais paysan qui charge sa mule sans lui donner de l’avoine(2).
L’avantage premier du fédéralisme est d’attribuer de façon claire et rationnelle, ce qui relève du national et du régional en attribuant à chaque niveau des charges spécifiques et les moyens pour les assumer.
A se demander pourquoi la France n’a pas adopté ce système au fil des siècles.
Et ne dites pas que la Révolution française aurait pu devenir fédérale si les députés girondins avaient triomphé des jacobins! Contrairement à ce que débitent les experts pour plateaux-télé et autres médiacrates, voire le président Macron lui-même, les Girondins n’étaient nullement partisans du fédéralisme.
868 ans de monarchie contre 165 ans de république
S’il existe aujourd’hui des royaumes avec des structures fédérales comme la Belgique et dans une certaine mesure l’Espagne, le fédéralisme croît plus aisément en climat républicain.
Or, si la fédéralissime Suisse n’a jamais connu de roi en 734 ans d’existence, la France, elle, reste marquée par son passé aussi royal que prestigieux.
Depuis Hugues Capet jusqu’à Napoléon III, elle a vécu pendant environ 868 ans sous un roi ou un empereur et seulement 165 ans en régime républicain.
La monarchie française n’a cessé de se développer en renforçant la centralité de son pouvoir dominé par la figure du Roi omnipotent, incarnation terrestre de la puissance divine.
L’organisation hiérarchique faisait du monarque le sommet de la pyramide avec une déclinaison de rapports entre suzerains et leurs vassaux jusqu’en bas de la pyramide où fourmillaient le petit peuple composé surtout de paysans qui faisaient vivre « ceux d’en haut ».
« La République une et indivisible »
Néanmoins, sous la monarchie, les villes et les provinces disposaient de privilèges, de franchises, de libertés, de nature fort différentes les unes des autres. Ce qui fit dire à Mirabeau que le Royaume de France était « un agrégat inconstitué de peuples désunis ».
La Révolution a fait voler en éclats ces disparités afin d’assurer l’égalité pour toutes les parties du pays. Elle aurait pu octroyer des pouvoirs semblables à chacun de ses département, leur assurant ainsi une égale autonomie. Ce n’est pas le chemin qu’elle a pris, craignant sans doute de fragiliser son principe de base: « La République une et indivisible ».
Surtout, la France révolutionnaire devait faire front uni face à toutes les monarchies liguées contre elle.
Ce mouvement centralisateur vient donc de loin et a imprimé toute l’Histoire de la France. L’amender en rendant fédérale la France constituerait une véritable révolution.
Les exigences du fédéralisme
Nombre de Français oublient sans doute que le fédéralisme n’a rien d’un moteur bien huilé dont les rouages fonctionneraient sans grincement. C’est un système particulièrement exigeant, comme l’explique fort bien le politicien suisse Markus Dieth, président centriste de la Conférence des gouvernements cantonaux dans cette interview. Exigeant à chaque niveau de la prise de décision politique mais aussi pour chaque citoyen.
Compte tenu du principe de subsidiarité(3) en oeuvre dans les pays à régime fédéral, les domaines de décision au niveau national sont restreints: armée, monnaie, diplomatie. Les autres domaines de l’activité humaine sont dévolus aux échelons intermédiaires. Même l’enseignement relève d’échelons plus régionaux avec des exigences minimales à respecter.
Non sans fortes nuances. Ainsi la Confédération finance-t-elle ses Ecoles Polytechniques Fédérales de Zurich et de Lausanne qui figurent régulièrement dans le classement des meilleures universités du monde. En revanche, ce sont les cantons qui constituent les sources principales du financement des universités et, bien entendu, des établissements primaires et secondaires.
En matière de santé et d’assurances sociales, la Confédération et les cantons se coordonnent. En outre, les cantons collaborent souvent entre eux pour gérer telle ou telle activité.
La sainte trinité fédéraliste
Il n’existe donc pas de schéma rigide en matière de fédéralisme. Sa sainte trinité: adaptation, souplesse, pragmatisme. Avec tout ce que cela suppose de discussions, de négociations, de coups de gueule suivis de réconciliations, de marchandage parfois, de compromis toujours.
Dès lors – suivez mon regard … – le responsable politique qui resterait crispé sur ses a-priori idéologiques, qui verrait dans chaque compromis une compromission ne fera pas longue carrière sous un climat fédéral!
D’autant plus, que ledit responsable est le plus souvent « à portée de baffe » de ses électeurs pour reprendre cette expression chère à Emmanuel Macron. Sans compter qu’en Suisse, tous les échelons la décision, même les plus élevés, sont « à portée de baffe » compte tenu des référendums et initiatives populaires.
Le droit de râler
Cela dit, pour le citoyen aussi, le fédéralisme est exigeant. De par cette architecture particulière du système fédéral – et même s’il vit dans un pays à la population nombreuse –, le citoyen se trouve plus proche de la décision. De ce fait, il est induit à en suivre les processus de façon plus directe.
Dans un pays centralisé, le citoyen en est forcément plus éloigné. Il subit les mesures prises « en haut ». Ce qui est à la fois frustrant et confortable. Frustrant car il se sent dépossédé. Confortable car il n’est pas impliqué.
Si son pays est ouvert à la liberté d’expression, il reste au citoyen le droit de pester tout à loisir contre cet « en haut » et – à l’instar du fourreur croqué par un poème d’Aragon – de se livrer « à cet amer plaisir-là: vitupérer l’époque » (consulter la vidéo ci-dessous).
L’écueil des roitelets régionaux
Pour devenir fédérale, la France devrait donc surmonter maints écueils. Il en est un de taille.
Le schéma de l’organisation féodale et les liens organisés entre suzerains et vassaux ont marqué d’une fleur de lys l’inconscient collectif des Français. S’en débarrasser avec le poids de ces presque mille ans de monarchie – l’une des plus puissantes de l’histoire mondiale – est tout sauf aisé.
Un fédéralisme à la française risque alors de reproduire ce schéma de suzeraineté avec des roitelets régionaux disposant de leurs vassaux. On se retrouverait donc, non pas face à une structure fédérale, mais a une sorte de « pluricentralisme » qui tournerait vite au cauchemar.
Pour éviter cet écueil, la Suisse a prévu la collégialité des exécutifs à tous les niveaux, y compris l’échelon du gouvernement fédéral. Pas d’homme providentiel en ces lieux! Ce qui irait aussi à l’encontre d’un fort sentiment qui court tout au long de l’Histoire de France.
Les Français accepteraient-ils d’assumer les exigences du fédéralisme? Personne ne peut répondre à leur place. Mais il faudrait qu’ils acceptent d’assumer un profond bouleversement dans leurs habitudes.
Jean-Noël Cuénod
1 Oui je sais, ce n’est pas bien d’appeler province, la province! Il faut dire « les territoires » ce qui ne veut rien dire. Paris aussi est un « territoire ». Donc je continuerai d’appeler province la province!
2 Il est vrai que les paysans se font rares à Paris entre deux crises agricoles. Même si Aragon en avait trouver un, jadis.
3 Terme qui est plus en usage dans l’organisation ecclésiastique du catholicisme romain qu’en matière de droit constitutionnel suisse.



