Régime trop gras :
C’est le régime du gaspillage…
En quoi consiste-t-il plus précisément ?
D’après les historiens François Jarrige, Thomas Le Roux :
« Les restes sont devenus déchets lorsque les logiques de réutilisation ont disparu au profit du rejet, à mesure que le pouvoir d’achat des populations augmente et que les produits fabriqués deviennent composites, c’est-à-dire difficilement réutilisables pour d’autres emplois sans une complexe transformation. Alors que les objets étaient globalement fabriqués afin de répondre à des besoins précis et localisés, leur production industrielle pour un marché de plus en plus global n’a cessé d’accentuer le gaspillage, jusqu’à faire de ce dernier un élément fondamental des dynamiques du capitalisme. »[1]
Il s’en est suivi une altération du métabolisme socio-économique :
« Les processus métaboliques sociaux commencent avec l'appropriation par les êtres humains de matériaux et d'énergie prélevés dans la Nature. Ceux-ci peuvent être transformés et circuler pour être consommés, éventuellement réutilisés et enfin excrétés de nouveau vers la nature.
Chacun de ces processus a un impact écologique différent selon la manière dans laquelle il se réalise, selon la quantité de matériaux et d'énergie impliqués dans le procédé, la zone où il se produit, le temps disponible ou la capacité de régénération de la nature. »[2]
Les conséquences, nous les vivons au quotidien ; mais nous n’avons pas encore engagé des actions significatives pour enrailler ce régime mortifère.
Régime trop salé :
Quand une situation particulièrement déséquilibrée socialement persiste. Quand cette situation reste à un tel point en suspens, sans issue… Il se forme un environnement favorable à l'émergence de conflits et de son développement.
Il existe différents niveaux de dérèglement social[3] :
Le niveau de base, dit latent. Il n’a pratiquement pas d'impact sur la stabilité sociale Il est caché dans le subconscient des individus.
Dans un deuxième niveau, certains changements se produisent, mais les tensions sociales qui en résultent surgissent et disparaissent dans la foulée.
Le troisième niveau plus profond est suffisant pour « briser les mécanismes adaptatifs précédents et les relations. Il affecte de manière significative la vie publique. »
Et le dernier niveau est ancré dans le déréglement. Il implique « la perturbation mondiale des communautés et des institutions sociales. » Nous l’avons atteint depuis plusieurs décennies … C’est le régime de crise permanente, qui s’amplifie, jusqu’au paroxysme.
L'historien Ernest Moret prévient : « L’ordre existant ne peut offrir de solution à la crise climatique. »[4]
Que le capitalisme existe n’est pas vraiment un problème en soi ; il faut de tout pour faire un monde… Mais, qu’il soit devenu un mode de gouvernance hégémonique ; ce n’est évidemment pas anodin. La crise écologique est la face, de moins en moins, cachée du capitalisme.
« La capacité du capital à déplacer la rupture métabolique est stupéfiante. On peut donc se demander si l’augmentation des prix due à la « fin de la nature bon marché » conduira réellement à la « crise d’époque » du capitalisme, comme l’affirme Jason W. Moore (2020, p. 27). »
Vers un régime plus équilibré :
Se jouer des tensions sociales est, bien évidemment, une très mauvaise idée… Qui en douterait ?
Poursuivre bêtement ce régime politique trop gras et trop salé est la pire des options actuelles ! C’est pourtant celle qui est jusqu’alors poursuivie…
Nous connaissons les principes d’équilibre politique

Agrandissement : Illustration 1
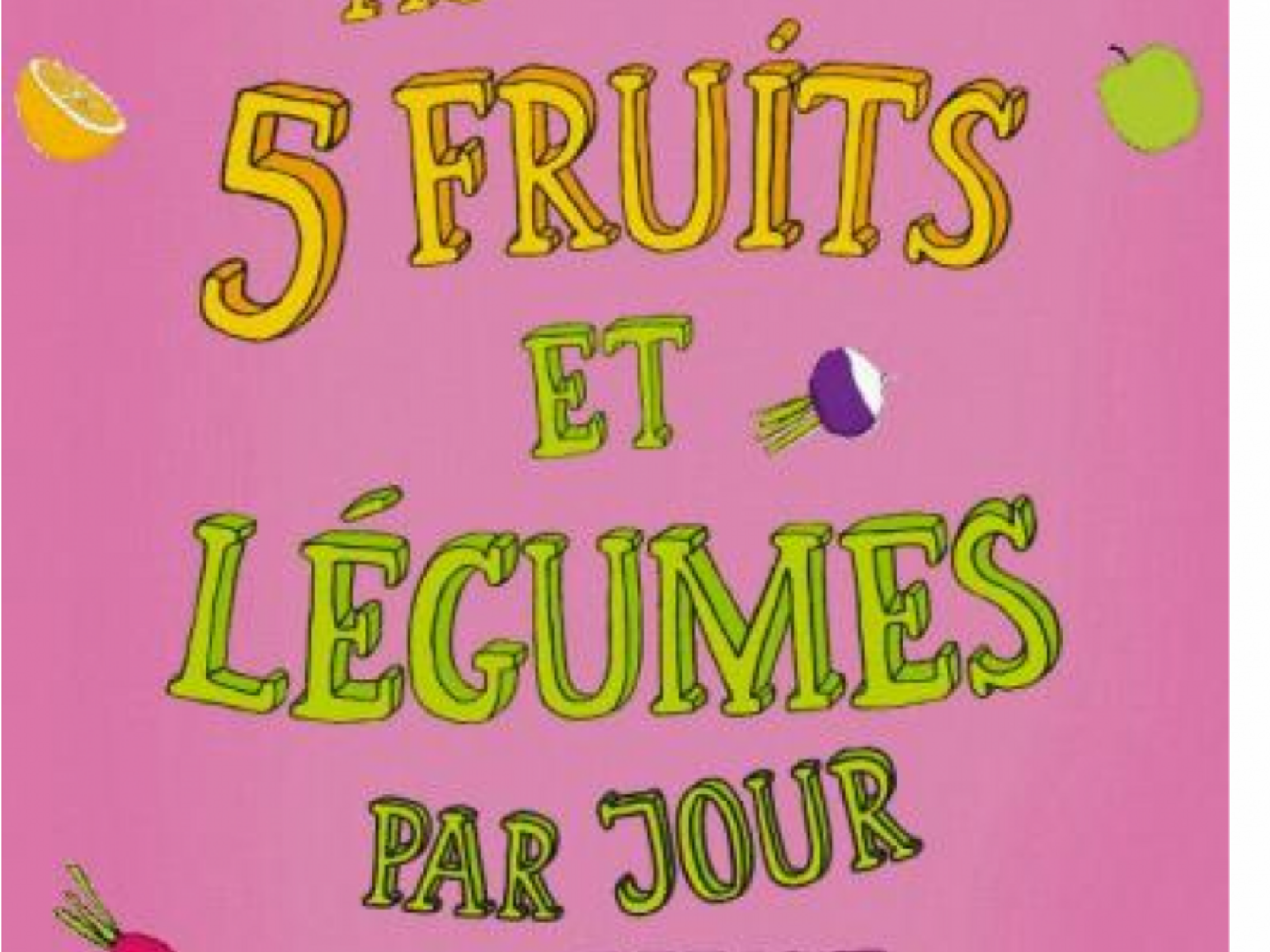
qui supposent la séparation constitutionnelle des pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire. Il nous faut, bien évidemment, non seulement veiller à toute tentative régulière de déroger à ces principes démocratiques ; mais aussi engager des réformes politiques pour réduire les risques.
Notamment en déprofessionnalisant l’activité politique. Une piste évidente est l’institutionnalisation de l’implication directe des individus dans la vie publique, à la manière de la nomination des jurés d’assise. Cela transformerait la démocratie représentative, aujourd’hui totalement malade, en démocratie plus directe.
Mais, ce n’est pas tout.
Il faut travailler avec rigueur et détermination sur les conflits d’intérêt qui gangrènent totalement les régimes politiques actuels, à toutes les échelles : locale, nationale et internationale.
C’est devenu le sport de prédilection, qui permet aux intérêts privés de phagocyter les biens communs, avec les conséquences que l’on connait…
Les régimes politiques actuels pourrissent du fait que le conflit d’intérêt, qui est la première marche vers la corruption, est devenue une règle. Ce stade gangétique peut être vu comme la phase terminale de la crise du capitalisme.
Comme toute règle, cette règle peut être changée aux vues d’intérêts collectifs plus sérieux.
Quelle société peut survivre à la généralisation de la destruction de sa cohésion sous le coup d’une corruption généralisée ?...
[1] L’invention du gaspillage : métabolisme, déchets et histoire, François Jarrige, Thomas Le Roux Dans Écologie & politique 2020/1 (N° 60), pages 31 à 45
[2] Métabolisme social : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tabolisme_social
[3] Les tensions sociales dans la société : http://fr.nextews.com/65c11124/
[4] La théorie du métabolisme chez Marx à l’ère de la crise écologique mondiale, Kohei Saito
Traduction de Ernest Moret, p. 161-182



