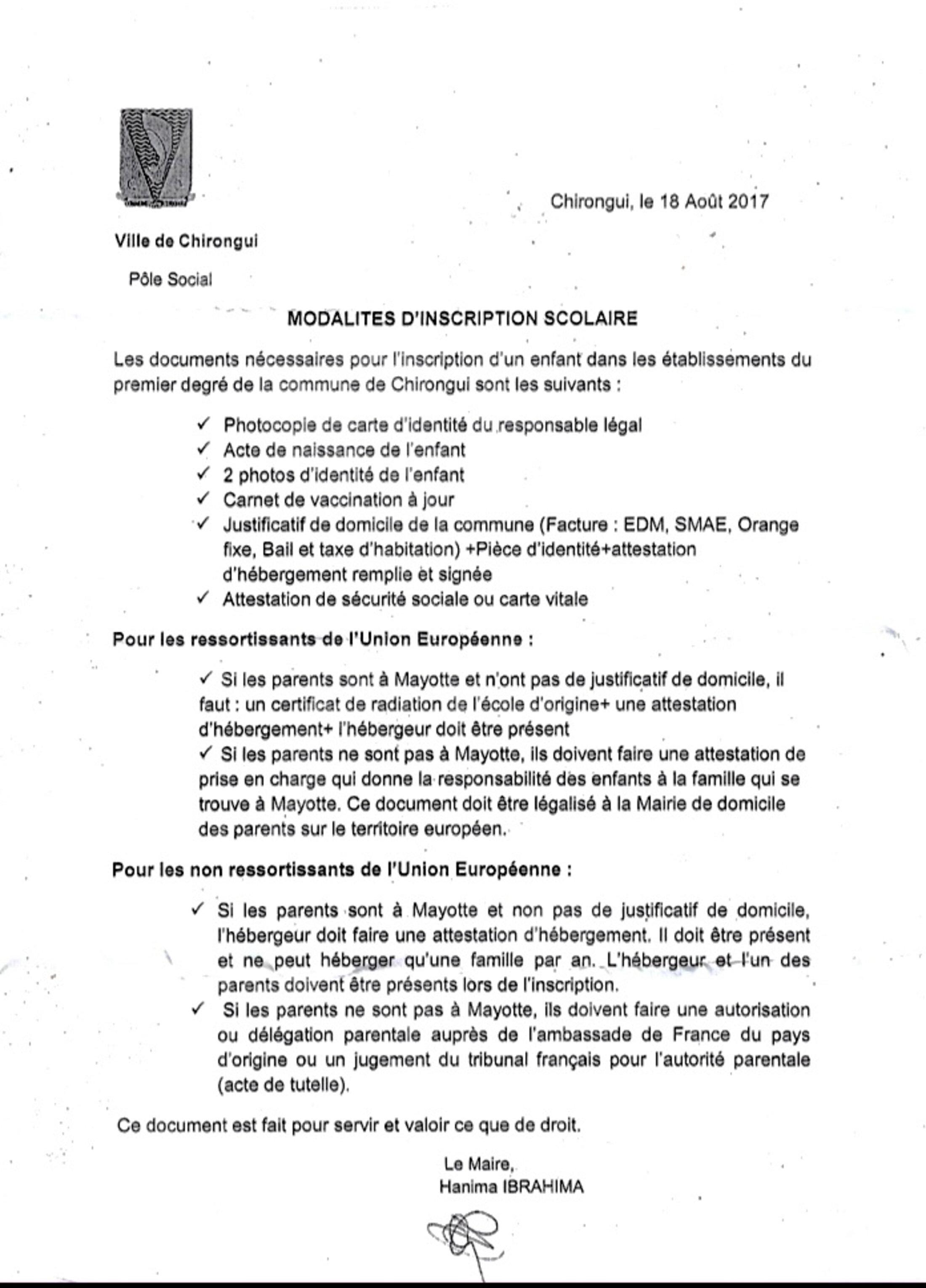Agrandissement : Illustration 1

Depuis trop longtemps déjà, les élus de Mayotte, de compétence locale ou nationale, ont adopté une stratégie stupéfiante pour réduire l’immigration. Ils ont pris le parti de cibler les enfants des familles « étrangères » [1] . Ainsi de la naissance à l’âge adulte, l’enfant est-il devenu officiellement le point d’attaque pour atteindre les familles et les décourager de venir s’installer dans la terre française, devenue département en 2011.
Présupposant que le motif principal du voyage entre les îles se réduit au projet d’assurer à sa descendance la nationalité française, l’accès aux soins et les bénéfices de l’école républicaine, tout responsable politique sans exception se creuse la tête pour restreindre le droit à la nationalité et l’accès à l’école.
La notion d’appel d’air obnubile les discours politiques anti-migratoires comme une invitation à mettre à jour la logique à l’œuvre dans le projet d’installation. Il est pourtant illusoire de chercher dans les avantages comparatifs entre la France et l’Union des Comores celui qui prévaudrait et le traiter pour en finir une bonne fois pour toute avec cette question. A force de tirer le fil de la pelote, la seule conclusion qui vaille mettrait plus sûrement en cause la présence d’un pays riche de l’hémisphère nord au sein d’un ensemble géographique du Sud parmi les plus pauvres du monde (entre Madagascar et les Comores).
A cet égard, il convient de relativiser les prétentions françaises et rappeler que le taux de pauvreté, excessivement élevé à Mayotte [2], atteint 84% de la population. Dans ces conditions, qui peut méconnaître que les conditions de vie y seront très difficiles ?
Qu’importe ! La question politique lancine les esprits : comment s’y prendre pour les durcir davantage ? Les réflexions se focalisent sur la question de nationalité en vue de ruiner les promesses d’avenir radieux au principe du projet migratoire.
Si l’immigration est l’effet du souhait d’accoucher à Mayotte d’un enfant « français » par la magie du droit du sol, il suffit de contester celui-ci. Seront réglées par voie de conséquence la pression démographique, ses incidences sur la question scolaire, et les problèmes de sécurité liés à la délinquance adolescente et juvénile, attribuée comme partout dans le monde à la présence des étrangers.
La question de la maternité
D’après l’INSEE [3], la part des naissances de mère de nationalité « étrangère » s’élève à 74% ; la moitié des nouveau-nés sont de père « étranger » ; 42 % des bébés sont issus de deux parents non français. Ce dernier chiffre correspond à peu près à la proportion de la population dite « étrangère » à Mayotte. Ces statistiques « effarantes » soulignent l’urgence du traitement politique.
Dans une tentative désespérée de trouver des solutions au problème « d’immigration massive », Madame la ministre des Outre-Mer avait envisagé en mars 2018, lors d’un passage express dans un territoire enflammé, un statut d’extraterritorialité pour la maternité de Mayotte, dans le but avoué de priver les nouveau-nés des bénéfices du Droit du Sol. [4]
Pourtant, ces statistiques peignent un tableau bien plus serein de la situation. Une lecture réjouie des chiffres relève simplement que la majorité de la population entretient des relations normales avec les ressortissant des autres îles de l’archipel et n’hésite pas à fonder un ménage « mixte » sans que cela ne pose de problème de voisinage ou de famille. Les gens sont enclins à s’allier, à s’aimer, à fonder ensemble une famille malgré les stigmatisations incessantes, les discours et pratiques hostiles et brutales de certains activistes tolérés par l’État.
La vision optimiste aiderait pourtant à comprendre pourquoi les mêmes qui prennent les étrangers pour cible, organisent eux-aussi comme les plus pacifiques, la migration de leurs relations et de membres de leur famille des autres îles, leur fournissent du travail tout en les exploitant dans un échange de bons procédés convenus entre les deux parties ; les hébergent sans bail dans le logement « indigne » qu’ils leur facturent ; épousent les jeunes femmes disponibles dans une persistance socialement acceptée d’une polygamie à présent interdite et leur font des enfants au grand dam de l’épouse actuelle supportant difficilement les rivales. Les traditions ancestrales ont la vie dure. Dans cette ambigüité se cachent probablement les ressorts de la question migratoire telle qu’elle est posée sur l’île. Par paresse intellectuelle mais surtout parce qu’il est facile de gouverner une société divisée, l’État français s’assure la mainmise sur Mayotte en jouant sur les nationalités, l’accordant à certains, la contestant à d’autres.
La question de l’État-civil.
L’hypothèse de l’extraterritorialité de la maternité a fait long feu. Il eût été piquant que l’État français cédât sa souveraineté sur l’hôpital après avoir bravé les lois internationales pour conserver l’île de Mayotte. L’essentiel sera atteint par d’autres voies. Et vivement, sans laisser le temps à la réflexion.
Alors qu’au mois de mars, un député de la République En Marche déclarait que « la remise en cause du droit du sol n’est « pas du tout ce que souhaite faire le gouvernement [5] », la dernière loi sur l’immigration votée en juillet 2018 a miné le droit du sol pour les enfants de Mayotte, ou plus précisément le supprima à quelques réserves près.
En effet dorénavant, tout enfant né à Mayotte de parents étrangers bénéficiera des conditions communes d’accès à la nationalité en vertu du droit du sol et conditions de résidence, si et seulement si trois mois avant sa naissance, un au moins des parents était titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Mention sera apposée dans l’état-civil lors de la déclaration de l’enfant.
La tenue de l’état-civil à Mayotte est une pratique récente innovée durant le processus de départementalisation de l’île initié en 2001, après attribution du statut de collectivité départementale [5] . Pris en charge jadis par le tribunal cadial, l’État-civil fut transféré à la mairie de la commune. L’ensemble de la population fut alors appelé à renoncer au statut de droit local pour le statut commun dans la République. Ce processus de mise en conformité républicaine revêtit une importance capitale dans la mesure où l’appartenance individuelle à la France, et l’acquisition de la nationalité française, se réalise au prix d’un renoncement au statut traditionnel. Puisqu’il importe de distinguer parmi la population vivant à Mayotte les membres relevant du statut de citoyen français et les autres, l’État organisa une déclaration d’allégeance implicite dont parvinrent à se débrouiller les personnes informées et accompagnées.
Aujourd’hui, la grande majorité des actes d’état-civil est truffée d’erreurs, sur les dates de naissance souvent approximatives, sur les patronymes ou les prénoms (les traditions généalogiques locales et françaises n’étant pas compatibles), et même sur les lieux de naissance. Sans compter les fautes d'orthographie. Des jeunes gens nés à Mayotte ne sont pas parvenus à ce jour à obtenir un acte corrigé dans leur démarche de déclaration de nationalité. Bien que nés à Mayotte, ils continuent à l’âge de 25 ans ou plus à vivre sans la moindre pièce d’identité, souvent découragés par la lenteur et la répétition des mêmes demandes de correction de leur acte, au tribunal et à la mairie. Avec les risques que l’on sait d’être interpelés, retenus au Centre de rétention administrative et même renvoyés aux Comores dont ils ne connaissent rien ni personne.
Dans le courant de l’année 2018, pris de panique, s’amusant à se faire peur, député et sénateur de Mayotte ont proposé à la va-vite des amendements à une loi censée favoriser une bonne intégration [6]. Désireux sans doute de complaire à leurs électeurs emportés par un courant xénophobe pressenti, ils sont parvenus à entraîner le parlement et le gouvernement dans l’infamie et l’indignité. Probablement fins connaisseurs des subtilités de l’île, ils n’ont pas pris la peine de s’interroger sur la faisabilité pratique de leurs propositions. Ils n’ont pas manifesté le moindre souci de l’avenir des enfants de Mayotte qui à leur majorité, étrangers dans leur pays natal, devront solliciter un document d’identité auprès d’un État étranger à leur naissance, leur enfance et leur culture.
Qu’importe en fait. Toutes ces manœuvres dilatoires ne font qu’ajourner et compliquer une appartenance inaliénable à la France. Leur destin rassemblera somme toute à celui des jeunes gens arrivés à Mayotte avec leur mère dans les embarcations de fortune au nom dansant de kwassakwassa. Une fois atteint l’âge de la majorité, ils devront demander l’autorisation de vivre sur le territoire, droit que l’administration traînera à instruire, les retenant dans une situation de clandestinité alors qu’ils avaient jusque-là totale liberté de circulation et retardant de façon indue leur insertion professionnelle et sociale. Mais à terme, ne pourront leur être refusés ni le droit de séjour, ni la naturalisation, ni la nationalité en tant que frère ou sœur de français, toutes les dispositions du droit commun.
Aucun scrupule ne tempère l’imagination des élus de Mayotte quand il s’agit des questions de nationalité. Les fameuses opérations de « décasages » survenues en 2016 fournissent un exemple de déplacement forcé de populations « étrangères » jugées indésirables [8] sans émouvoir les autorités tacitement complices jusqu’au plus haut niveau de l’État [9].
Les municipalités se sont repliées sur un stratagème qui avait déjà fait ses preuves pour éloigner les populations « étrangères » sans trop choquer la conscience de leurs administrés : durcir les conditions d’inscription à l’école de sorte de gêner, et si possible empêcher, la scolarisation des enfants de familles « étrangères » et leur installation sur leur territoire. Toutes ont édité des listes de pièces à fournir lors de l’inscription des enfants à l’école impossibles à rassembler par les parents étrangers, mais plus généralement, compte-tenu de la situation économique de Mayotte, la plupart des familles pauvres. Ainsi espèrent-elles que les familles visées déménageront vers des communes plus accueillantes. Hélas toutes surenchérissent.
La ville de Chirongui, un exemple parmi d’autre non pris au hasard[10], a dressé une liste en 2017 qui n’a pas été réactualisée l’année suivante, dans laquelle le terme étranger n’est jamais employé ni celui de titre de séjour. Le document en trois parties (voir à la fin du texte) énumère les différentes pièces exigées pour tous, puis celles propres aux ressortissants de la Communauté Européenne, et enfin celles des non-ressortissants. Le langage euphémisé ne masque pas les sous-entendus : la population de l’île minuscule se compose essentiellement d’un groupe culturellement homogène distingué par une assignation d’identité sur laquelle il convient de jouer en vue de politiques d’exclusion assumées.
Pour inscrire son enfant dans une école de la commune de Chirongui sont donc requises les pièces suivantes :
- La photocopie de la carte d’identité du responsable légal
- L’acte de naissance de l’enfant
- 2 photos d’identité de l’enfant
- Le carnet de vaccination à jour
- Justificatif du domicile dans la commune, la pièce d’identité du logeur, et l’attestation d’hébergement.
- Attestation de sécurité sociale ou carte vitale.
Il est précisé aux familles « non ressortissantes de la Communauté Européenne » que « si les parents sont à Mayotte et n’ont pas de justificatif de domicile, l’hébergeur doit faire une attestation d’hébergement. Il doit être présent et ne peut héberger qu’une famille par an. L’’hébergeur et un des parents doivent être présents lors de l’inscription. »
Ce document municipal outrepasse les conditions habituelles d’inscription des enfants à l’école limitées à la présentation de l’acte de naissance et du carnet de santé de l’enfant. L’exigence des autres pièces complique sans raison la situation des familles pauvres. Logées dans des logements « indignes » par des logeurs non déclarés, elles sont conduites à négocier les « adresses » alors que la preuve de domiciliation sur le territoire de la commune peut être apportée par n’importe quel moyen.
L’attestation de sécurité sociale, demande elle-aussi abusive, vise à discriminer les familles en situation irrégulière qui n’ont pas accès à ce document. Les autres municipalités sont plus directes qui demandent carrément la présentation de la carte de séjour. Ce qui est contraire aux règles et principes de la République.
Dans une société en plein bouleversement dans ses identités et ses traditions, objet de l’imposition drastique d’un état-civil, il est illusoire de viser un type de population sans atteindre l’ensemble des familles, déconcertées, peu instruites des méandres des administrations d’un vieil État éloigné par la géographie et l’histoire.
Suite aux opérations de décasages menées tambours battant, au sens propre, dans les communes de brousse, les populations déplacées de force se sont repliées en masse sur le chef-lieu de Mamoudzou et la commune de Koungou. Ces municipalités ont dû faire face à une demande de scolarisation imprévue. La réaction de la ville de Mamoudzou fut brutale : les familles dans l’incapacité de fournir une preuve de domicile à leur nom doivent impérativement présenter un avis d’imposition mentionnant leur adresse. Il est ajouté qu’aucune attestation d’hébergement de particulier ou d’associations ne sera admise.
Le service des impôts a réagi à sa manière. Dans un premier temps, par affichage, il informe que l’avis d’imposition ne saurait constituer une attestation de domicile. Ensuite il a purement et simplement fermé ses portes et ne reçoit que sur rendez-vous préalablement sollicité par texto ou par courriel. Pour obtenir la feuille de déclaration de revenus, le contribuable est invité à le télécharger sur le site impôts-point-gouv. Les « cybers » assiégés facturent entre 3 à 10 € le document en principe imprimé par l’État et distribué gratuitement dans les services ouverts au public. Pour preuve de domicile, le service des impôts exige quant à lui que l’attestation d’hébergement d’un particulier soit accompagnée du relevé cadastral et du plan d’architecte du logement.
En définitive de nombreux enfants ne sont pas scolarisés à Mayotte. Des associations disséminées dans les quartiers pauvres du Grand Mamoudzou tentent de les accueillir et de dispenser un minimum des savoirs fondamentaux, mais échouent à obtenir des édiles municipaux la scolarisation de tous les enfants vivant sur leur territoire.
Ni les mairies, ni l’État, ne se donnent les moyens de dénombrer les enfants sans école. Cette indifférence atteste une volonté de nuire sur ce point sensible, une volonté implicite ou assumée de « pourrir » la vie des familles pauvres.
Il incombe pourtant à tout responsable, chacun à son niveau, d’assumer les charges de sa fonction dans le respect des principes républicains : d’abord compter ; ensuite résoudre.
Car tous bien-sûr connaissent les articles du Code de l’Éducation. L’article L. 131-5 stipule que : « la domiciliation des parents à l’étranger ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde. Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire ».
Sont ensuite détaillées dans l’article L. 131-6 les responsabilités du maire et des familles : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont sous obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la charge. ».
Mais de cela, il ne peut être question. L'obligatoire scolaire, récemment baissée à l'âge de trois ans, donne de l'espoir aux mères revendicatrices. Qu'en sera-t-il réellement ?
Mayotte est décidément un département à part, une sous-France, disent les jeunes non dépourvus d'humour.
---------------------------------------
Notes
[1] Par parti pris et pour des raisons qui apparaitront petit à petit dans ce billet, le terme « étranger » sera systématiquement mis entre parenthèses.
[2] Même si la comparaison est abusive sous certains aspects, rappelons que la part de la population vivant sous le taux de pauvreté nationale aux Comores s’élève à 44%.
[3] INSEE Flash Mayotte N° 54 Août 2017, et Populations et Sociétés, INED, N° 560, novembre 2018
[4] Mayotte : donner un statut international à la première maternité de France est-il réaliste ? Le Monde, 14 mars 2018.
[5] On peut lire à ce sujet : Myriam Hachimi Alaoui, "Françaises et Français de Mayotte. Un rapport inquiet à la nationalité", dans Politix 2016/4 (n° 116), pages 115 à 138 .
[6] La loi dite « « Pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie » a été définitivement adoptée le 1er août 2018, jugée conforme par le Conseil Constitutionnel le 6 septembre 2018, promulguée le 10 septembre et publié dans le Journal Officiel le lendemain.
[7] Pour une analyse détaillée de cette question, lire : Daniel Gros, « Privés d’école » dans Mayotte à la dérive Plein droit, n° 120, 03/2019, pp. 28-31
[8] Ni les malgaches, ni les africains ne semblent avoir été alors concernés.
[9] Myriam Hachimi Alaoui, Élise Lemercier et Élise Palomares, « Les « décasages », une vindicte populaire tolérée », dans Mayotte à la dérive, Plein-Droit n° 120, 03/2019, pp. 20-23. https://www.gisti.org/spip.php?article6127
[10] Le document de la commune de Chirongui a été choisi comme exemple pour trois raisons : le document tente de masquer sa cible sous la distinction aseptisée « ressortissants ou non de l’’Union Européenne, juridiquement recevable mais localement impropre ; Chirongui a été l'une des communes les plus actives dans les opérations de décasages, avec ses voisines Boueni et Kani-Kéli ; sa Maire est d’autre part présidente de l’association mahoraise Mlezi Maore dont une des missions est précisément « d'assurer une fonction de protection de l’enfance en milieu ouvert par la mise en œuvre d’un accompagnement socio-éducatif auprès de mineurs de 0 à 18 ans ». Cela-dit le document de chaque mairie supporte la même démonstration d’une volonté manifeste de mise à l’écart de l’école des enfants de familles étrangères.
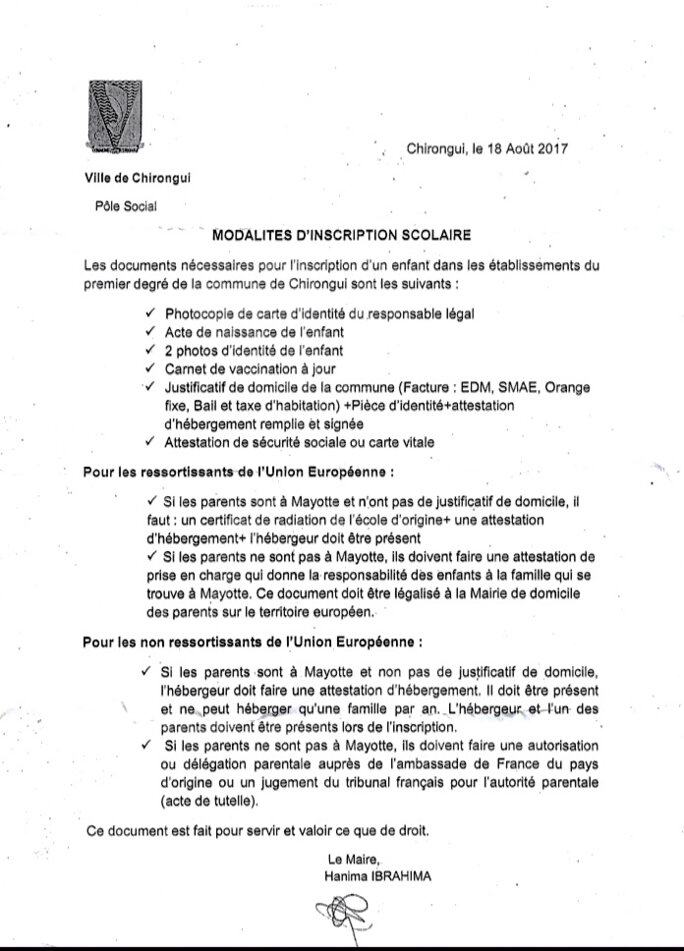
Agrandissement : Illustration 2