-- “La Russie contre la modernité”, expliquez-nous l’essence de cette confrontation.
-- C’est une confrontation nouvelle. Bien sûr la Russie a toujours eu des problèmes avec la modernité, au 18ème siècle déjà, et encore au 19ème, mais cette fois-ci c’est la modernité elle-même qui apporte cette nouveauté. C’est le résultat direct de la crise climatique et maintenant s’y ajoutent le covid et d’autres menaces d’origine naturelle. La “nouvelle” modernité est la réponse directe au conflit entre la société et la nature. Dans les siècles précédents la nature nous apparaissait inépuisable, on pensait pouvoir la posséder et la dominer indéfiniment, mais nous voici maintenant au fond d’une impasse.
Pourquoi la Russie s’oppose-t-elle à cette nouvelle modernité ? Simplement parce qu’elle dépend entièrement de l’exportation de ses matières premières carbonnées, qu’on appelle plus précisément énergies fossiles. N’importe quel programme de transition énergétique prive la fédération de Russie de ses revenus habituels. Voilà en quoi réside l’essence de cette opposition, tout le reste n’est rien d’autre que les diverses conséquences de cette opposition.
-- Vous écrivez que le monde d’avant, c’est le monde du Léviathan, et que celui d’aujourd’hui, c’est celui de Gaïa. L'hypothèse Gaïa est une hypothèse séduisante selon laquelle toutes les formes de vie sur la Terre forment un super-organisme qui assure l’existence de la planète. Vous croyez en cette idée ?
-- Oui j’y crois et je l’enseigne depuis quelques années. Sous sa forme actuelle cette idée a été formulée par le grand philosophe récemment disparu Bruno Latour. Bien sûr elle possède un caractère partiellement métaphorique, mais aussi en partie littéral. Et ce caractère littéral grandit à mesure que nous intensifions nos multiples confrontations avec la nature. La Nature-Gaïa s’anime et commence à résister, à porter des coups pour se défendre à mesure que nous approchons de ses limites, qui sont les limites du développement économique planétaire.
-- Vous énumérez en les séparant par une virgule les défis écologiques, de santé, sociaux, de genre et culturels et vous les liez à la guerre actuelle. Expliquez-nous ce lien.
-- L’intellectuel et historien de l’économie Adam Tooze a développé le concept de polycrisis, devenu populaire et je dirais même dominant. Il dessine de grands polygones qui mettent en évidence l’union et l’intersection de différentes crises et leur transformation en une seule et unique grande crise.
Il s’ensuit que parmi ces différentes crises il n’y en a pas une qui serait première, une autre seconde et une autre troisième, mais qu’elles sont toutes aussi importantes l’une que l’autre, qu’elles se développent en même temps et se renforcent l'une l'autre en formant un cercle vicieux. En ce sens la guerre ne serait qu’un nouveau côté de ce polygone complexe.
Je suis d’accord avec l’essentiel de tout cela, mais il me semble que ce polygone doit bien reposer sur quelque chose, que ce quelque chose est son fondement, que quelque chose de secondaire doit découler de ce qui est au principe. Pour comprendre ce qu’il faut faire avec cette polycrisis et par quoi commencer, il faut comprendre sur quoi elle repose. Il faut hiérarchiser les problèmes, il faut comprendre quelle crise est la principale et comment elle engendre les autres. Je pense que la crise principale est la crise climatique, s’ensuivent les efforts de décarbonation de l’économie, de nouvelles formes d’inégalité et plein d’autres choses encore.
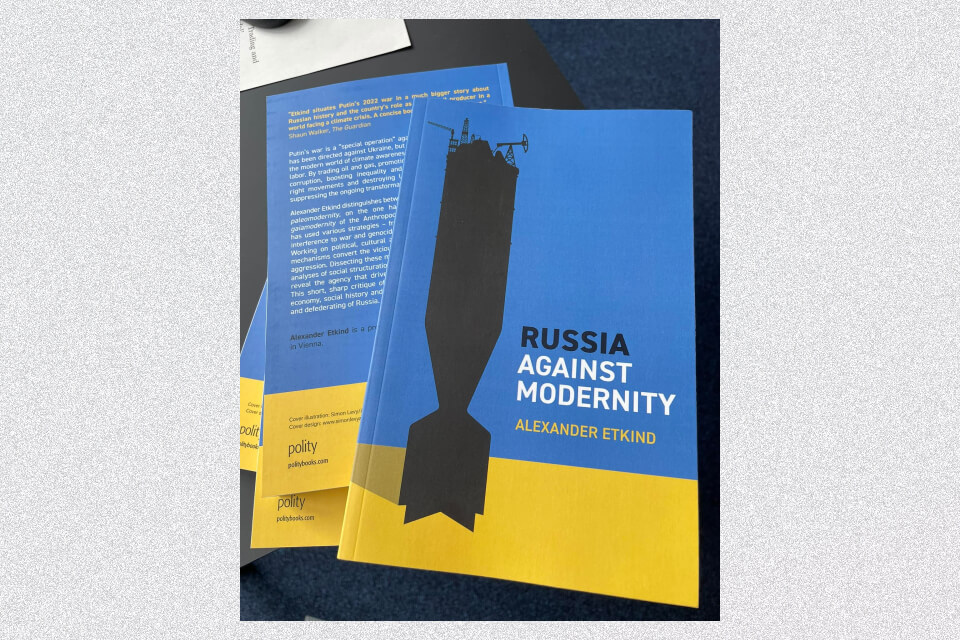
-- Expliquez-nous comment la crise climatique a pu conduire à la guerre. Quand Poutine a annoncé l’invasion de l’Ukraine, il n'a pas dit un mot du climat.
-- Poutine n’en a pas parlé, mais moi j’en parle. C’est justement le sujet de mon livre. La Fédération de Russie a grandi, a grossi et s’est engraissée à 100% grâce à l’exportation d’énergies fossiles. Il n’y a que ça qui a apporté des bénéfices qui ont ensuite été redistribués dans les autres secteurs. Et c’est avec ces bénéfices qu’a été financé le programme militaire russe, dont on ne perçoit l’ampleur et la qualité que maintenant.
Mais une part importante de ces bénéfices a aussi été appropriée par ce qu’on appelle, et moi avec beaucoup de guillemets, “l’élite”, quelques milliers de familles de hauts fonctionnaires, de dirigeants d’entreprise, ceux qui se sont partagés la richesse nationale et ont utilisé ces superprofits pour acheter les plus grands yachts au monde, les palais les plus vastes, les objets de luxe du plus mauvais goût, en Russie comme à l'étranger. La Russie d'avant-guerre était un des premiers pays au monde aussi bien en termes d'inégalité sociale que pour la fuite des capitaux.
Tous les programmes de décarbonation, de transition énergétique, la taxe carbone internationale qui devait être introduite déjà en 2026, tout cela privait la Russie de ses bénéfices. Vers 2030 la Russie devait perdre au minimum la moitié de ses revenus pétroliers, et la totalité vers 2050.
Une réponse adéquate à cela aurait dû être la diversification de l'économie, la concentration des efforts sur la formation du capital humain, sur l’éducation, de manière à ce que les gens gagnent plus d’argent pour eux et pour leur pays, mais au lieu de tout cela et en qualité de frappe préventive, la guerre a commencé. Voilà quelle est la logique de mon livre.
-- Selon vous, c’est bien comme ça que Poutine voyait les choses ?
-- J’ai étudié ça en détails : s’agissait-il véritablement d’un plan préconçu point par point ? On sait bien qu’au début la Russie ne croyait tout simplement pas dans les programmes écologiques internationaux, elle se réfugiait dans le déni. Puis apparut l’idée qu’on pouvait gagner quelque chose à cette histoire (et de fait c’était vrai, parce que le commerce des droits d’émettre, ça marche, mais pas pour la Russie). On discutait de ça activement jusque dans l’administration présidentielle, jusqu’au gouvernement, mais cela exigeait aussi d’immenses efforts politiques et diplomatiques.
Et donc finalement on choisit un autre chemin. S’agissait-il d’un plan longuement médité, d’une décision spontanée ou d’une chaîne de décisions ? Si vous vous souvenez, un des chapitres de mon livre s’intitule “Le goût à la place du plan". J’y explique comment les préférences en matière de goût influencent les décisions des hommes politiques et leur apportent une apparence de cohérence. J’y décris comment de telles préférences, comme l’homophobie ou le goût du grand opposé au petit, remplissent la fonction de planification politique. Une décision déterminée par un goût en entraîne une deuxième, qui à son tour en entraîne une troisième et ainsi de suite ( en probabilités on appelle ça une chaîne de Markov), mais le choix du chemin, à chaque bifurcation, est déterminé par un seul et même goût partagé par la caste dirigeante.
En gros je vois les choses à peu près comme ça : je ne pense pas qu’il s’agisse d’un plan, je pense qu’il s’agissait plutôt d'une chaîne de décisions plus ou moins consciente qui s’est développée sur une dizaine d’années.
-- Dans la célèbre chanson de Viktor Tsoï sur le fait d’être moderne ou non, on trouve le vers suivant : “Tu ne comprends rien et tu ne veux rien changer”. Est-ce ainsi que vous décririez approximativement la logique des dirigeants russes ?
-- Je retiendrais surtout la seconde partie de cette phrase. On pense souvent, et en partie à juste titre, que les bas prix du pétrole à la fin des années 80 ont conduit à la disparition de l’Union Soviétique. Et c’est sur cette expérience que s’est formée toute ”l'élite” russe actuelle. Aujourd’hui ce n’est plus une question de prix, les prix vont continuer à grimper, mais c’est une question d’impôts, de taxes, de limitations, d'embargo, de prix plafonné pour l'énergie. La poule aux œufs d’or est morte, la vie qu’on avait pris l’habitude de mener grâce à elle devient impossible et les bénéficiaires habituels l’ont compris. C’est cette compréhension qui a conduit à ces décisions désespérées destinées à empêcher ces changements.
L’analogie historique la plus pertinente, ce sont les Guerres de l’Opium que l’Empire Britannique mena contre la Chine au 19ème siècle. L’Empire vendait à la Chine de l’opium indien en quantités énormes et les bénéfices allaient à Londres. A un certain moment le pouvoir chinois décida d’arrêter ce commerce, considérant qu’il conduisait à la dégradation de la population, un peu comme aujourd’hui les consommateurs européens commencent à renoncer au pétrole. Et dans les deux cas le vendeur engage une guerre dont le but n’est pas la conquête mais à contraindre par la force l’acheteur à conserver les relations commerciales passées.
-- L’idéal national fondamental de la Russie se réduirait donc à “vivre comme avant”
-- Pas seulement “vivre comme avant”, mais “vivre aussi riches qu’avant”. “L’élite” russe a pris l’habitude de vivre richement, plus richement que n’importe qui sur cette Terre, elle y voit un droit hérité, un droit donné par Dieu lui-même : c'est notre droit, nous sommes le peuple élu, et ils essaient de nous priver de ce droit. Nous étions prêts à commercer avec eux, à utiliser la manière douce. Mais Poutine a décidé : puisqu'ils ne veulent pas de la manière douce, nous userons de la manière forte. Et c'est ce que nous avons fait.
Ce n’est bien sûr qu'une des explications de la guerre avec l'Ukraine. La guerre est un événement dont la signification est immense. De tels événements historiques ont toujours de nombreuses explications, qui se fondent aussi en une logique unique, et ensuite c’est la logique propre de la guerre qui agit. Dans mon livre je décris cette logique, je vais jusqu’au génocide, et jusqu’à la fin possible de cette guerre, c’est-à-dire la défaite militaire de la Fédération de Russie, à laquelle elle ne survivra pas. Je pense que la communauté mondiale ne tolérera plus les bizarreries et les excès russes, comme elle les tolérait avant la guerre. Je pense que c’est la dernière guerre russe, elle va conduire à l’éclatement de la Fédération de Russie.
-- Vous parlez de l’immense signification de la guerre en Ukraine mais en même temps vous écrivez dans votre livre qu'elle est seulement une partie de "la guerre de l'anthropocène" que l'homme mène contre la nature. Cette idée ne minore-t-elle pas la signification et toute l'horreur de l'invasion russe ?
-- Il est possible que les Ukrainiens comprennent ainsi mon propos et pensent que j’amoindris la signification de la guerre qu’ils mènent. Ils pensent vraiment maintenant que non seulement la clique poutinienne, mais le peuple russe en entier déteste les Ukrainiens avec une intensité particulière. Ils croient en une haine ethnique de la part des Russes.
Mais moi je n’y crois pas. Je crois qu’il s’agit d’une mythologie nationale caractéristique du temps de guerre mais qui ne correspond pas aux réalités historiques et politiques. Et peut-être même que cette mythologie ethniciste est nuisible à la pratique politique de l’Ukraine. Je pense que l’Ukraine ferait mieux de se concentrer sur les dirigeants russes et leur renversement et comprendre que quand ce régime se terminera la guerre se terminera aussi. Alors de nouvelles réalités politiques deviendront possibles sur tout le continent européen et dans le monde entier. Et nous devrons tous en remercier l’Ukraine. C’est sur ces mots que se termine mon livre.
-- Mais à dire vrai votre livre ne s’intitule pas “Poutine contre la modernité” mais “La Russie contre la modernité”.
-- C’est vrai. Mais pour moi cette guerre est poutinienne, pas russe. La Russie est un Etat, mais aussi un pays. Je n’accuse pas le peuple russe, quoique dans ce contexte il serait peut-être justifié de le faire. Mais je crois qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais maîtres. Le peuple doit-être éclairé, on doit lui apprendre, en commençant par la maternelle et jusqu'à l'université, à se comporter autrement à l'égard de la nature, des déchets, du carburant, de l’électricité, des gens, du monde...
Les autres nations ont volontiers adopté ces nouvelles manières de se comporter, comme par exemple le tri des déchets. Bien sûr c'est aussi une question d'infrastructures, quels bacs à ordures ont été installés dans votre cour, mais c’est avant tout une question d’éducation. Il n’existe pas de bons ou de mauvais peuples, il existe de bonnes ou de mauvaises éducations. En tant que personne qui a passé toute sa vie professionnelle dans le domaine de l’éducation, je comprends cela très clairement.
-- Vous écrivez que les Etats modernes entretiennent des relations de confiance avec le peuple. Vous ne pensez pas que le peuple russe fait entièrement confiance à l’Etat ? Même les enquêtes sociologiques, et même en tenant compte de leurs faiblesses aujourd'hui, font état d’un indice de confiance très élevé des Russes à l’égard de Poutine et à l’égard de l’armée.
-- La confiance, c’est une question capitale pour les sciences sociales. Elle ne se mesure pas au moyen d’enquêtes, dans aucun pays, et encore moins dans les pays totalitaires. Aujourd’hui la sociologie en Russie ferait mieux de se taire, parce qu’elle est autant au service du régime que l’armée ou la justice. On ne peut pas lui faire confiance.
La confiance il faut la mesurer par exemple avec les taux du crédit. Vous empruntez de l’argent à un ami : si vous vous faites confiance, les intérêts seront nuls. Et en Russie les crédits sont accordés avec des intérêts très élevés : voilà un vrai indicateur de confiance.
Et comme l’écrivait le célèbre sociologue allemand Niklas Luhmann : “Si dans votre pays il n’y a pas de confiance, vous n’avez pas envie de vous lever le matin”. Je pense que c’est exactement ce que ressentent de nombreux russes maintenant.
-- Un autre idéal important pour la Russie que vous exposez dans votre livre est celui de “normalité”. Vous dites qu’il était devenu essentiel après l’éclatement de l’URSS. La réalisation de cet idéal a-t-elle échoué ?
--L’idéal de “normalité” dominait au sein d’un cercle déterminé de soviétologues, de kremlinologues et d’experts occidentaux. J’entretiens un rapport critique avec cet idéal mais il faut reconnaître qu'il s'agissait d'une entreprise gigantesque, qui, comme je l'écris, ressemblait à une sorte de “plan Marshall” intellectuel.
Tous les indices, qu’ils concernent le budget de l’éducation, le bonheur ressenti, la mortalité ou la différence d’espérance de vie entre hommes et femmes en Russie, tous, et c’est un euphémisme, sont anormaux. Ils ne cadrent pas avec un pays qu’on qualifiait il y a peu encore de “normal” dans les articles scientifiques, et que la Banque Mondiale a fait accéder à la catégorie de “pays riche”.
-- Peut-être par anticipation abusive ?
-- Je ne crois pas, c’est déjà le cas avant 2014. Dans le folklore russe on les appelle les “années grasses”. Il ne s’agit pas d’anticipation abusive, mais de la constatation d’une réelle croissance économique sans compréhension de la nature de ce phénomène. Bien que tout le monde ait su alors quelle était la source de cette croissance, et qu’on le comprenne encore mieux aujourd’hui. Plus personne au XXI siècle n’appellerait “normale” une croissance reposant seulement sur l’exportation de matière première carbonnée.
-- Tout en opposant la Russie au progrès, vous écrivez néanmoins que le poutinisme est devenu un phénomène mondial. Expliquez-nous ce que vous voulez dire exactement. Il semble aujourd’hui que le poutinisme n’existe plus qu’entre les murs d’un cabinet de travail.
-- Aujourd’hui, oui. Mais c’est l’effet direct de la guerre. Avant la guerre ce n’était pas le cas. Vous vous souvenez quand les leaders du monde entier venaient voir Poutine et s’asseyaient au bout de cette table absurde.
Le moment le plus important est lié à la présidence de Donald Trump. Cela a correspondu à la victoire mondiale du poutinisme comme système de goûts et modèle de comportement. Un grand pays comme les Etats-Unis est tombé sous l’influence de la Russie et a voté pour un poutiniste. Heureusement cela n’a pas fonctionné une deuxième fois.
D’ailleurs Trump a peut-être raison de dire que s’il avait été président la guerre n’aurait pas eu lieu. D’autres leviers d’influence et d’action auraient fonctionné. Et par conséquent, si la guerre n’avait pas eu lieu, le poutinisme aurait pu, sinon prospérer, au moins subsister et passer pour un phénomène consistant et normal. La guerre a été l’erreur fatal de ce régime.
-- Mais ne vous semble-t-il pas que la guerre a offert un second souffle au poutinisme, même si on ne l'identifie pas comme tel ? Qui aujourd'hui a encore quelque chose à faire de l'hypothèse Gaïa et du super-organisme ? Partout on augmente les budgets militaires, on ne pense qu’à la sécurité, les stratégies gouvernementales sont de plus en plus primitives. Ce sont des idées purement poutinistes, opposées à la modernité.
-- C’est tout à fait vrai. D’un côté la guerre a mis à mal l'économie russe, et quelle que soit la quantité de pétrole qu'elle exporte avec des pétroliers sous pavillon de complaisance, elle est condamnée à mourir étouffée par ses propres carburants fossiles. Mais en un sens plus large, il est vrai que le poutinisme réalise ses objectifs : les délais des programmes climatiques européens seront vraisemblablement repoussés, les plans des ennemis de la Russie ne se réaliseront pas, ou se réaliseront plus tard que prévu. La guerre a atteint son but. La remilitarisation de l’Europe va exiger des quantités de produits énergétiques et lubrifiants pétroliers énormes. Aucun doute sur ce point.
-- Ce n’est pas seulement une question matérielle. Cela signifie aussi la victoire de cette manière archaïque de penser sur la modernité. La Russie va-t-elle l'emporter finalement sur la modernité ?
-- Non, cette fois, ça ne marchera pas.
Propos recueillis par Maxime Zagovora, Holod Media, 15/04/2023
Article original : https://holod.media/2023/04/15/eto-poslednyaya-russkaya-vojna/
Alexandre Etkind : https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Etkind
La chanson de Viktor Tsoï : https://www.youtube.com/watch?v=QwfBDAhTgqk



