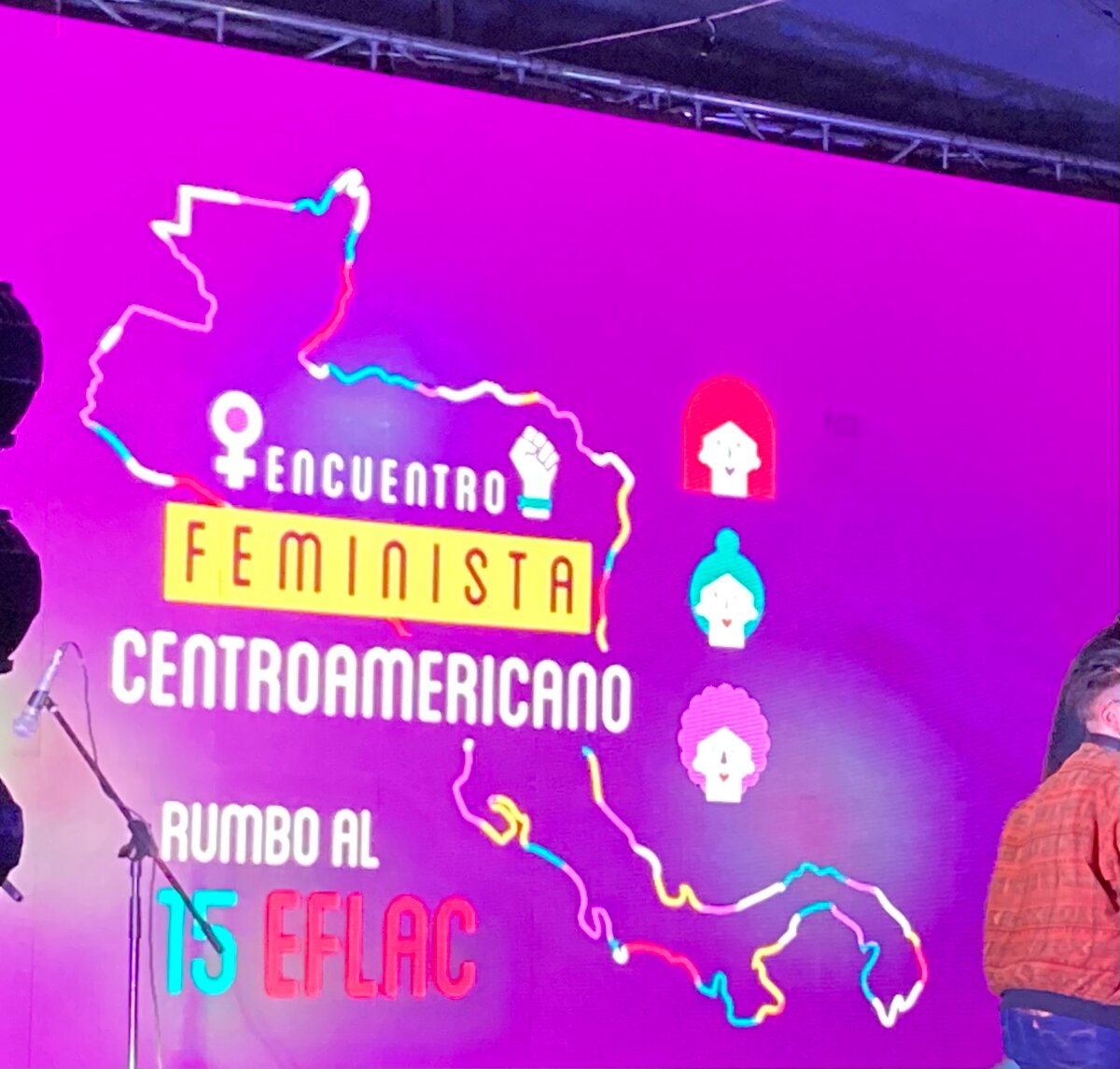
Agrandissement : Illustration 1
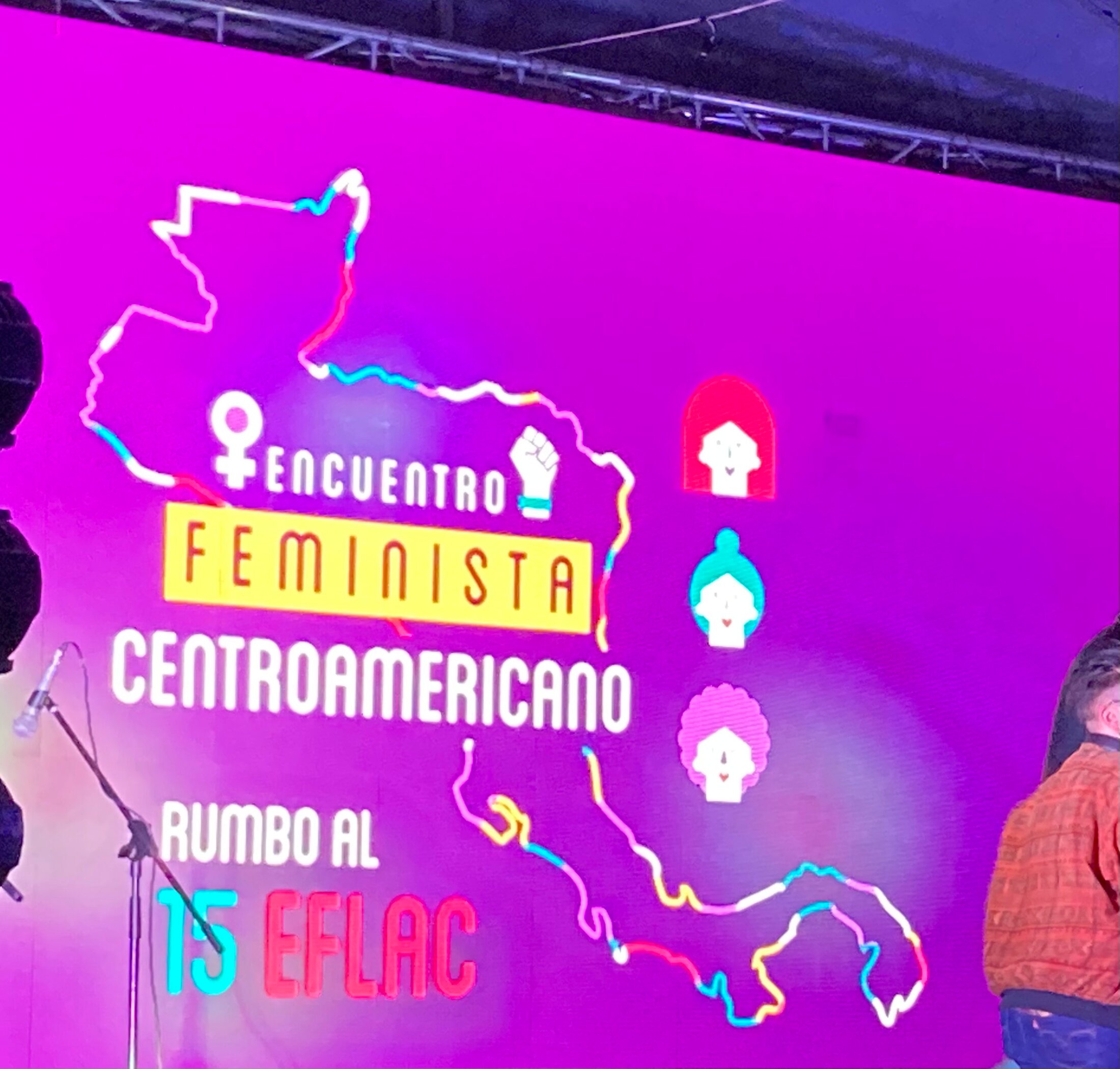
Version en espagnol (avec nos remerciements à Pikara magazine)
Il y a trente ans, le Guatemala, le Salvador, le Nicaragua, commençaient à entrevoir la possibilité de fonder des systèmes politiques rompant avec l’autoritarisme, et organisant une mise en retrait des pouvoirs militaires. Sortir de la guerre, organiser des élections compétitives et transparentes, éviter le continuisme des mandats présidentiels, promouvoir la liberté associative, étaient autant d’objectifs pour l’ensemble de la région, cherchant à dresser la frontière entre un passé autoritaire que l’on voulait révolu, et un futur mettant au ban la violence d’Etat.
La fin de la guerre froide et l’idée d’un sort commun centraméricain ont accompagné ce mouvement inédit en faveur de la démocratisation. Elles ont sous-tendu la lutte contre une fragmentation régionale qui, confrontée aux intérêts impérialistes, avait fait de chaque pays un potentiel camp de base militaire pour son voisin ou une source de financement des acteurs belligérants.
Au sortir des guerres internes, mettre en avant une analyse féministe de l’ensemble de ces processus de rupture comportait des défis incommensurables. Ces derniers concernaient d’abord les féministes elles-mêmes qui, au Guatemala, à El Salvador et au Nicaragua, avaient forgé leurs armes idéologiques au sein des organisations révolutionnaires.
Quelques contributions audacieuses, minoritaires, avaient fait en sorte de mettre au premier plan la question de la violence conjugale, de l’interruption volontaire de grossesse, de la liberté sexuelle pour les femmes, de leur droit à la terre, malgré un environnement politique extrêmement polarisé.
Mais ce n’est qu’après ces guerres, que beaucoup ont pu surmonter la "scission vitale" qui les maintenait fidèles à la fois aux organisations révolutionnaires dominées par les hommes et au projet féministe autonome nouvellement découvert. Pour bon nombre des futures leaders des mouvements féministes de la région, s'affirmer en tant que féministes a d’abord signifié tenter de négocier les revendications des femmes au sein de leurs anciennes organisations devenues des partis marxistes dirigés par des civils, puis, une fois leurs efforts infructueux, mettre fin à leur allégeance aux anciens projets politico-militaires.
La rencontre centraméricaine à Montelimar, en 1992 « une femme nouvelle, un pouvoir nouveau », fut en ce sens un moment de bascule. Outre la quête principale de l’émancipation des femmes, de la construction de sociétés plus égalitaires, du combat contre l’appauvrissement de populations meurtries par la violence guerrière, nos camarades féministes centraméricaines se sont affirmées autour de principes qui depuis n’ont jamais cessé de les guider : avoir un mouvement à soi ouvertement féministe, le plus indépendant possible, et défendre les droits humains.
Durant toutes ces années, les collectifs ont conquis des droits fragiles mais inédits, en particulier des modifications législatives relatives aux violences sexistes et aux féminicides.
Leurs militantes ont fait face à l’imposition du néolibéralisme, à la reconduction des élites au pouvoir et à la perpétuation de cette « trinité patriarcale » tout droit héritée des figures de pouvoir de l’époque coloniale et de la post-indépendance : les caudillos, les fondamentalistes religieux et les patrons. Elles n’ont eu de cesse de combattre l’exploitation des travailleuses, l’accaparement des terres et des ressources par un petit cercle d’entrepreneurs et de structures multinationales extractivistes.
Elles ont dénoncé les actes de violences et de racisme contre les populations indígenas qui, déjà la cible de la terreur et des massacres dans les années 1980, ont continué d’être harcelées par les acteurs de la déprédation territoriale. Elles ont résisté à la violence des mouvements antiféministes, soutenus par les clergés de tous poils qui ont établi en Amérique centrale post-révolutionnaire un laboratoire pour leur (re)naissance idéologique et organisationnelle.
Il suffit de lire les prises de position exprimées par les gouvernements du Honduras, du Guatemala, du Salvador et du Nicaragua, contre les « droits reproductifs et sexuels », à l’issue de la conférence sur la population tenue au Caire en 1994, pour mesurer la précocité du poids de ces groupes dans la vie politique de ces différents pays.
Faute de politiques économiques redistributives, et en raison de l’instauration du modèle de démocratie dite « de marché », laissant davantage la part au marché qu’à la démocratie elle-même, le foisonnement des ONG féministes a donné une armature solide aux sociétés civiles naissantes. Mais ces structures ont dû assumer un rôle social et humanitaire substitutif aux services publics, très faiblement dotés.
Durant ces décennies, malgré ses dissensions et grâce à la diversité de ses mouvements, cette génération féministe qui avait commencé par transgresser la discipline révolutionnaire, s’est ainsi affirmée comme un socle critique de premier plan vis-à-vis des institutions de pouvoir. Nos camarades ont décrypté l’illusion d’un pluralisme et d’un antagonisme droite-gauche en montrant que cette pseudo-conflictualité masquait autant de pactes patriarcaux.
Par exemple, au Salvador, en 1999, les députés du Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional (FMLN) ont voté la réforme constitutionnelle définissant la vie comme débutant « au moment de la conception », appuyant ainsi la prohibition totale de l’avortement voulue par le parti de droite majoritaire Alliance républicaine nationaliste (ARENA) et son allié le Parti de Concertation Nationale (PCN) deux ans plus tôt.
En 2006, le Front Sandiniste de Libération Nationale (FSLN) a également contribué à éliminer l’avortement thérapeutique du code pénal, puis en 2007 à interdire totalement l’interruption de grossesse, même en cas de danger vital pour les femmes ou en cas de viol.
Que dire également de ce pacte en 1999, dénoncé par les féministes nicaraguayennes, lors duquel l’ancien révolutionnaire et actuel dictateur Daniel Ortega, alors député, accusé par sa fille adoptive de pédocriminalité incestueuse, a organisé un accord d’immunité mutuelle avec le président de droite de l’époque, Arnoldo Alemán, lui-même accusé de détournement de fonds publics.
Viol et vol ont constitué les monnaies d’échange d’un pacte d’impunité au sommet du pouvoir, entre anciens ennemis de guerre devenus alliés pour l’occasion. Cela a de plus inauguré une restriction de la liberté partidaire dans le pays. La violence sexuelle et son impunité, légitimées par des chefs de parti rivaux et support de nouveaux agencements institutionnels, ont été en somme un premier signe de dérive anti-démocratique.
Aujourd’hui, politiques misogynes, antiféministes et tournants autoritaires ne font qu’un.
Au Guatemala, la dissolution de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), imposée en 2019 par l’ex président Jimmy Morales, a inauguré une dérive répressive. Près de 20 magistrats et magistrates de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) investi.es pour lutter contre la corruption et la collusion entre mafias, entrepreneurs, militaires et élu.es, ont été forcé.es à l’exil.
D’autres font l’objet de persécutions, à l’instar de Virginia Laparra, récemment condamnée à quatre ans de prison pour « abus d’autorité », à l’issue d’un procès que de nombreux organismes de défense des droits humains ont décrit comme une vengeance des élites corrompues qu’elle avait poursuivies. Le 25 novembre 2022, à l’issue de la Rencontre féministe centraméricaine, nos camarades ont dénoncé cette vendetta judiciaire, et les conditions de détention de l’ex-procureure, marquées par toutes sortes de menaces sexistes.
Ce même 25 novembre, nous nous sommes recueillies devant le mémorial dressé pour les 41 filles et adolescentes tuées dans l’incendie de leur prétendu « refuge public », le Hogar Seguro Virgen de la Asunción, où le 7 mars 2017, elles avaient été enfermées de force par les responsables du foyer et par la police, durant de longues heures et dans des conditions cruelles, à la suite de leur tentative d’évasion.
Dans ce cas l’impunité reste de mise, tant les témoignages des survivantes et de leur famille, et de nombreuses plaintes déposées par le passé, indiquent que l’un des motifs de la rébellion à l’origine de l’incendie, fut l’exploitation sexuelle à laquelle étaient soumises les jeunes filles. Ce féminicide de masse est l’exemple paradigmatique d’une suite d’actes de mépris absolu pour la vie des femmes les plus vulnérabilisées : s’il n’a finalement pas validé une proposition parlementaire pour restreindre l’accès à l’avortement thérapeutique, le 8 mars 2022, l’actuel président Giammattei a souhaité proclamer le Guatemala « capitale pro-vie de l’Amérique ibérique ».
Au Salvador, malgré la dernière alternance politique en 2019, aucun espoir ne paraît se dessiner pour modifier la législation anti-avortement qui criminalise les femmes pauvres éprouvant des complications obstétricales. En mai dernier, après des dizaines de persécution judiciaire de ce type, une femme a été condamnée à 30 ans d’emprisonnement pour homicide aggravé contre son fœtus, après avoir subi une fausse couche. La perpétuation de cette criminalisation s’inscrit dans un contexte de restrictions des libertés publiques, tant pour les organismes de défense de droits humains que pour les journalistes, dont beaucoup ont dû s’exiler. Ces dernier.es tentent de mettre au jour les excès de la politique sécuritaire du président autoproclamé « le plus cool du monde ».
Fort populaire, Nayib Bukele, maintient un régime d’exception décrété en mars 2022 pour traquer et enfermer les membres des pandillas qui terrorisent les communautés les plus délaissées depuis des décennies. Dans un rapport récent, Human Rights Watch a documenté la façon dont la campagne de détentions massives et indiscriminées – 58 000 personnes – a conduit à la détention de centaines de personnes sans connexion avec ces pandillas. Ces violations généralisées des droits humains ont été rendues possibles après que les députés officialistes, majoritaires aux deux tiers depuis mai 2021, ont fragilisé la séparation des pouvoirs en destituant et en remplaçant les cinq magistrats de la salle constitutionnelle de la cour suprême de justice, de même que le procureur général.
Ces magistrat.es coopté.es ont de même approuvé des lois permettant à la Cour suprême et au procureur général de démettre arbitrairement de leur fonction les juges et procureurs des instances inférieures. Comme cela fut le cas au Nicaragua, ils et elle ont émis une décision en 2021 permettant au chef d’Etat actuel d’être immédiatement candidat à sa propre succession, chose jusque-là interdite par la Constitution.
Le Nicaragua offre un exemple paradigmatique de ce tournant autoritaire. Depuis la crise politique d’avril 2018, la répression du régime a coûté la vie à 355 personnes au moins, dont 306 parmi les manifestant.es. Le régime présidé par Daniel Ortega et Rosario Murillo a organisé une répression ciblée systématique. 3106 associations ont été interdites, soit 43% de celles enregistrées dans le pays en 2018, parmi lesquelles 176 associations de femmes et féministes. Leurs locaux ont été confisqués, leurs leaders contraint.es à l’exil, les organes de presse indépendants ont été harcelés, interdits pour certains, et leurs rédactions travaillent depuis l’étranger.
Au moins 236 prisonniers politiques, dont 26 femmes, sont actuellement enfermées dans les geôles de la dictature. Les féministes nicaraguayennes ont toujours été l’une des premières cibles du couple présidentiel, en raison de leur défense de Zoilamérica Narváez et de l’appui de sa dénonciation pour violence sexuelle incestueuse contre l’actuel dictateur, dès 1998. Mais aussi sans doute parce que leur connaissance intime du pouvoir révolutionnaire sandiniste exercé dans les années 1980, leur a permis de nourrir une vigilance accrue à l’égard des quelques cadres du FSLN, dont Ortega déjà chef d’Etat entre 1984 et 1990, qui en s’accaparant la structure partisane, se préparait à un retour à la présidence.
Déjà, en 2008, nous manifestions notre solidarité vis-à-vis du Mouvement Autonome des Femmes, dont les locaux avaient été arbitrairement perquisitionnés. Quand les photographies de plusieurs de leurs activistes ont été brandies dans les rues par les groupes de choc du régime, « las turbas », nous avons dénoncé cet appel au lynchage.
Au Honduras, la situation institutionnelle est encore incertaine. L’élection récente de Xiomara Castro intervient en rupture avec les acteurs politiques qui ont fomenté le coup d’Etat perpétré contre son mari Manuel Zelaya treize ans plus tôt, mais l’avenir du pays, sous son leadership, reste flou. Lors de la rencontre féministe à Guatemala, nos camarades honduriennes ont dit leur détermination à lutter pour le rétablissement de la pilule du lendemain (pastilla anticonceptiva de emergencia) dont la circulation et la distribution fut interdite en 2009. En 2021, l’interdiction déjà effective de l’avortement a été constitutionnalisée, ainsi que l’empêchement de réformer le code civil pour y inclure le mariage homosexuel.
La dissémination de la violence touche en premier les quartiers les plus marginalisés, souvent contrôlés par les groupes criminels, qui violent et perpètrent des féminicides impunément ce qui, comme au Salvador ou au Guatemala, poussent les femmes et les jeunes filles à la migration. L’on sait par ailleurs combien dans les zones rurales, les défenseurs et défenseuses des territoires et des ressources naturelles restent l’objet de persécutions, allant jusqu’au meurtre. La victime la plus connue est la défenseure autochtone et féministe Berta Cáceres, qui a été assassinée en mars 2016 après des années de menaces et de harcèlement liés à son opposition à un barrage hydroélectrique sur la rivière Gualcarque.
Le Costa Rica et le Panama font exception dans la région. Cependant, à l’occasion d’une session d’échanges à propos du Nicaragua, les féministes costariciennes participantes de la Rencontre, nous ont alerté sur l’élection récente du président Rodrigo Chaves, dénoncé pour ses penchants populistes et mis en cause pour harcèlement sexuel dans son ancien poste à la Banque mondiale. Celui-ci a conclu un accord avec un groupe de pasteurs évangéliques qui l’engage à maintenir les restrictions à la procréation médicalement assistée et à l’avortement.
En décembre dernier, de nouvelles mesures ont restreint les conditions de travail et d’accès à l’asile pour les migrant.es, ce qui concerne principalement les quelques 200 000 nicaraguayens et nicaraguayennes ayant fui leur pays. Les défenseurs et défenseuses nicaraguayens des droits humains ayant entamé une démarche de demande d’asile ne pourront plus sortir du pays, même pour mener à l’étranger des actions de sensibilisation et d’appel à la solidarité, alors que ces déplacements sont stratégiquement et humainement cruciaux.
Si nous, qui ne sommes pas originaires d’Amérique centrale, qui avons participé à la Rencontre féministe centraméricaine, ou qui avons contribué à des rencontres antérieures, signons cette tribune aujourd’hui, c’est en raison de l’urgence d’une meilleure visibilisation de ces basculements vers l’autoritarisme, de la nécessité de porter l’attention sur leurs effets d’intensification de la violence contre les femmes et contre nos camarades féministes, au creux d’une situation géopolitique fort différente de celle où certaines de nous, nées au milieu du XXème siècle, nous étions engagées.
Les idéaux révolutionnaires nous portaient, et en particulier la victoire de la révolution sandiniste qui nous avaient enthousiasmées. Le rôle des guérillères dans ces engagements nous avaient impressionnées. Nous avions voulu non seulement participer à ces luttes révolutionnaires mais aussi, aux côtés de nos camarades, cherché à les rendre réellement émancipatrices pour les femmes. A cette époque, l’Amérique centrale, théâtre de la guerre froide, et creuset d’un véritable espoir pour fonder des sociétés plus justes, était au cœur du monde.
Nous autres, signataires « plus jeunes », nées après les années 70, avons été témoin à côté de nos aînées du désenchantement révolutionnaire, des ravages du néolibéralisme, de la rapide dégradation des essais pro-démocratiques, des immenses difficultés à rendre effectives les quêtes de justice et de réparation après les tueries de masse durant les conflits armés, de la légitimation des pactes patriarcaux en guise de réconciliation entre anciens ennemis guerriers. Mais cette dégradation a eu cours à une période où l’Amérique centrale fascinait moins les utopistes nostalgiques des révolutions armées.
De ce fait les groupes de solidarité internationaliste se sont vus moins nombreux.
C’est pourquoi réactiver, et étendre cette solidarité internationaliste au nom du féminisme, est urgent. Nous savons que ces régressions autoritaires ne résultent pas que de causes spécifiques à chaque Etat, mais bien d’une dynamique plus générale, à l’échelle du monde. Les crises écologiques et migratoires, intensifiées par les régimes dictatoriaux, impliquent au premier chef les Etats ex-colonisateurs et impérialistes mais aussi les Etats latinoaméricains les plus puissants.
Notre solidarité avec les résistances contre les autoritarismes en Amérique centrale passe par l’appel à de véritables politiques d’accueil des migrant.es, au respect des droits humains, à la fin de l’exploitation des personnes les plus précaires, en particulier des femmes et des filles. Elle passe par la lutte contre la déprédation des ressources, par le combat pour notre liberté procréative, pour la liberté de la dissidence sexuelle. Elle exige aussi de lutter contre les autoritarismes et l’approfondissement démocratique dans nos propres pays d’origine.
Dans la déclaration finale de la rencontre féministe du Guatemala, nos amies rappellent qu’elles continueront de lutter contre vents et marées, depuis leur terre d’exil ou dans la clandestinité imposée par la censure, pour l’émancipation des femmes, depuis leur diversité de classe, de race, d’âge et de condition physique.
Nous nous engageons à continuer de faire connaître leurs combats, à les porter auprès des autorités politiques de nos pays d’origine, à exiger la libération des prisonnières de conscience. Les luttes actuelles de nos camarades sont les nôtres, comme elles l’ont été par le passé.
¡Florecerás Centroamérica, libre y feminista!
Cristina Arévalo, socióloga, México
Kathy Bourgher, docente, Estados Unidos
Lilian Celiberti, activista feminista, Montevideo, Uruguay
Natalia De Marinis, antropóloga, México
Helen Dixon, activista feminista, United Kingdom
June Fernández, periodista, País Vasco, España
Colette Fine, diseñadora gráfica, Francia
Lucy Garrido, periodista, Uruguay
Véronique Giraud, profesora, Saint-Denis, Francia
Geni Gómez, activista feminista, Madrid
Delphine Lacombe, socióloga, México-Francia
Clara Murguialday, economista, País Vasco España
Mariana Sánchez, periodista, Francia
Rita Laura Segato, Universidad de Brasilia, Universidad Nacional de San Martín
Camila Selser, actriz, México
Gabriela Selser, periodista, México
Diana Silva, socióloga, México
Virginia Vargas, activista feminista, Perú
Norma Vázquez, psicóloga, México - País Vasco España
Pour soutenir cette tribune :
Premières signataires sur Change.org :
Silvia Soler, México / Anne Laure Amilhat, Francia / Rose-Marie Lagrave, Francia / Emmanuelle Latour, Francia / Hadlyyn Cuadriello Mexico City / Estrella López Morelia México / Chloé Constant México /Irzel Plascencia México /Rocio Araujo México / Karla Elia Mosqueira Valencia México /Cristyana Somarriba Miami / Frida Calderon México / Josiane Gonthier Paris / Haydée Castillo Ocotal Nicaragua / Teresa Villaverde Martinez Bilbao España / Lopez Lopez G México / Valentine Sébile México / Maria Ester Quintana Moreno Managua Nicaragua / Irene Dos Santos Versailles Francia / Marthe Bernard France / Maryse Elgoyhen Francia / Tania Romero Barrios Rosny Sous Bois Francia / Delphine Prunier Mexico City 6600 México / sylvette wyatt LONDON England N8 8RE R. U. / Hélène ELOUARD Francia / Fernando Cerezal Sierra Sevilla 41006 España / Rosa Angelica Castillo Calero Nicaragua / Marielle Debos Tremblay-en-France /Ana Laura Durán Chinandega Nicaragua /mirna Blandón Gadea Managua Nicaragua / Griselda Lupi Choluteca Honduras / Alejandra Burgos San Salvador El Salvador/ Begoña González Fernández España /Ana Landa Madrid / rosella simone garlenda (savona) Italia / Izas B Madrid / Sofia Montenegro Managua Nicaragua/ Adelayda Sanchez Managua Nicaragua/ María Esther Montanaro Mena San José /Sabrina Melenotte Paris Francia/ Linayme Paulette Reyes Ávila Acapulco de Juárez/ Fernanda Guerrero Monterrey México / Agathe Guerrier Los Angeles California / Garance Robert Montréal /
soledad perez cordoba Argentina
Edurne Larracoechea España
Eric Léonard Montpellier Francia
Maitena Monroy Bilbao 48003 España
María José Sáinz Bretón Madrid 28047 España
bea huber Santa Coloma de Gramenet 8923 España
ana ara sorribas 8031 España
Paola DIAZ-LIZE Saint Denis 93200 Francia
Lourdes Aldana Guayaquil Ecuador
Leonor Cuadrado Santa Coloma de Gramenet 8922 España
maria angelica faune Managua Nicaragua
Virginia Vargas Valente Lima 1 Perú
Lola Ocon Melbourne 3078 Australia
Gloria Bonder Buenos Aires 1026 Argentina
Montserrat Sagot San José 2050 Costa Rica
Concha de Sena Madrid 28005 España
Verónica Moreno Uribe Xalapa 91000 México
Flavia Orsburn Evansville Indiana 47715 EE. UU.
YANELLI DEL CARMEN RODRIGUEZ CISNEROS 95285 México
Osvaldo Buscaya Buenos Aires 1657 Argentina
Morena Herrera Suchitoto El Salvador
Gloria Careaga Mexico City 3020 México
Teresa Lanza Santa Cruz Bolivia 12/01/2023
Ana Elena López Payán Tlalpan 14050 México
Lucía Lagunes DF 6050 México
CATWLAC Coalition Against Trafficking in Women & Girls Mexico City, Mexico 1620 México
Graciela Ulloa Mexico City 3020 México
Sylvia Torres Leon 0 Nicaragua
TANIA Rocha Mexico City 3020 México
Andrea Parra Bogotá Colombia
Gabriela Delgado Mexico 14460 México
Ma del Pilar Sánchez Rivera Mexico 52740 México
Veronica Salazar San Salvador El Salvador
Marielos Vargas San Salvador El Salvador
Carmen Costa Curitiba Brasil
Vianey Flores Cuernavaca 62710 México
Columba Quintero Mexico City 3020 México
Susana Gómez Melchionna 5003 Argentina
Gabriela Arguedas San José 30301 Costa Rica
FABIOLA CALVO OCAMPO Bogotá Las Aguas Colombia
Myriam Criado Bogotá Colombia
Vanely De Ferrer Naucalpan 53694 México
ADRIANA BOLLO Cordoba 5000 Argentina
Albertina Contreras Bustamante Xalapa 91227 México
Lilia Hernandez Venustiano Carranza 15370 México
Helen Shears London England SW2 5BB R. U.
Montserrat Cervera Rodon Barcelona 8013 España
Maria Teresa Manzanares DISTRITO FEDERAL 6200 México
Audrey Leblanc Charleroi Bélgica
Edith Carbajal Della Siega Mexico 6300 México
Gema de la Cruz Saugar Córdoba 14001 España
Rossana Inés Castellanos Xalapa 91000 México
Irene Cohen Valencia 46006 España
Lola Jara Mira Valencia 46182 España
Sara sariñena riba Valencia 46007 España
Coline Léonard Choisy-le-Roi 94600 Francia
Francesca Conesa Climent Valencia 460016 España
Segolene Lefébure Paris 75020 Francia
Teresa Tójar Fernández Villaviciosa de Odón 28670 España
gloria casas barcelona
Alejandra María Eugenia Gastesi Córdoba 5000 Argentina
Julia Frias GÓMEZ San Sebastián de los Reyes 28703 España
María Bayo Valencia 46010 España
Bibiana Peñaranda Cali Colombia
olga beatriz cuellar Xalapa 91190 México
Gwenaëlle Perrier Paris 75020 Francia
Gloria Muñoz Font Barcrlona 8031 España
Josefa Tortosa Martorell Jesus Pobre (Alacant ) 3749 España
Justa Montero Corominas Madrid 28039 España
Adela Lagos 94297 México
Fatima Muriel Mocoa Colombia
Sandrine Ricci Longueuil J4H Canadá
Lourdes Godínez Coatepec 91560 México
Evangelina Aréchiga Mexico City 3100 México
Martha Delgado Veracruz 91000 México
Mar Companys Alet Esplugues de Llobregat 8950 España
Tamara morazan Managua Nicaragua
María del Carmen Alvarez Boca Del Río 94290 México
Monica Roa Madrid España
Rubiela valderrama Cartagena 130004 Colombia
Edme Dominguez Reyes G�teborg Suecia
Johanna Bergström Suecia
Lilian Alemany Suecia 414 77 Portugal
Marcelina Velázquez Suecia
Isabel Marco Valencia 46003 España
Anna Jarry-Omarova Sevran 93270 Francia
Carlos Jolon Washington District of Columbia 20017 EE. UU.
Josefa María Úbeda Iranzo Valencia 46010 España
Maria Pinto san cristobal de las casas 29200 México
Adlay Reyes betanzos Cuernavaca 62170 México
mercedes ramos 29003 España
Marie-Pierre Lefeuvre Paris 75020 Francia
Rosa María Blandón blanco Managua 505 Nicaragua
Monique DENTAL 75018 PARIS
meri Molero Marom Valencia 46017 España
DORIS LAMUS Piedecuesta santander Colombia
Chantal Serrano Londres England NW11 R. U.
Nadine Michauu Beaugency 45190 Francia
Elena Apilánez Piniella Gijón 33209 España
Gisella Galliani Lima Perú
Elsa Beatriz Gil
Ana P Moreno
Colectivo Feminista Xalapa



