Par Ashish Kothari, Ariel Salleh, Federico Demaria, Arturo Escobar, et Alberto Acosta
Le covid 19 nous affecte tous mais il touche particulièrement ceux qui ne sont pas en mesure de se retirer chez eux en attendant que le pire soit passé. Ce virus nous donne aussi l’occasion de réparer nos erreurs et nos injustices, notamment celles qui concernent l’exploitation abusive de notre maison terrestre et des sociétés marginalisées, ou encore de ceux-là même qui souffriront le plus de cette pandémie. Cette attaque virale est le signe qu’en allant trop loin dans l’exploitation de la nature, la culture globalisée dominante a détruit la capacité de la planète à maintenir la vie et les moyens de subsistance. La libération de micro-organismes, depuis leurs hôtes animaux, implique qu’ils doivent se fixer sur d’autres corps pour leur propre survie. Les êtres humains font partie de la nature – et tout est interconnecté.
La pandémie actuelle n’est qu’un aspect de la crise anthropogénique (créée par l’homme) connue sous le nom d’Anthropocène : l’emballement des changements climatiques et la perte de biodiversité en sont d’autres. Et tous ces phénomènes sont liés. Le COVID-19 nous confronte à une crise civilisationnelle si imminente et si sévère que la seule stratégie viable sera celle qui pourra atteindre et soigner en profondeur la toile de la vie. Le philosophe nigérien Bayo Akomolafe fait remarquer qu’aujourd’hui, la complexité de la situation humaine défie la capacité de pensée et d’encadrement. Cette crise exclut toute possibilité de confiance illusoire dans les notions modernes et universelles que sont l’histoire, le progrès, l’humanité, le savoir, le temps, le sécularisme, comme dans notre tendance à prendre la vie elle même comme un acquis.
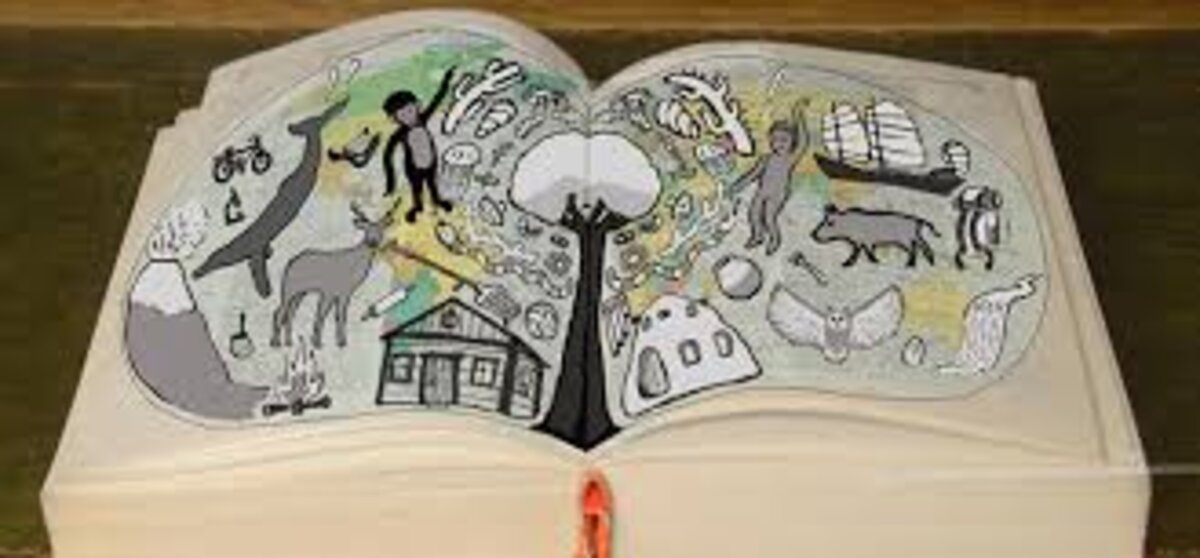
La crise du coronavirus dévoile une civilisation qui est en train de mourir mais pointe aussi vers un « plurivers » d’autres mondes qui sont en train de monter en puissance. Chaque crise est une opportunité. La question-clé est de savoir comment reconstruire nos économies et nos politiques d’une manière qui respecte les limites écologiques et qui fonctionne pour l’humanité toute entière. La réponse doit aller au delà des remèdes managériaux et technologiques superficiels et s’engager dans des transformations systémiques profondes pouvant seules ébranler les injustices structurelles, l’insoutenabilité écologique de notre système actuel et la destruction du futur qui est en train de se produire. Nous avons besoin d’un changement radical qui aille dans le sens d’une démocratie authentique. Celle-ci placerait sa confiance dans le génie déjà éprouvé par le temps des communautés et des collectivités locales.
Nous contestons le vieux mode d’existence eurocentrique fondé sur la séparation des humains et des autres entités naturelles – nous contre elles, esprit contre corps, sécularité contre spiritualité. En niant l’interdépendance essentielle des êtres et des choses existant sur terre, cette façon dualiste de penser et d’être vise simplement à asseoir la domination du pouvoir masculin sur la valeur féminine du care (ou du « prendre soin ») qui privilégie la vie sur toute autre chose. Cela a donné naissance à la forme la plus objectifiante et néfaste d’économie que l’homme ait jamais connue, celle-ci étant aujourd’hui enchâssée dans un (dés)ordre largement mondialisé, militarisé, capitaliste et néolibéral.
La pandémie nous apporte avec elle son lot de leçons à apprendre. La mondialisation économique, qui a entrainé le mouvement sans restriction des produits commercialisés, de la finance et des personnes, n’a pas apporté la prospérité universelle escomptée mais bien plutôt la dévastation écologique, le dérèglement social et les inégalités. C’est pourquoi nous voyons, dès à présent, sur tous les continents, des penseurs et des activistes militer pour remplacer le régime capitaliste par la re-communalisation, œuvrer à l’autonomie et même accueillir des réfugiés et d’autres individus dans le besoin. Contre les conditions dictées par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et les entreprises multinationales, ce mouvement en faveur de la production à échelle humaine invite les peuples à façonner par eux-mêmes leur mode d’existence de façon à préserver leur habitat.
La relocalisation pourrait même renverser le flot désespéré de migration des campagnes vers les villes (exode rural), dans lesquelles la densité de population entraîne si facilement la propagation de maladies comme le coronavirus. Est-ce seulement un vœu pieux ? Non. En regardant autour de nous, nous voyons des milliers d’initiatives culturelles diverses se développer en faveur de l’accès à la nourriture, l’énergie, l’eau et d’autres formes de souveraineté communautaires. De telles solutions localisées redonnent du sens, une identité, de la dignité, et de l’autosuffisance aux peuples qui ont été aliénés par un siècle de soi-disant progrès mené par les pouvoirs étatiques centralisés et économiques.
Les révolutions populaires qui se développent marquent un changement d’orientation et d’attention depuis une économie précaire fondée sur les produits dérivés et les marchés vers une véritable économie axée sur la production de biens utiles, le don et le partage de services. Cela témoigne d’une vision défendant l’autonomie de régions bio-culturelles définies par des relations sociales et écologiques réelles. Contre la privatisation néolibérale, la terre et l’eau, les idées et le savoir sont ici honorés comme des biens communs. Cette perspective future implique la nécessité de la décroissance, un respect des limites naturelles, une réduction de la production des matériaux et de l’énergie sur la planète ainsi que leur meilleure redistribution.
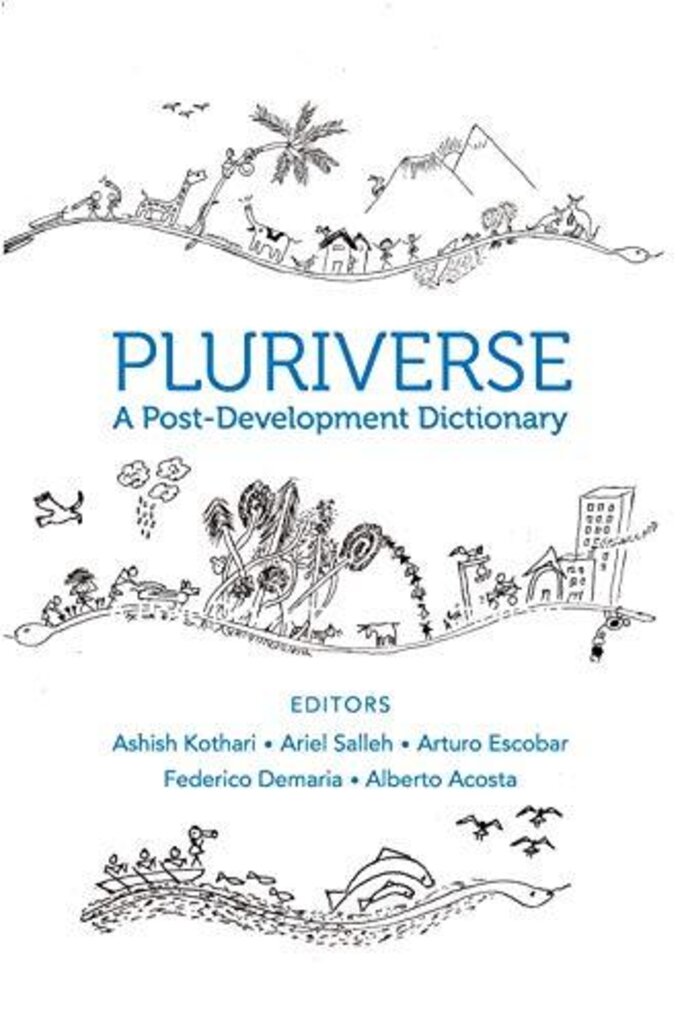
Aujourd’hui, à travers le monde, nous assistons à un renouveau de la démocratie radicale, souvent mené par des femmes ou par la jeunesse, dont les élans en faveur de la vie se combinent avec l’énergie des mouvements sociaux qui luttent pour la libération des espèces, des genres, des castes, et des classes sociales oppressées. Notre livre, Pluriverse: A Post-Development Dictionary rassemble une multitude d’alternatives transformatives de ce type. Nous trouvons, entre autres, la réaffirmation des groupes indigènes en faveur d’une vie en harmonie avec la terre à travers les concepts de « Buen Vivir » et de « Ubuntu ». Il y a aussi l’émergence de nouvelles notions, comme l’écoféminisme ou la décroissance, qui émergent de la déstructuration des contextes industriels, ou encore l’essor des réseaux pratiques en faveur de l’agro-écologie et des logiciels libres. Et tant d’autres.
Le livre souligne le contraste saillant existant entre de tels changements structurels profonds et les solutions réformistes aujourd’hui proposées par nos institutions qui présupposent l’existence d’un monde unifié et globalisé défini par les valeurs occidentales et mu par la logique futile et destructrice de la croissance. Ce qui en émerge, c’est un langage vivant plaidant pour la richesse et la diversité des savoirs et des pratiques des peuples respectueux du bien-être planétaire. Ce lexique offre A Global Tapestry of Alternatives, un espace collaboratif pour les activistes qui tissent ensemble un réseau d’initiatives transformatives à travers la planète. Il s’agit là d’un nouvel horizon pour l’être et pour le faire.
La pandémie du coronavirus met fin à un univers de fausses promesse. Le plurivers est porteur de nouveaux espoirs en faveur d’une démocratie radicale qui inclut l’intégralité de la vie – « un monde ou beaucoup d’autre mondes ont leur place ».
Traduit de l'anglais par Anne Fremaux
Biographies
Les cinq auteurs sont les éditeurs de Pluriverse: A Post-Development Dictionary
Ashish Kothari est avec Kalpavriksh et Vikalp Sangam en Inde et est co-éditeur de Alternative Futures: India Unshackled.
Ariel Salleh est une universitaire australienne, auteur de «Ecofeminism as Politics» et éditeur de «Eco-Sufficiency and Global Justice».
Arturo Escobar enseigne à l'Université de Caroline du Nord et est l'auteur de Encountering Development.
Federico Demaria est professeur en économie écologique et en écologie politique à l’Université de Barcelone et co-éditeur de «Décroissance: un vocabulaire pour une nouvelle ère».
Pour plus d'informations sur le livre, voir ici. «Plurivers: Un dictionnaire du post-développement» est constitué de plus de 100 essais allant des alternatives transformatrices aux processus actuellement dominants du développement mondialisé. Parmi les auteurs, vous pourrez reconnaître Vandana Shiva, Serge Latouche, Alain Caillé, Wolfgang Sachs, Silvia Federici, et bien d’autres.
Vous pouvez lire le livre en anglais et en espagnol. Nous espérons qu'il sera bientôt publié dans de nombreuses autres langues. Nous recherchons une maison d'édition en France; n'hésitez pas à contacter Federico Demaria si vous avez des conseils.




