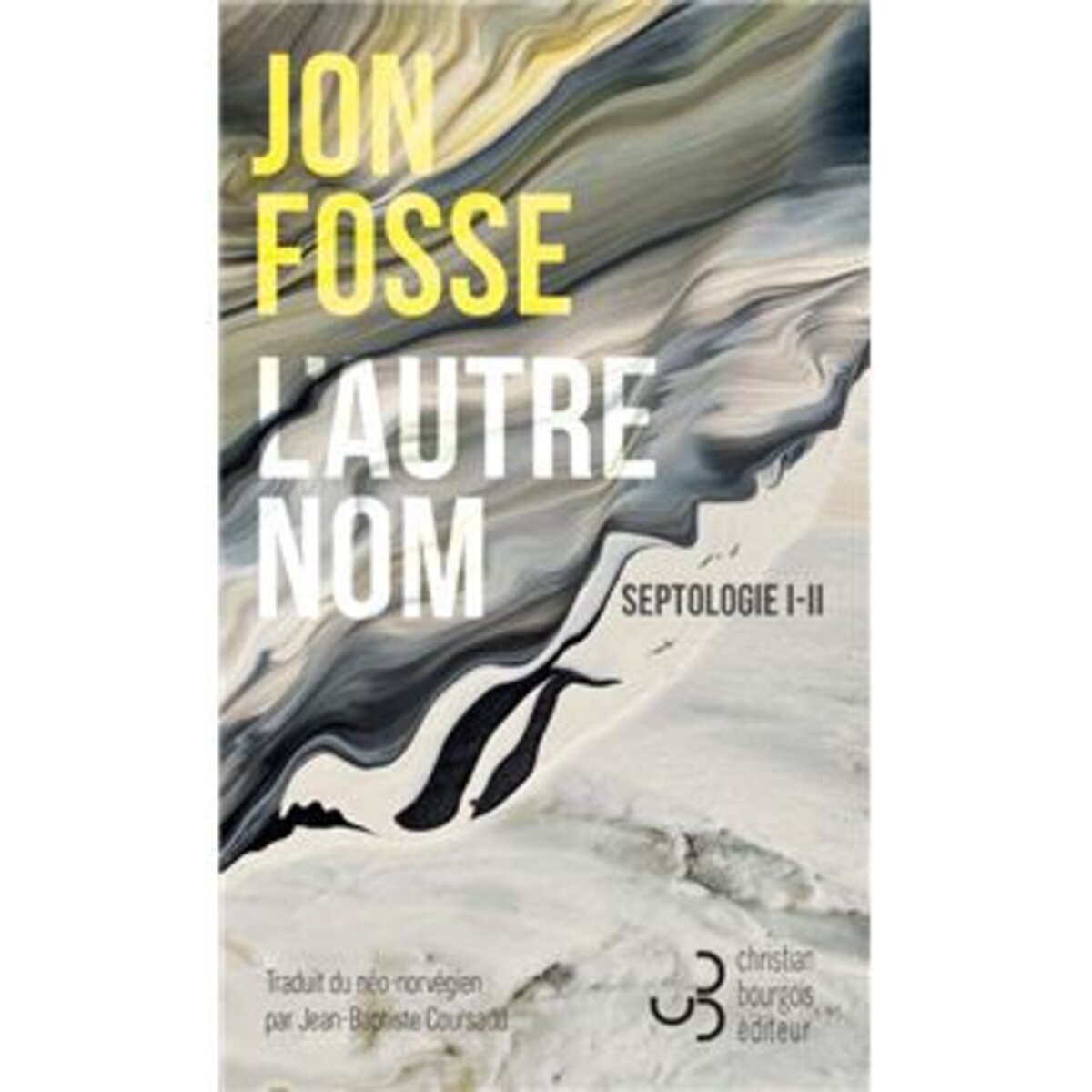
GENÈSE DE LA DÉCOUVERTE D'UN ÉCRIVAIN EUROPÉEN MAJEUR
Il y a des écritures, des littérateurs de si puissante portée, qu’on se retrouve, chaque fois qu’un nouveau livre est édité, de vouloir les lire… tout aussi bien avidement que lentement. Apparent paradoxe, s’il en est, mais ceux qui connaissent cette pulsion animée des plus vrais désirs, doivent savoir ce que je veux évoquer là.
Jon Fosse, auteur norvégien, d'une discrétion quasi légendaire alors qu'il a été récompensé par les plus fameux prix littéraires européens, fait partie, selon moi, de ceux-là. Depuis sa découverte, en 1997, suite à une commande tout à fait hasardeuse, lorsque je fus engagé comme conseiller artistique à la toute jeune Comédie de Valence, parmi d’autres titres, de manuscrits, à la Maison Antoine Vitez (organisme de traduction théâtrale internationale, initiée par feu le metteur en scène Jacques Nichet) et le saisissement puissant ressenti à la lecture de Quelqu’un va venir, chacune de ses œuvres appréhendée, n'a eu de cesser de constituer, pour moi, une aventure. Je fus, naturellement, à la fois surpris et pas vraiment étonné, lorsque, cette même année 1997, à la faveur d’une conversation avec Claude Régy à qui je me permettais d'indiquer l'existence dudit manuscrit, - parce que je pressentais qu’il saurait captiver son attention-, le metteur en scène éclata d’un rire un peu nerveux puis, avouant être un peu estomaqué, me demanda par quel mystère ou fruit du hasard, je connaissais ce texte. Car, m’annonça-t-il alors, il était justement en train de travailler aux préparatifs de cette pièce, de boucler le budget pour sa création en France. Ce qui fut fait deux années plus tard et en parfaite symbiose avec la dramaturgie plutôt inédite de l’auteur, en 1999, au Théâtre des Amandiers de Nanterre, avec, dans les rôles principaux, Yann Boudaud, Valérie Dréville et Marcial Di Fonzo Bo. Sans avoir besoin d’un assentiment absolu du Maître scénique, le fait est que, renforcé dans ma conviction qu’un tel écrivain compterait décidément, je n’ai jamais, à quelques rares exceptions près, manqué de lire, par la suite, les autres textes de Jon Fosse, et pas seulement les oeuvres théâtrales. Après Quelqu’un va venir, Régy continua, quelque temps, à explorer cette écriture, avec, surtout Melancholia (dont il tira un spectacle encore plus magistral car encore plus radical mais ô combien poétique et bouleversant) puis Variations sur la Mort, tous deux créés à la Colline, théâtre national. Bien sûr, Patrice Chéreau, souvent un peu en retard, à de nombreuses occasions, de créer des textes découverts bien avant lui, s’attela aussi à quelques œuvres de Jon Fosse, mais il y manquait, souvent, une sacralisation pourtant rémanente de la stylistique du norvégien.
Cet été, lorsque j’ai appris qu’un nouveau roman de Jon Fosse allait paraître, aux éditions Christian Bourgois, je fus, bien sûr, aussi impatient et inquiet qu’on peut l’être, lorsque, par exemple, la perspective de revoir un amour lointain ou d’anciens amis éloignés quelque temps, vous étreint.
L’autre nom - c’est le titre de ce nouveau récit traduit par Jean-Baptiste Coursaud, se résume, comme souvent avec Jon Fosse, à une histoire en apparence fort simple : Asle, un peintre vivant sur la côte sud-ouest de la Norvège, s’interroge, perplexe, sur une toile qu’il ne se décide pas vraiment ni à achever ni à considérer comme pleinement satisfaisante en l’état. Solitaire (sa femme est décédée quelques années plus tôt) mais parvenant à bien vivre cette condition, seulement entouré de ses deux amis que sont son voisin, Asleik, un pêcheur, et Beyer, son galeriste qui vit à Bjørgvin, l’obsède, aussi et surtout, la présence, précisément dans cette grande ville d’à côté, d’un comparse nommé... Asle et peintre, lui aussi, mais dont la santé fort défaillante - il est alcoolique et atteint de crises de tremblements récurrents - fait craindre que ses jours soient désormais comptés.
FACE À L'IMAGE
C’est ainsi que l’on s’immerge, peu à peu, dans la narration qui, lentement, déploie à la fois ses subtiles enjambées et les économise tout autant pour nous faire comprendre, peu à peu que les deux hommes Asle, les deux peintres Asle, ne sont, peut-être, qu’une seule et même personnalité. Pas vraiment scindée en deux, mais cependant à la fois gémellaires et dissemblables. Ce trouble de l’identité n’est due, au fond, qu’à l’écriture, car rien, dans l’enchaînement des séquences qui scandent le récit, ne fait apparaître le scotch qui superposerait ainsi, de façon, plus ou moins grossière, deux pans narratifs et leurs divers motifs, un procédé d’écriture déjà tenté et éprouvé par d’autres auteurs.
Alors, on revient aux premiers mots des premières pages et on relit/relie le tout : « Et je me vois debout face à l’image avec ses deux traits, un marron et un violet, qui se croise dans le milieu, une image oblongue, je me vois la regarder, et je vois que j’ai peint les traits avec une grande lenteur, avec une épaisseur dans la peinture, qui a coulé, la couleur se mélange à l’endroit où se croisent la petite ligne violette et la marron, avant de couler vers le bas, et je songe que ce n’est pas un tableau, mais en même temps l’image est telle qu’elle doit être, elle est terminée, il n’y a rien à ajouter »
Comment, dès lors, ne pas considérer que ces premiers mots révèlent le principe même de l’écriture et de la thématique du livre ? Ces deux traits, ne sont-ils pas ces deux Asle, se côtoyant apparemment mais aux teintes si fraternelles qu’on pourrait les confondre ? (marron et violet ne sont pas des couleurs primaires comme on le sait, mais restent proches sur un nuancier). Quant au jeu sur les teintes qui coulent vers le bas, n’est-il pas une métonymie de la destinée ?
Plus savamment sans doute qu'à son habitude, Jon Fosse parvient, tout au long de son roman, à tenir la gageure de confondre les profils de deux personnalités, tout en veillant à les tenir à distance l’une de l’autre.
Le soutien qu’il se reproche de ne pas assez apporter à son confrère, le peintre Asle débarrassé de l’addiction à l’alcool qu’il a fini par dompter, n’émane-t-il pas, au fond, d’une voix intérieure que le peintre Asle presque condamné et vivant seul avec un chien -qu’il néglige autant que sa santé et son logis-, entend pour se persuader de s’estimer davantage afin de se « sauver » ?
Dans un passage où les deux hommes se retrouvent réunis dans un bar, l’effondrement d’Asle tremblant secouru par Asle bien portant qui a appelé les urgences médicales, donnent le ton à ce dialogue incessant entre conscience lucidement trop loyale et conscience embrumée par les éthers de l’alcool.
"UN BON LIVRE EN SAIT TOUJOURS PLUS QUE SON AUTEUR..."
Jon Fosse parvient ainsi, de manière inouïe, à superposer, comme en peinture, des aplats de couleurs aux nuances presque imperceptibles mais néanmoins réelles, à qui veut vraiment voir et lire, au-delà des apparences pas assez fugacement balayées et écartées, comment nous sommes tous doubles, au moins. Le lecteur peut aussi se représenter comment, selon certaines péripéties de l’existence, celui qui s’est « sauvé » de la débâcle, peut tout de même songer qu’il suffirait de presque rien pour y plonger, est fraternel de celui qui, ayant, en apparence sombré, se souvient qu’avant la chute, il aurait pu choisir une autre voie loin des souffrances qui, désormais, le dominent.
Naturellement, la stylistique y est pour beaucoup et, si le récit vous entraîne, comme malgré vous, comme sur les flots d'une mer qui connaît les roulis et ressacs à rythmer afin de mieux vous enrôler, vous ne lâchez pratiquement plus le livre. Car la musique (rendue particulièrement sensible grâce à Coursaud), la scansion, l'effet de répétition de certains mots, contribuent à hypnotiser le lecteur.
"Je travaille comme un musicien qui joue sa partition, thème et variations, répétitions, da capo.
Je m'assieds, je ne sais rien, parfois je passe directement du sommeil à l'écriture. Je n'ai pas de plan, je sais seulement qu'une chose doit s'accorder avec celle qui suit, et il faut que je l'écrive avant que ça ne disparaisse. Il m'arrive parfois d'écrire très vite.
Un bon livre en sait toujours plus que son auteur.
Les interprétations de l'auteur, je n'aime pas ça, dans la mesure où elles peuvent être perçues comme faisant autorité. (...) Seuls mes textes ratés sont sans ambiguïté, les bons, on peut les retourner comme un gant. " (2)
On reste, finalement, abasourdis par autant de maîtrise stylistique, permettant à chacune-e de voir comment il/elle peut s’imaginer vivre ou avoir vécu tantôt chancelant-e, tantôt solide, tantôt dans l’entre-deux de ces conditions.
Précisons que le texte, de 425 pages, abolit tout point de fin de phrase mais use d’un peu plus de 7800 virgules. Il est, en cela, très proche du procédé choisi par Thomas Bernhard, pour son roman Des arbres à abattre. Fosse partage, avec l’écrivain autrichien, un goût manifeste et jamais gratuit pour la répétition de mots, formules souvent sculptés dans la glaise du « for intérieur ». Ces ratiocinations agissent, littéralement, comme la révélation d’obsessions dont nous sommes tous, à notre inconscient défendant, plus ou moins dépendants. Autant chez Bernhard, ce principe réitératif agit-il de façon plutôt formelle et visible, autant, chez Jon Fosse, il s’insinue de manière plus discrète et presque accidentelle.
La traduction de Jean-Baptiste Coursaud, pour peu qu’on puisse juger d’une langue que nous ne maîtrisons pas, semble assez impeccable. En cela, elle succède, plus que dignement, aux qualités déjà reconnues du premier traducteur de Fosse, Terje Sinding. Allitérations, correspondances syntaxiques ou lexicales, travaillées, sondées, donnent à ce récit prégnant, quasi hypnotisant, toute la valeur littéraire qu’il recèle. Loin, très loin des avaries, avarices des récits qui se servent de l'écriture comme en ne pensant jamais à la valeur de chaque mot, syllabe, cousinage et rapprochement entre eux ou elles: comment, inconsciente, sûrement, une impression furtive attend d'être balbutiée, patiemment, sur le papier, et comment, en la répétant, avec d'infimes détails légèrement changés, elle finit par trouver le chemin vers l'éloquence qui n'assène rien, mais offre ses possibilités de correspondances avec d'autres.
On pourrait croire, à lire ces considérations, que L'autre nom est un roman abstrait. Il n'en est rien, pourtant. Même s'il fraie, parfois, vers des interrogations presque métaphysiques, tous ses éléments puisent pourtant dans la grammaire d'un réel qu'on pourrait qualifier d'"arrangé". Non pas arrangé comme transformé, mais arrangé dans une tête qui compte sur l'irruption d'une pensée inédite, si minime ou impossible soit-elle, et qui va se coaguler aux émanations, fascinations ou dégoûts d'une image.
"L'art doit dire ce qu'il a à dire surtout à travers sa forme; et j'utilise le mot forme dans un sens très large, ce qui est plus comme une attitude que comme un concept. Ce qui est contenu pour les autres est forme pour l'artiste, comme disait Nietzsche. En disant cela, je parle presque comme si j'étais un homme de théorie, ce que je ne suis pas. Je suis un homme pratique, un écrivain pratique..." (3).
Gardons-nous bien de trop révéler tout ce que draine et charrie L'autre nom... Or, on pourrait pourtant encore raconter comment, justement, cet "autre nom" n'est pas qu'un effet de dédoublement emboîtant deux personnalités. Il emprunte à un livre sacré, sa mystérieuse connotation, car le roman finit par nous apparaître comme la tentative énergique, vivace, d'individus qui savent que le monde manque parfois de dimension spirituelle et que, à leur humble niveau, peu importe qui ils sont, comment ils peignent, vivent, bousillent ou protègent leur propre existence. L'Art les maintient en vie, les épargne ou les gâche mais leur apporte ce gain supplémentaire d'espérance en une existence qui s'ingénie à masquer sa compétence à savoir lire tous les signes que contiennent ou retiennent ou non une icône, une lueur, un son, afin qu'advienne un nécessaire réconfort.
"... et je lui donnerai un caillou blanc.
Sur ce caillou est écrit un nom nouveau
que personne ne connaît,
si ce n'est celui qui le reçoit."
Il n'est, bien sûr, pas hasardeux que Jon Fosse ait choisi, en guise d'exergue à son livre, cet extrait de L'Apocalypse. S'il n'est pas la seule clef qui entrebâille les divers sens à son récit, il en constitue peut-être la serrure par laquelle chacun(e) pourra voir, apercevoir, un tant soit peu, dans les images, les descriptions, les dialogues, écouter et entendre d'autres voix dans l'intérieur-ténèbres qui loge en-dedans de nous. Et que nous aurions bien tort de continuer à redouter...
Notes:
(1) L'autre nom, Septologie I-II de Jon Fosse, traduit du néo-norvégien par Jean-Baptiste Coursaud, © éd. Christian Bourgois, Paris, 2021, p. 13
(2) Extraits de Fosse, simple et compliqué, entretien paru dans le journal Aftenposten, le 12/05/1996, traduit du norvégien par Terje Sinding.
(3) Extrait d'un texte rédigé en anglais, in Ecrits gnostiques, traduction Sébastien Derrey, 1997.



