Rien qu'un fantasme
Sur toi qui te caches
Toi qui te tais
As-tu vraiment existé?
psalmodie Françoise Hardy dans ses Brumes, l’une des chansons de son dernier album paru en 2018, « Personne d’autre ». Et ces quatre vers pourraient bien résumer l’obsession de l’artiste, distillée au gré à gré dans nombre de ses œuvres, à propos du sentiment amoureux que lui ont inspiré les hommes et, en particulier, Jacques Dutronc, avec lequel l’histoire compliquée d’une liaison contribua à forger une légende de notoriété aisément publique, ourlée d’atermoiements, d’attentes interminablement frustrées, de contrariété, chagrins, bords de rupture et liens à couteaux tirés. Qui ont moins alimenté le mensonge romanesque des Unes de journaux avides de sensations, que la vérité romantique d’une discographie fournie, régulière, contrastée, malgré les apparences d’univocité mélancolique qu’elle défendait ardemment. Et que le sempiternel refrain de ses débuts Tous les garçons et les filles ne saurait cependant, loin de là, résumer à lui seul, tant il occultait -hélas- la valeur autrement plus probante et subtile d’autres titres écrits, composés par et pour elle ou, plus rarement, par et pour et avec d’autres : Jacno, Diane Tell, Serge Gainsbourg, Etienne Daho, Alain Lubrano… (liste non exhaustive).
GOÛTS ET DONS POUR LE CLAIR OBSCUR
Mais ces mêmes quatre vers pourraient également traduire le sentiment d’irréalité que la chanteuse, elle-même pouvait susciter. Personnalité complexe qui s’abritait derrière des logorrhées de paroles exposant un rapport au manque affectif torturant ou un rapport au corps trahissant une hypocondrie irritante puisque persistante, Françoise Hardy ne dévoilait au fond rien de si intime, tant dans ses chansons qu’au sujet de sa vie calfeutrée entre logis près du Parc Monsouris dans le gris de Paris et Villégiature dans les lumières d'une Corse solaire. Et c’est sans doute-là, dans ce « Clair-obscur »(titre de son disque paru en 2000) où elle se tenait à l’écart des vociférations alternatives du monde d’un show business réputé libérateur, qu’il y a lieu d’appréhender surtout l’artiste, la femme préférant se verrouiller vraiment dans un quant à soi farouchement déterminé.
Les pochettes de ses dix derniers disques attestent, d’ailleurs, pour la plupart, de ce goût pour la pénombre. Cadrée presque toujours au niveau du seul visage angulaire éclairci par la blancheur d’une crinière savamment ordonnée, elle effaça le plus souvent possible un profil longiligne sitôt sa jeunesse ayant bien précocement "foutu l'camp", c’est à dire vers 30 ans. Incapable de disparaître sous imperméable ou robe en lamé typique des années 70, harnachée de pièces métalliques assemblées dix ans plus tôt par un Paco Rabane certes, inventif mais fier de concevoir des robes « importables », la relative grande taille de Françoise Hardy fut peut-être à la fois atout et malédiction. Elle fit long feu des fantasmes de musiciens célèbres mais renonça très vite à la scène, pour cause de trac indomptable qui paralysait ses meilleures volontés. Signe d’une santé fragile, incompatible avec les efforts exigés par un métier très physique, sa voix d’une tessiture modeste n’aurait pas su galvaniser des foules en direct. Sans compter que, comme déjà évoqué plus haut, son répertoire, à tendance mélodique vitrifié par une immuable nostalgie, ne se prêtait guère à l’exercice du gala et des frivolités que ce genre de spectacles présuppose. On le lui reprocha, comme on railla le ton fluet, voire monocorde et atone par lequel elle s’empara des mots de Louis Aragon pour sa reprise de la chanson de Georges Brassens, «Il n’y a pas d’amour heureux» qui, à elle seule, synthétiserait assez bien l’humeur de bile sombre par laquelle Françoise Hardy aimait, dans des langueurs ou sursauts que d’aucuns qualifiaient de trop masochistes, faire à peine varier son appétence pour une vie parfois contrainte par l'assaut répétitif des déceptions sentimentales.

Agrandissement : Illustration 1

TEXTES ET MUSIQUES : TOUJOURS À PARTS ÉGALES
Autrice presque toujours de ses textes (sauf à ses débuts), son goût pour les mots agencés de telle sorte qu’ils puissent retranscrire de micro sensations, des sentiments très fugaces et des peines fugitives, l’entraîna aussi à écrire quelques livres au premier rang desquels « Le Désespoir des singes et autres bagatelles » (2008) , à vocation autobiographique reste le plus notoire, -quoique trop bavard puisque se perdant dans des circonvolutions dissimulant mal l’absence de style, au profit d’anecdotes égarant le propos.
Grande lectrice, elle se risqua trop peu, dans ses chansons, à évoquer les livres qui galvanisaient ses états d’âme. Mais « Dix heures en été », issu de l’album trop méconnu « Le Danger » paru en 1996, est une très loyale adaptation musicale et chantée d’un roman de Marguerite Duras. Âpre et rugueuse avec ses accents rocks, la musique de Rodolphe Burger contribue à condenser le récit d’un amour noyé par la trahison des faux semblants et à creuser un contraste saisissant avec la voix feutrée de l’interprète, rendant ainsi bien compte de l’enjeu du roman : établir un parallélisme entre les raisons de la mort d’un amour et la traque d’un criminel.
Si son « Amour fou » ne doit rien à André Breton, un poème de Victor Hugo (« Si vous n'avez rien à me dire ») s’immisce de façon si naturelle dans ce disque de 2012, qu’on croirait, toutes proportions gardées, le texte écrit par Hardy elle-même.
La chanteuse ne faisait pas forcément grand cas de la valeur de ses paroles, quoique elle se montra souvent intraitable pour qu’on ne les écorche pas. Pas plus que celles des autres qu’elle reprenait volontiers à condition qu’elles soient serties et servies par des musiques et arrangements adéquats. C’est ainsi que, reprenant « Seras-tu là » de Michel Berger pour son dernier opus, elle reconnut qu’après une tentative échouée (selon elle) avec Julien Clerc à l’initiative d’une proposition de duo pour cette chanson, non conquise par le résultat, elle souhaita plutôt imposer sa version solitaire et personnelle.
Bien moins élaborés que ceux d’Anne Sylvestre, -qui ne manqua pas, en excellente pionnière, de rappeler, fort justement, qu’elles n’étaient guère nombreuses, dans les années 60 à pouvoir revendiquer d’être à la fois autrices-compositrices-interprètes-, les strophes et refrains de Françoise Hardy ne l’ont pourtant jamais hissée au rang des chanteuses « à textes ». Ce hiatus était évidemment dû à la fois aux univers très cloisonnés qu’étaient celui des « yéyés » et celui de la chanson de variétés mais surtout à l’attachement viscéral de celle-ci pour des musiques qui comptaient autant, sinon plus, que les mots. La suite de son itinéraire permit que le hiatus s’émousse et soit moins prononcé.
Comme pour ses amours fuyantes, maladroites ou franchement désespérantes, ses atouts indéniables pour la chanson, c’est à dire l’art d’assembler au plus juste paroles et musique, ont été souvent déviés par des malentendus. L’album « La Question » (1971), qui reste comme l’un de ses meilleurs, à l’instar du « Danger » (cf plus haut) n’a pas été accueilli avec la ferveur qu’il aurait dû susciter. Elle s’en désolait, constatant, fataliste, que toute tentative de sophistication ou de brèche ouverte pour faire évoluer un style, était découragée par la frilosité des medias autant que de certains auditeurs. Mais le public qui lui était très attaché et qui, au contraire, s'enthousiasma pour ces deux volumes, savent combien « Doigts », « Mer », « La Question », « Même sous la pluie », « Le Danger », « Dix heures en été », « L’obscur objet », « Regarde-toi » sortent vraiment du lot. Hardy a toujours dit combien l’enregistrement de « La Question » fut pour elle heureux, car étroitement conçu en complicité avec Tuca, artiste et poète brésilienne suicidée, quelques années plus tard. « C’est un de mes meilleurs souvenirs d’enregistrement […] Il y a dans ce disque une atmosphère, une homogénéité entre la composition et la réalisation musicale. » (1)
Réputée féroce critique, Françoise Hardy l’était assez quant à sa propre trajectoire. Si elle ne les renia évidemment pas, elle reconnut que, dans les années 80, après le ras-de-marée provoqué par le disco, les albums « Musique saoule », « Gin tonic », « A suivre », sur des rythmiques trépidantes, contraires à son goût pour la lenteur des balades, n’ont pas suffisamment correspondu à sa personnalité réelle. Un peu perdue par le monde de la musique, au profit d’une activité pour le moins tendancieuse et aléatoire (l’astrologie), elle fut tentée, plus d’une fois, de cesser d’exercer son vrai métier. Redoutant surtout ce qui était imposé par ses maisons de disques, les tournées promotionnelles dans les médias, malhabile à évoquer son travail, elle se réfugia plus souvent qu’à son tour pour contourner la difficulté de l’exercice, dans le réflexe d’énoncer son avis sur à peu près tout, entraînée par des journalistes ou animateurs qui abusaient de son franc parler, afin de mettre en avant des propos fleurant bon le registre réactionnaire, comme autant de témoignages de son positionnement politique plutôt conservateur, donc à droite. Autant dire que, dans les années 80, il n’en aurait pas fallu bien davantage pour se retrouver, au moins sur les plateaux de télévision, persona non grata .
Heureusement, pendant la décennie 2000 et les suivantes, Françoise Hardy renoua avec le goût de concevoir en toute indépendance des disques fidèles à ses tempéraments. « Tant de belles choses », en 2005 est à la fois une chanson et un disque tout entier voués à livrer un regard distancé par une certaine sagesse sur l’inconstance du monde et surtout des êtres. Si le titre principal égrène des conseils avisés d’une mère à son fils pour la façon d’avancer dans la vie en se faisant le moins mal possible (de l’aveu même de l’artiste qui l’écrivit à son enfant unique, Thomas Dutronc surpris par elle les larmes aux yeux à l’idée de sa mort prochaine), la chanson « Tard dans la nuit » évoque le profil inquiétant car manipulateur d’un homme mettant en péril son couple à force de dissimuler, aux yeux d’autrui, la violence qu’il ne refoule plus dans l’espace privé. Discrète allusion à la tragédie vécue par Marie Trintignant, deux ans plus tôt ? Chanson plus générale sur les féminicides ? Nul n’a songé à interroger Françoise Hardy à ce sujet. Et pourtant…
Elle n'est pas celle qu'il faut blâmer
Tant de rêves partent en fumée...
Mieux vaut raser les murs
Les rues ne sont pas sûres
Derrière les portes blindées
Des chiens aboient sans pitié...
Nul n'a pu dire
D'où les coups sont partis
Tard dans la nuit...
COURTOISIES D’UN DÉPART
Il est vrai que la chanteuse n’a jamais eu l’habitude de mettre en mots et en musique des considérations réellement philosophiques et encore moins politiques ou sociétales. Il n’en reste pas moins qu’à partir de 2005, les confessions, susurrées dès lors, empruntent des tonalités bien moins sombres qu’ont pu être celles de « Chanson noire », « L’impasse », « Fatiguée ».
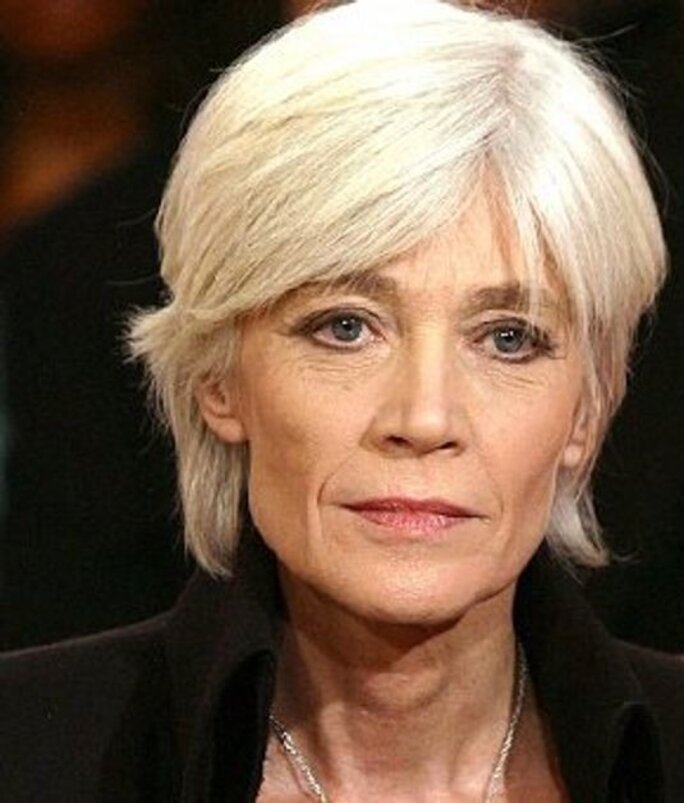
Agrandissement : Illustration 2
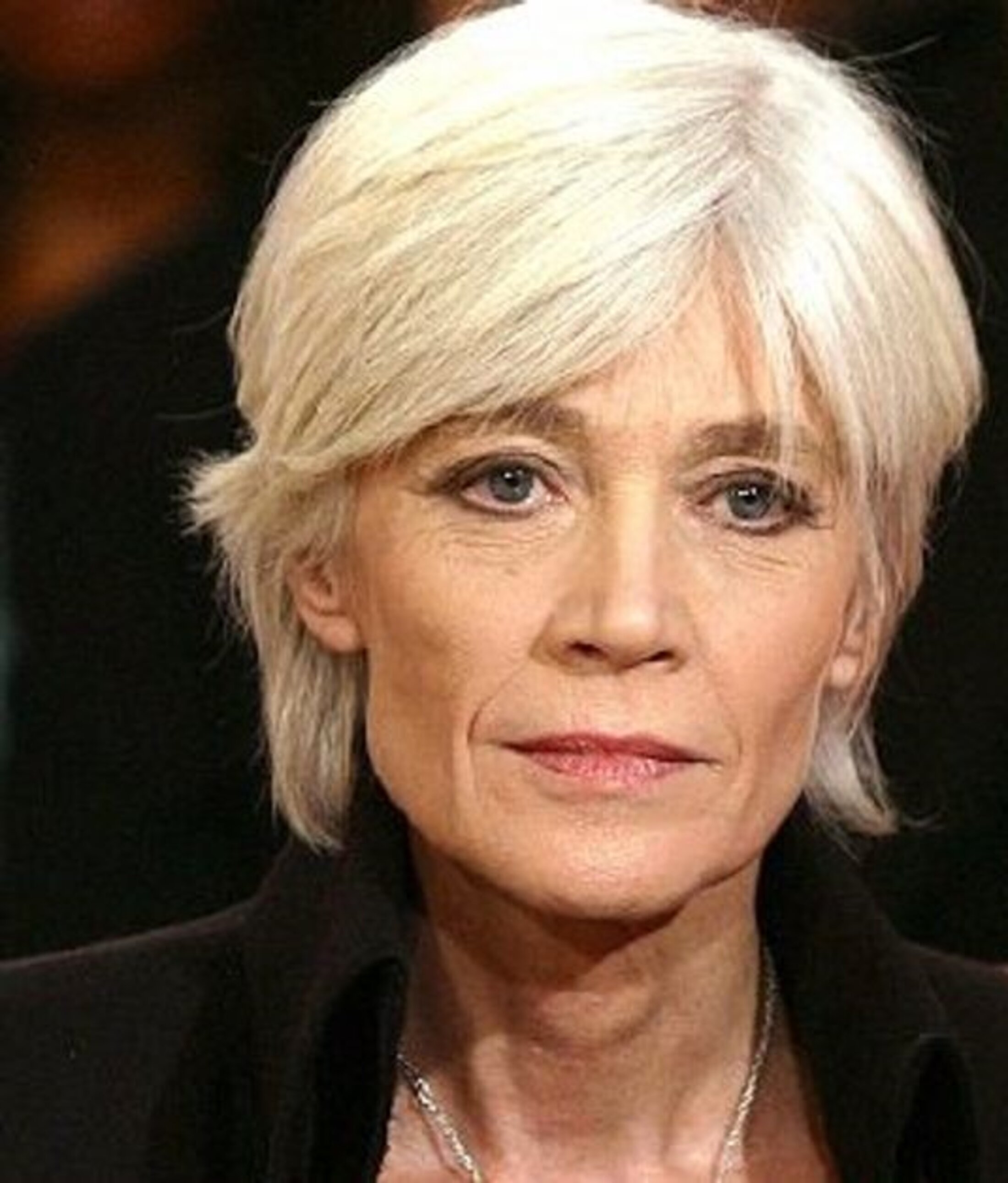
Semblant avoir renoncé à choisir d’être ou sophistiquée ou viscéralement populaire, la liberté qu’elle s’accorde pour créer ce qui lui chante est absolue. Et trouve sa résolution, entre autres grâce à sa valorisation pour de plus jeunes artistes, comme en témoigne son adaptation de la chanson « Sleep » du groupe finlandais Poet of the fall ("poète de la chute", tout un programme) devenue « Dors, mon ange », en 2018. Car Hardy mettait un point d’honneur à inlassablement écouter et découvrir de nouveaux talents, mue par sa passion musicale. Et à les plébisciter.
On pourrait sans doute choisir ce semblant de berceuse pour adultes en guise de dernier hommage circonstancié à la disparition d’une artiste qui est malgré tout et surtout malgré ses aléas, demeurée -pour certaines générations seulement nous objectera-t-on immanquablement- populaire.
Presque trop ? À constater la place un tantinet modeste qui lui est accordée à la Une des medias, depuis la nouvelle de son décès survenu hier, 11 juin, si on la compare à celle qui envahit journaux et télévisions au soir de la mort de Johnny Halliday, on pourrait penser que ce « populaire »-là, pourtant appelé de ses vœux par diverses formations politiques, dans l’actualité tordue de façon opportuniste et violente par notre actuel Président de la République, n’est pas assez probant.
Les mots de sa chanson « Un seul geste » pourraient cependant contribuer à clarifier une hauteur de vue, ironiquement offerte à tous ceux qui, en ce moment, dans la classe politique, s’improvisent capitaines de forfanteries, risquant des alliances plus que douteuses, osant des rapprochements insidieux et révélant, au bout du compte, l’inanité des départs et décisions précipités :
Ni direction ni boussole
Ni signal ni repère
Rien qu'un banal jeu de rôle
Sans endroit ni envers
Trop de paroles en l'air
Et voilà qu'on s'y perd
Où aller, que faut-il faire?
(...)
Un seul geste pourrait-il faire apparaître
Au bout du chemin peut-être une porte ouverte?
Suffirait-il d'un seul geste, nous parler lâcher du lest
Essayer de nous connaître pour pouvoir renaître
Hardy, elle, d’une prévoyance distinguée et courtoise puisque lucide, eut au moins le réflexe de préparer et annoncer son dernier exil : presque nonchalante, l’avant dernière chanson du disque « Personne d’autre », mise en images par le cinéaste François Ozon, « Le Large » semble dessiner un pied de nez provocateur à la mort (Hardy, on l’a su, milita activement pour la permissivité légale des fins de vie volontaires dans la dignité). Ce n’est pourtant pas celle qu’on retiendra pour adresser un dernier salut lointain à la Mélancolique. Contrairement à ceux qui fomentent fausses sorties, tapages et chantages, on préférera murmurer à «Quelqu'un qui s'en va» dans la dignité :
Et toi où que tu sois exilé
Autre temps autre espace
Autre conquête
Ma mémoire se brouille un peu
Elle invente me prend en traître
(...)
Même un cœur sorti du jeu
Risque de battre encore peut-être
Pour un signe ou deux
Pour un signe ou deux (2)
Notes :
(1) : Françoise Hardy in Éric Dumont, Notes secrètes, éditions Albin Michel, 1991.
(2) paroles de la chanson « Personne d’autre », album éponyme, 2018.



