Imaginez un été 1986 à vivre à Thetford Mines, petite ville du Québec de la région des Appalaches. Dans un environnement âpre, un paysage à la fois brutal, minéral et bruyant. Celui en lequel le forage des mines d’amiante, en impétueux souverain, gouverne tout et, surtout, rythme les journées harassantes d’ouvriers sans cesse aux abois, mal payés pour un labeur qui les rend d’autant plus vulnérables qu’ils ne mesurent pas encore le prix des dangers encourus d’être ainsi sur exploités, en pareil contexte hostile. Car l’amiante, en effet, est partout, sous forme de terrils, tumulus, dômes et cratères, elle colle à la sueur tel un talc labile, que les souffles d’air ventilent quotidiennement et pis: elle paraît opacifier, de son vernis grisâtre, le moindre horizon à perte de vue.
Imaginez qu’au début de cet été 1986, malgré ce cadre défavorable, parvient à pousser, au milieu de cet espace lunairement désertique, la verdeur d’une fleur rare : une amitié naissante et forte entre deux jeunes garçons. Bien vite irriguée par des escapades, jeux, des lampées de cidre doux et des virées à vélo, partagés comme pour défier la rugosité d’existences ainsi chahutées par de vrais périls.
« Je partageais ce moment simple avec lui intensément, notre proximité était d’une plénitude à la fois nonchalante et immense, à la manière dont se rencontrent les cachalots, les cumulus, les nébuleuses. » songe, avec ravissement, le plus jeune (9 ans), Steve Dubois qui accueille ainsi la prometteuse compagnie de ce nouveau voisin prénommé Charlélie (10 ans), mais surnommé « petit » Poulin, dont la famille emménage soudain à quelques encâblures de sa maison.
Relisant ensemble, entre autres Tintin, les deux frais amis emploient tout leur temps libre estival à explorer maints endroits, à la construction d’une cabane, refuge indomptable qui les protège des orages fomentés par la vie souvent colérique des adultes autour d’eux, lesquels, peu avares de mots ou de gestes déconcertants, voire violents, à leur égard, n’expliquent pas toujours leur raison d’être.
En ce repaire bien à eux, dans la forêt, Charlélie et Steve relisent parfois les articles qu’ils ont sélectionnés puis collés dans un grand cahier, extraits de divers journaux et magazines et qui, tous, relatent des bouleversements environnementaux, climatiques, nucléaires.
1986 n’est certainement pas un choix d’année hasardeux : la mémoire encore toute neuve de la catastrophe de Tchernobyl plane, en effet, même à des milliers de kilomètres de leur contrée canadienne. Et cette collecte éditoriale, baptisée « L’album des catastrophes », en lieu et place des vignettes de footballeurs autrefois compilées par des enfants plus insouciants, est sans aucun doute leur manière bien à eux, même et surtout inconsciente, d’être lucides sur la toxicité de leur propre environnement. Voire d’une catastrophe qui se prépare.
« L’AMI QUE JE CHERCHAIS DÉSESPÉRÉMENT »
On sait gré à Sébastien Dulude de nous entraîner, dans les premières pages de son premier roman -qui n’est cependant pas un premier livre, l’auteur ayant publié avant lui des recueils de poésie- en cette épopée d’une amitié qui se scelle le plus naturellement du monde. Tant il parvient à extirper de notre propre mémoire la remembrance joyeuse permise par les perspectives plaisantes, sinon totalement heureuses, qu’un tel lien procure, lorsque le destin place sur votre route pareil événement. Car l’écrivain, pour fixer la date de naissance mais aussi la part enviable, innocente, de cette amitié, n’hésite pas à pasticher Flaubert et sa célèbre, ironique formule de son Education sentimentale (« Et leurs yeux se rencontrèrent ») :
« Debout, non pas sonné mais comme engourdi de fatigue des dernières minutes, j’avais posé mon regard rougi sur la nouvelle maison de ces gens, jolie, blanche, bleue et alors il était apparu, un garçon de mon âge à la dégaine polissonne, sur le porche avant. J’avais senti dès la première fraction de seconde du croisement de nos regards, dans sa manière d’opiner du museau vers moi en m’apercevant, qu’il était l’ami que je cherchais désespérément. » (1)
Nulle ambiguïté, cependant, ne plane au-dessus de cette camaraderie de qualité entre les deux garçons, trop occupés à partager des instants de vacances volées au tumulte et au danger de vivre.
Mais comme rien, dans l’existence, ne peut raisonnablement étirer les moments de distraite béatitude (du moins, apparentés), l’auteur interrompt, au bout de cent pages, son récit d’aventures aussi sérieuses et emballantes qu’enfantines, par l’irruption d’une tragédie intime. Et, pour mieux marquer le lecteur, choisit d’introduire une photo noir et blanc sur double page, représentant, vue d’avion, ce qu’on suppose être une large portion du territoire de Thetford Mines.
La première partie de la narration se termine par ces mots : « C’est alors que j’ai pris feu. »
La césure est brutale. Qui sépare ainsi en deux parties le roman. Dont les intitulés :« Je me nourris du bon feu » et « j’éteins le mauvais », lorsqu’on les réunit, constituent la charade d’une devise de François 1er, choisie pour exergue à son livre par Sébastien Dulude.
« LE CINÉMA ORANGE DE L’EAU ME CALME... »
Tout inédit que soit le procédé, il invite le lecteur à produire, en son imaginaire, la fable de ce qu’il s’est passé entre 1986 et 1991. Agé de 15 ans, Steve continue de se raconter. Et l’eau présentant l’avantage d’éteindre les feux, elle ouvre la seconde partie du roman qui détaille les performances de l’adolescent à ses séances de natation. Lesquelles se doublent de talents de chanteur sous l’eau que n’apprécient guère ses coreligionnaires. Starmania , en ces heures aquatiques pendant lesquelles un entraînement exigeant le prépare aux fonctions de sauveteur, fait figure de disque favori, en son temps dupliqué sur cassette (pour faciliter l’écoute par baladeur) par le petit Poulin.
Et l’écriture de Dulude de flamboyer nettement lorsqu’elle détaille poétiquement ce nouveau décor :
« La piscine est presque entièrement vitrée et le soleil coule des fenêtres pour peindre du feu sur le miroir de l’eau et plonger ses mains ambrées jusqu’au fond du grand bassin. Le cinéma orange de l’eau me calme et me stimule tout à la fois. Je ne regarde rien d’autre que droit devant, sans crochir et mes lignes sont aussi impitoyablement droites. La mécanique de ma nage ne gaspille aucune énergie, tout mon être est occupé à bouillir. » (2)
De l’ami Charlélie, il ne sera plus question que par évocations au passé. Peut-être mort et incinéré. Peut-être seulement imaginaire?… l’écrivain ne ménage pas seulement le suspense, il en fait l’économie intégrale. C’est à peine si l’entourage de Steve ose mentionner ce nom de petit Poulin. Et le père du narrateur, fidèle à la colère qui semble ne jamais le quitter, refuse toute conversation à propos de son travail de conducteur de mines, de partager avec son rejeton des connaissances sur la composition du sol canadien alors à l’étude et au programme du secondaire, occasion une fois de plus manquée de communiquer avec un homme muré dans un mutisme fâché pas même vraiment haineux.
Dès lors qu’un être cher disparaît de notre entourage, bien des gestes dérisoires nous viennent, comme toucher des objets lui ayant appartenu ou qu’il vous a donnés. Rituel puéril pour tenter de ranimer ce qui ne peut l’être. Et, sourde dans l’esprit, comme pour mieux orienter la tristesse inextinguible vers l'accablement définitif, survient la drôle de culpabilité qui vous étreint, grossit, exagère : et si c’était vous-même qui êtiez responsable de sa mort?
A ce deuil impossible à faire, quand l’ami vous hante au point d’accaparer trop fréquemment vos pensées, se superpose un autre, fort différent: quand celui de votre père, mal aimé puisque mal aimant, ne prend pas même le relais de la peine mais survient à un âge trop précoce -l’aube de la quarantaine- et rajoute une louche d’injustice dans le brouet parfois très amer de l’existence.
« Le ventre bombé des rouges-gorges me rappelle ce que j’étais venu faire, hormis espérer toucher mon dû: rendre le bracelet du petit Poulin. Son souvenir me ligote, me tire vers l’arrière, je ne sais plus qu’en faire, je ne sais plus que m’en souvenir... » (3)
« LA MINE, C’EST L’ISOLEMENT DES ENFANTS »
Alors vient le désir de s’envoler au loin. A défaut de pouvoir agrandir ses ailes, le vélo et la nage s’offrent comme substituts d’évasion inconsolés (« Hier j’ai nagé : j’ai jamais eu les pieds sur terre, j’aimerais mieux être un oiseau. »).
Pour distraire ses paniques très fréquentes, et qui le distinguent des autres garçons de son âge, Steve conjure, comme il peut, le sort :
« La mine, c’est la violence contre certains parents, puis la violence sur certains enfants ; la mine, c’est l’isolement des enfants, et l’isolement c’est l’ennui, et l’ennui, c’est la violence qui m’a enlevé mon ami. Et la violence, c’est ma nouvelle amie. » (4)
En fait de véritable nouvelle alliance, c’est Cindy qui se proposera à Steve. La vie continue sans le compagnon d’enfance mais trépigne dans l'ombre d'une sexualité en éveil puisque, selon le précepte du grand frère Daniel, « Des fois, il faut juste se défouler en brûlant du gaz. »
De ce récit si incandescent d’émotions délicatement consignées par une stylistique très personnelle, tantôt poétiquement sobre, tantôt gorgée d’images mi-palpables mi-abstraites, on sort comme après s’être approché trop près d’un feu dansant sans cesse : la chaleur extrême rivalise avec l’air vif qu’elle est censée faire oublier.
On ne sait si Sébastien Dulude a pour livre de chevet « La psychanalyse du feu », mais l’on songe à Bachelard, en refermant son roman. Dont certaines réflexions résumeraient idéalement Amiante, qui égrène les divers motifs d’aimer fortement ou non vivre dans les années où tout peut basculer, changer plus soudainement qu’à d’autres périodes. Muer une pyramide de souffrances en un terreau fertile de futures promesses est alors possible :
« Si tout ce qui change lentement s’explique par la vie, tout ce qui change vite s’explique par le feu. Le feu est l’ultra-vivant. Le feu est intime et il est universel. Il vit dans notre coeur. Il vit dans le ciel. Il monte des profondeurs de la substance et s’offre comme un amour. » (5)

Agrandissement : Illustration 1

Notes:
(1): Sébastien Dulude, Amiante, © Saguay, Canada, éditions La Peuplade, août 2024, p. 51
(2): ibid. p.121
(3): ibid. pp. 158-59
(4): ibid. p.174-75
(5): Gaston Bachelard, La Psychanalyse du feu (1938), © Paris, éditions Gallimard, Folio Essais, 1992.
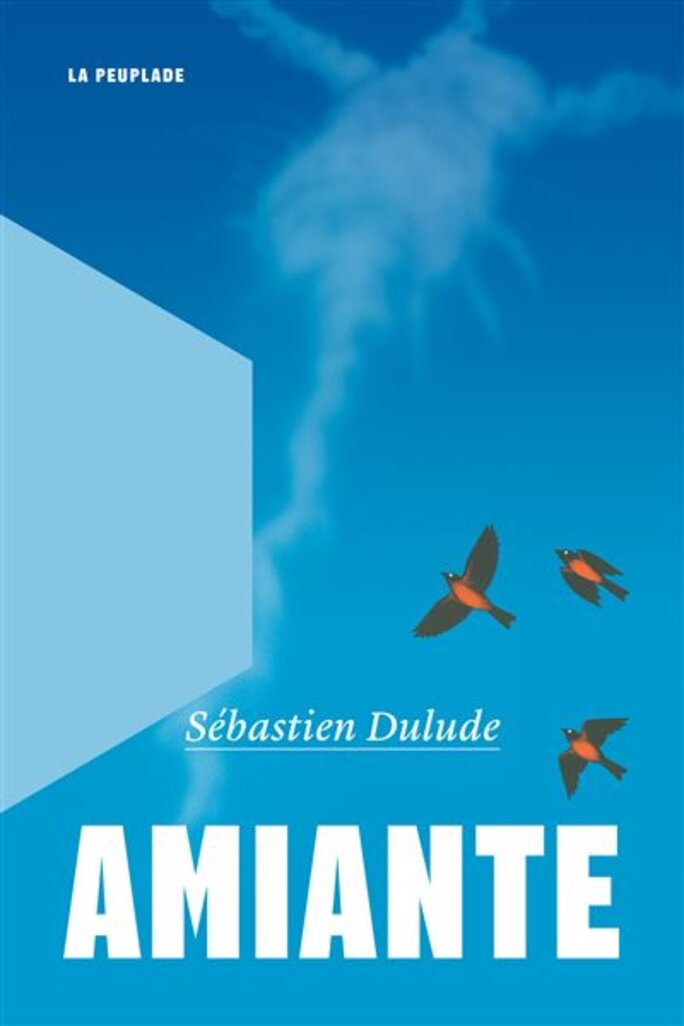
Agrandissement : Illustration 2
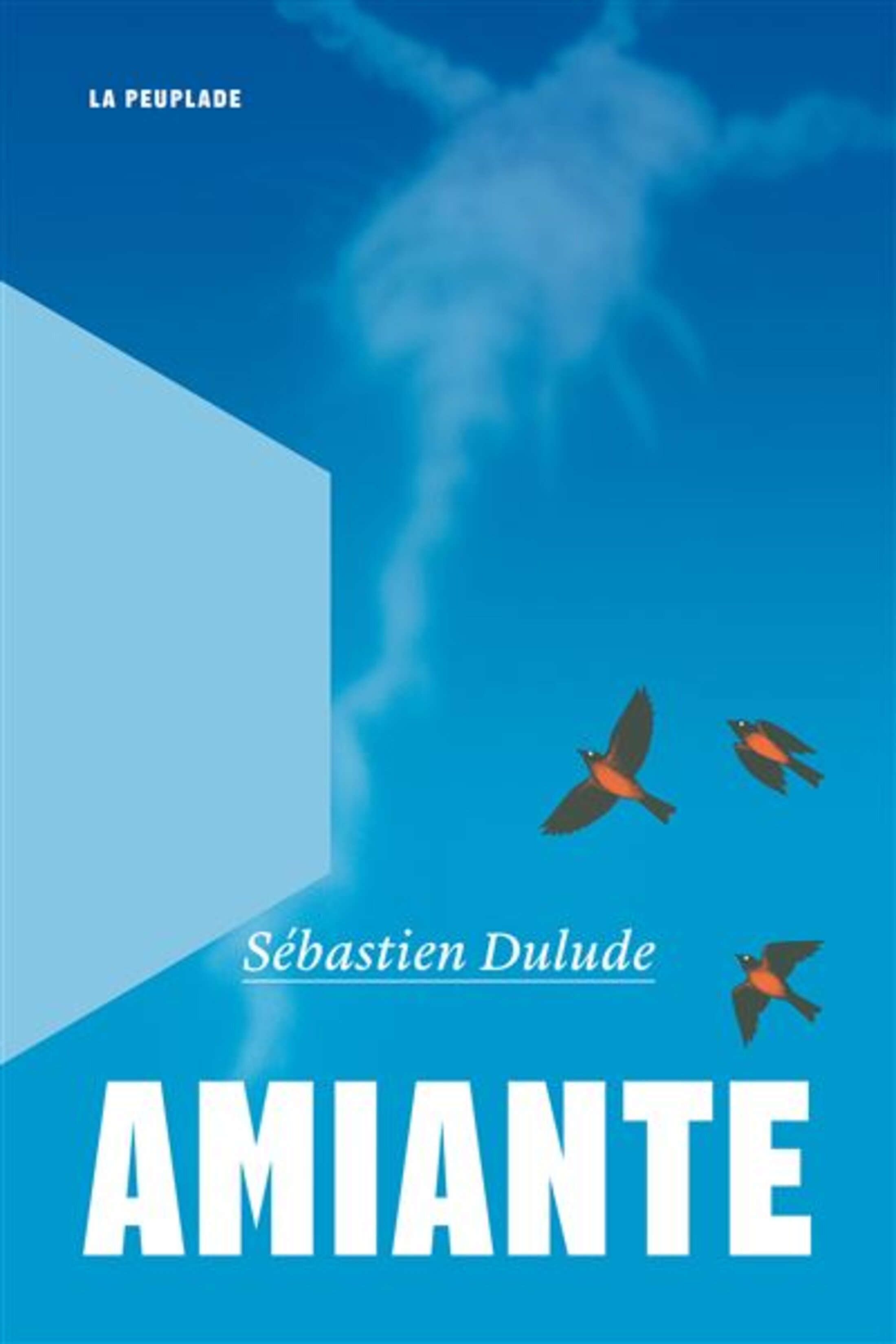
Amiante, de Sébastien DULUDE, éditions La Peuplade, Saguay, Canada, 210 pages, 20 € (broché), 12, 99 € (édition électronique).



