Espaces perdus : c'est le titre du premier livre qu'il a fait paraître, sur l'amicale insistance de Alain VEINSTEIN, l'homme de radio et passionné de littérature de France-Culture, qui dirigeait alors, début des années 80, la collection "Carnets" éditée chez Plon.
Claude Régy ne sait alors sans doute pas encore qu'il entame, avec ce volume primordial, une série d'ouvrages qui vont baliser, comme autant de pierres blanches, pendant plus de vingt ans, ses aventures inégalées jusqu'ici, vers un "théâtre s'éloignant du spectacle, du tapage connu, du confort."
Dans une économie de langage à laquelle il tient et qui lui vient sans aucun doute de sa grande fréquentation des oeuvres marquantes du XXè siècle (Nathalie Sarraute, Charles Reznikoff, Jon Fosse, entre autres), il consigne des notes qui n'empruntent jamais rien au jargon théâtral. Mais, à l'instar des fleurs japonaises repliées qui, une fois humectées d'eau, font éclore des corolles, distillent des images, il établit des liens saisissants entre la stylistique et la situation proposées par un texte et des considérations, connaissances scientifiques ou philosophiques ou encore théologiques, qu'il a lentement assimilées pour étayer son approche scénique dudit texte.
Espaces perdus commence par l'évocation de Madeleine Renaud, comédienne avec laquelle Régy a créé, à plusieurs reprises "L'Amante anglaise" de Marguerite Duras.). Les Viaducs de la Seine-et-Oise étaient une pièce de théâtre de forme classique, que Claude Régy a montée en 1961/62 sans succès, et que Marguerite a transformée en un "roman" à sa manière, L'Amante anglaise, dont elle a ensuite suggéré à Claude de faire un spectacle de théâtre (sans modification, je crois) et qui a donné lieu, plus tard, porté par Madeleine Renaud, à un succès renouvelé de 1968 à 1989 : une adaptation théâtrale qui privilégiera le seul langage et contre tout autre ornement décoratif) et qui relate les entretiens qu'un personnage, dont la fonction n'est jamais désignée (policier? juge? psychiatre?) mène avec Claire Lannes, cette femme accusée d'avoir tué sa cousine avant que de découper son cadavre en divers morceaux et d'en jeter les reliefs dans des trains de marchandise passant sur un viaduc. C'est évidemment cette partie-là du récit que l'on retient, davantage que le premier entretien de l'interrogateur avec le mari de Claire Lannes qui, pourtant, donne des clefs pour, non pas "comprendre" ces gestes violents, mais mieux appréhender les diverses (dé) raisons, valides ou pas, qui ont conduit à cette tragédie.
VILLAGE OU PARC, GRAND ET PETIT & UN MONDE OÙ DIEU ÉTAIT FEMME
Régy raconte ensuite, tour à tour, l'épopée que représenta la création de "Grand et Petit", pièce de l'allemand Botho Strauss qui suit les errances de Lotte Kotte (interprétée alors, au TNP de Villeurbanne puis à l'Odéon-Théâtre national à Paris par Bulle Ogier) une femme esseulée dans l'Europe des années 70 et se heurte (déjà) à la défaite des liens de tous ordres: affectif, professionnel, social... Or, Régy ne parle jamais en ces termes:
"Dans l'ébranlement de l'image du monde, Lotte est peut-être une juste. Le mot est consigné chez les anciens Juifs.
Se prendre pour un saint ou pour le Christ, c'est aussi un symptôme de folie. Des lésions affectives, séquelles de séparations mal tolérées, emplissent le courrier du coeur - mais aussi les asiles psychiatriques.
Ainsi la pièce va de la plus grande dimension - Kabbale - à la plus petite - Courrier du Coeur - et revient à la plus grande - Folie - la plus petite étant aussi importante que la plus grande." (Espaces perdus, éditions Plon, p. 67).
Libre alors, au spectateur, de pressentir tout cela ou de simplement - puisque avec Régy, rien ne vient jamais contrarier le texte - percevoir, plus directement qu'un individu est forcément perdu pour la société dès lors qu'il ne s'y soumet pas mais vagabonde.
Et Régy évoque ensuite Par les villages de Peter Handke, puis Le Parc du même Botho Strauss, créés respectivement en 1984 et 1986 au Théâtre national de Chaillot, Intérieur de Maurice Maeterlinck, Trois voyageurs regardent un lever de soleil de Wallace Stevens (poète américain), réalisés, eux, en 1985 puis 1988 au Théâtre de la Bastille à Paris.
Pour Le Parc, Régy détaille ses rêveries préalables avant que de monter cette pièce complexe, baroque, parfois insaisissable tant les références troublent sa lisibilité. Et rappelle que Botho Strauss l'a écrite en lieu et place d'une adaptation du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare que voulait proposer Peter Stein, le metteur en scène allemand qui l'avait engagé, à demeure, à la prestigieuse Schaubühne de Berlin, au titre de dramaturge. Strauss situe le cadre de son texte dans un parc de la capitale allemande, occupé, la nuit, par des asociaux. Un parc "artificiel" souligne Régy, qui enchaîne:
"Pour travailler, j'ai cherché un équivalent à Paris. J'ai vu alors le Forum des Halles, ses dealers, ses punks de banlieue, la bouche du RER, les déchets plastiques des fast-foods, le trou et cette volonté de faire pousser de la végétation sur des fils de fer. - dans cette négation de l'architecture. Miroirs - surfaces réfléchissantes. Et c'est là que se dresse encore la colonne magique de Catherine de Médicis, la tour de ses astronomes, en fait, restée accolée à la Bourse du Commerce, bâtiment circulaire construit au début de l'ère industrielle sur l'emplacement de l'hôtel où cette reine faisait travailler Nostradamus, ses astrologues et ses nécromanciens.
Tout près de là: ce haut lieu de l'alchimie, la tour Saint-Jacques, et le célèbre charnier recouvert par la place des Innocents où clapote sa fontaine reconstruite, parmi les tilleuls.
On peut penser aux philtres et aux envoûtements de Titania. On peut penser aux différentes Troie, successivement ruinées par les guerres, ensevelies sous terre, superposées.
Strauss ne s'arrêtait ni à la pièce de Shakespaeare ni au Moyen Age. A travers Obéron et Titania il remontait bien plus avant au mythe de Minos et de Pasiphaé, au Minotaure donc et encore bien plus loin aux origines du monde où Dieu était femme."
LA PLACE DES LARMES
Espaces perdus se termine par cette courte mais fervente profession de foi, de la part de Claude Régy, qui synthétise les idées majeures qui soutiennent durablement sa croyance en un art qui décloisonnerait tout: les disciplines, les espaces, les temps, les oeuvres, les publics, les savoirs... Les extraits ci-dessus choisis tentaient déjà de témoigner que son approche unique, artistique et rigoureuse des textes, ne laisse la place à aucune approximative appréhension de ce qui devrait préoccuper celle ou celui qui prétend créer (cet extrait d'Espaces perdus est en général bien connu des étudiants en Art dramatique, qu'ils soient théoriciens ou praticiens - il a aussi été lu de façon marquante par l'actrice Isabelle HUPPERT pour une émission de radio consacrée à Claude RÉGY, fin des années 90 du siècle dernier):
____________________________________________________________
Je vois des mouvements dans des espaces perdus. Je sens comment la vastitude, si simple, est un lieu pour les larmes. Je sens que ce que je cherche avec conviction je ne peux pas savoir ce que c'est. C'est en ne le voyant jamais à découvert que je le connais le mieux. Comme des échanges sous la mer.
Je pense qu'il faudrait des espaces perdus. Il faudrait cesser de les démolir. Il faudrait construire des espaces perdus.
Des espaces vides, vastes.
Des espaces libres, des espaces nus, où tout peut s'inscrire, où l'image est parfaitement visible dans son intégrité, dans son intégralité, pour tous les spectateurs, et proche de chacun d'eux.
(...)
Je crois aux intersections. Je ne crois pas au confusionnisme.
Je crois au principe d'exagération, à l'utopie, à la non-rentabilité.
Souhaiter que se multiplient des lieux de déréliction, qu'on sache où travailler. Qu'on sache où aller voir.
Penser à des lieux pour des aventuriers. Des nomades.
Être très vigilant sur l'acoustique, sur le respect de l'absolu silence, du vide parfait.
Nombres d'or au sein de la sauvagerie.
Technologie de pointe en pleins lieux dévastés.
Plus d'un sanctuaire serait assaini si on y mettait le feu.
Lieux qui sauraient faire penser à d'autres lieux.
Lieux où coïncident les contradictions.
Lieux de fiction.
Lieux de folie, de mort.
Endroits sans mesures, de silence et de cris.
Des endroits où se taire sous la pluie artificielle.
Qu'on nous laisse la place des larmes.
________________________________________________________________________________________________________________
Claude RÉGY, Espaces perdus, collection "Carnets", © éditions Plon, Paris, 1991; ré-édition © Les Solitaires Intempestifs, Besançon, 1998. Une autre édition, sous forme de coffret, regroupe les 5 volumes parus aux Editions Solitaires Intempestifs: Espaces perdus/ L'Ordre des morts/ L'Etat d'incertitude/ Au-delà des larmes/ La Brûlure du monde, © Les Solitaires Intempestifs, Besançon, 2016.

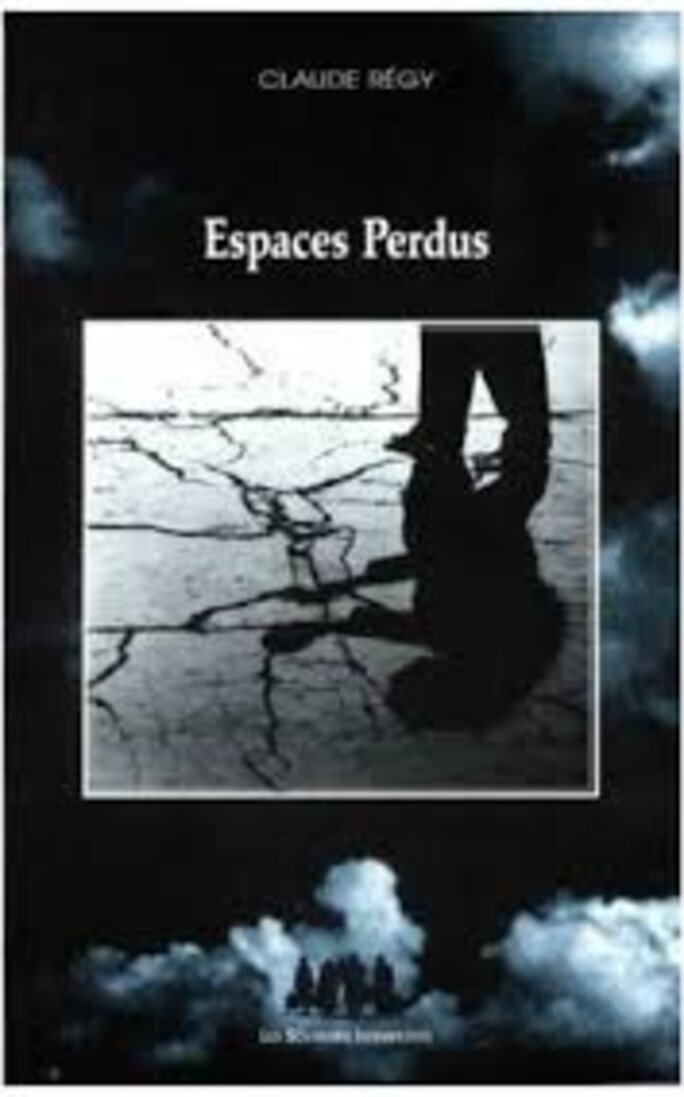
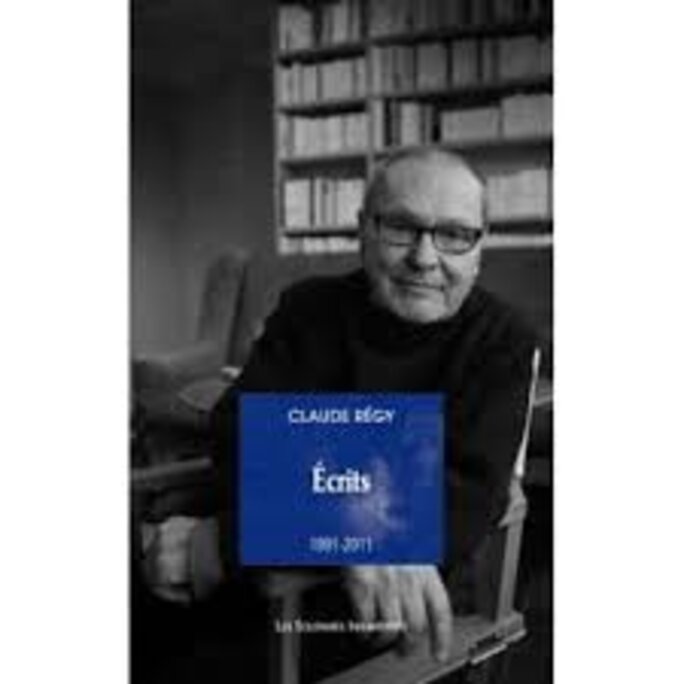
_________________________________________________
Claude RÉGY a créé "Rêve et Folie" d'après les poèmes de Georg TRAKL, dans le cadre du Festival d'Automne 2016 qu'il considère comme son ultime proposition scénique. "Rêve et Folie" sera repris, toujours dans le cadre du Festival d'Automne, du 1er au 16 décembre 2018, au Théâtre Nanterre-Amandiers, Centre dramatique national (+33 (0)1 46 14 70 00 pour la location téléphonique).
_________________________________________________
A suivre: L'Ordre des morts (1999).



