Ils sont de moins en moins nombreux (nous semble-t-il) les artistes propices à raviver nos vues sur le monde, l’humanité, en pratiquant, artisanalement, autre chose que de chiches copies du réel. A nous conduire à voir et comprendre, non seulement instinctivement mais aussi par bien (sinon tous) les sens, au-delà de l’étroit bandeau du banal et de l’anecdote, ce qui se trame dans la conscience de quelques-uns de nos faits et gestes, espoirs, croyances, incertitudes.
Chaque mercredi, ils sont par exemple toujours plus nombreux à imposer, internationalement, un cinéma qui a oublié la plupart du temps de regarder et faire voir ce qu’habituellement nous discernons mal, par nos considérations hâtives car distraites, dans notre appréhension d’une Histoire délestée des clichés habituels qui encombrent et obstruent son entendement sensible.
Souverain, l’art du cinématographe (qui n’a décidément rien à voir avec le cinéma) de Robert Bresson, parmi quelques autres, lave nos regards, dépoussière nos points de vue, nous permet d’épancher librement nos émotions intérieures et intimes.
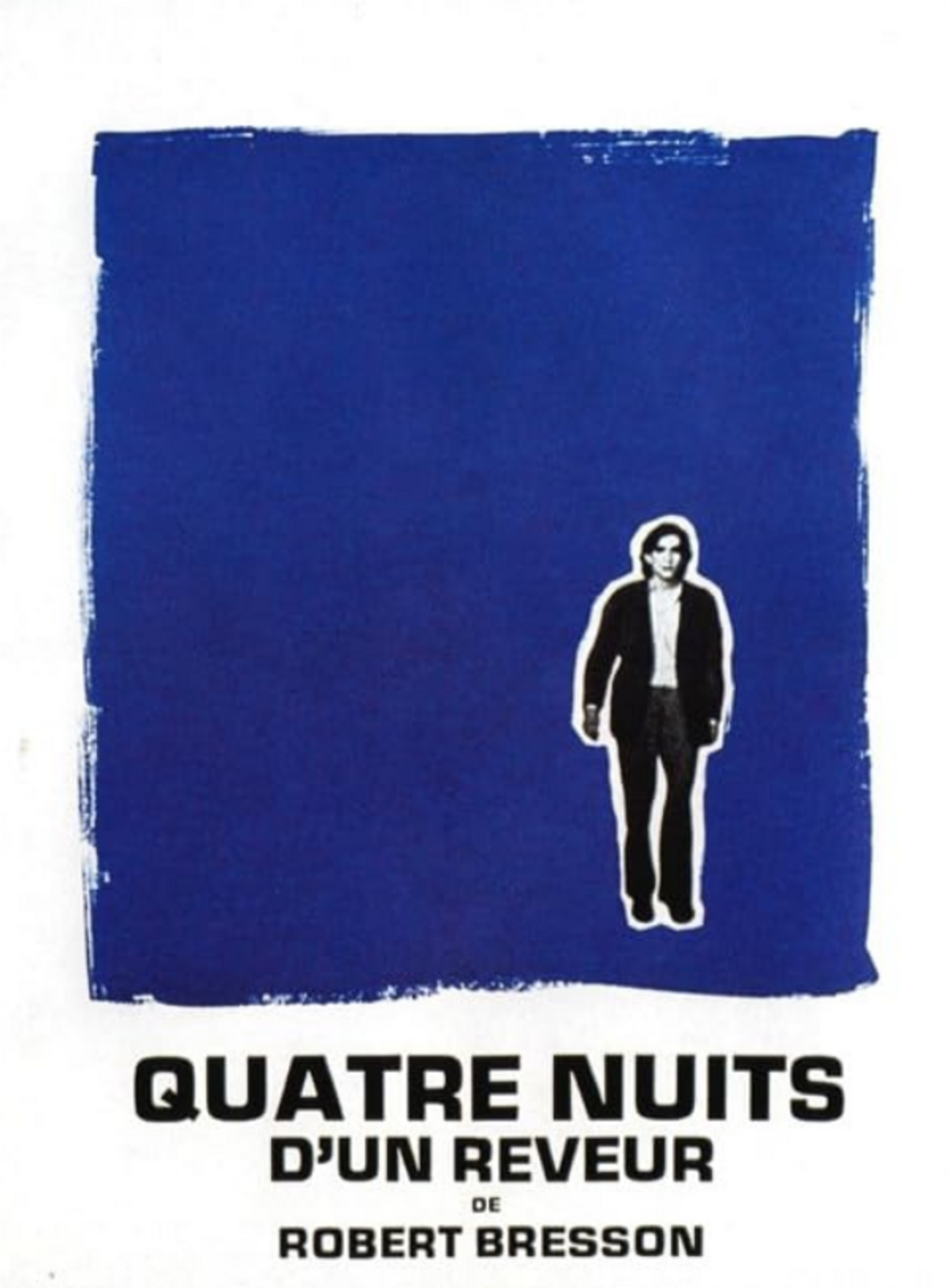
Agrandissement : Illustration 1
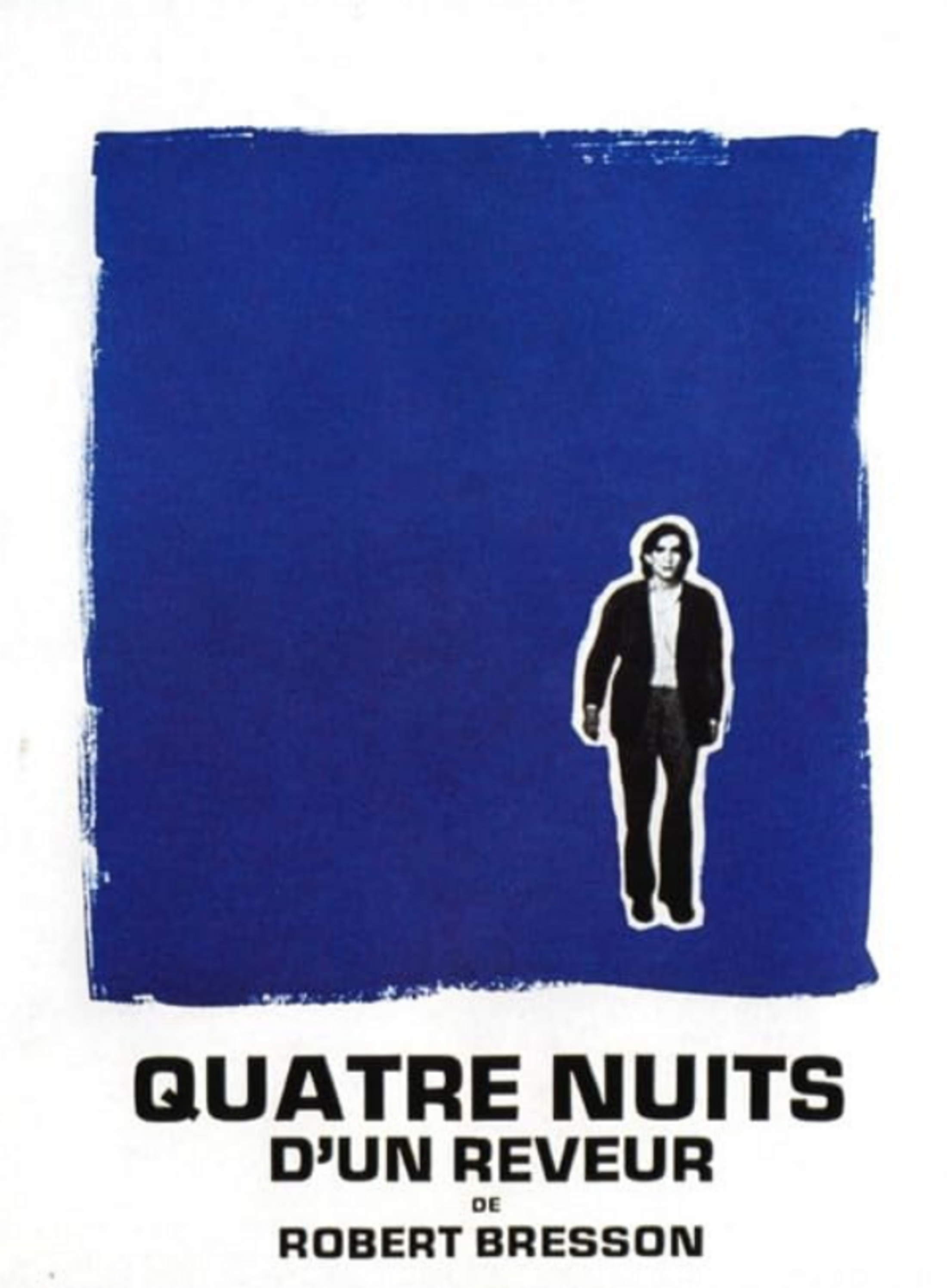
Autant dire que découvrir, encore, trace de son approche si personnelle du 7è art, par l’aubaine d’un film demeuré mystérieusement invisible pendant plusieurs décennies, finalement restauré et re programmé, fait figure d’aubaine qu’on aurait tort de négliger, si l’on compte encore sur l’étonnement dont nos esprits sont capables, chaque fois qu’on s’adresse à nous autrement que par les moyens tonitruants du tapage commercial, du marketing rance puisque facile, qui ont réussi à se nicher jusque dans les colonnes des médias réputés exigeants et finissent par véhiculer des flux tièdes d’oeuvres souvent dispensables tant elles sont, la plupart du temps, calquées peu ou prou sur des modèles obsolètes et indigents.
D'OMBRES ET DE COULEURS
Quatre nuits d’un rêveur est un long métrage réalisé par Bresson en 1970-1971. Adaptation d’une nouvelle de Dostoievski (Les Nuits blanches), il peint la rencontre et les soirées qui s’ensuivent entre Jacques,un jeune homme épris d’art et Marthe, une jeune fille qu’une déception sentimentale conduit à vouloir se suicider en se jetant dans la Seine, du haut du Pont Neuf de Paris. On verra, plus loin, que le choix de ces prénoms, n’a sans doute rien de si hasardeux, de la part de Bresson. Le film, dès lors, expose les entretiens entre deux idéalistes dont l’un prodigue sa foi personnelle toute dédiée à l’art, tandis que l’autre, convaincue de la pureté de son désir, a jeté son dévolu sur un homme qui s’est éloigné d’elle mais qui, reparaissant, lui donnera raison.
Rencontres entre deux obsessions difficilement compatibles au premier abord, puisque les sentiments nés aussitôt en Jacques pour Marthe (qu’il sauve de sa détresse), ne paraissent pas réciproques. Ce n’est d’ailleurs pas tant cette histoire sentimentale (ou sa faillite) qui intéresse Bresson, mais bien plutôt comment ces deux-là cheminent, côte à côte, l’espace de quelques jours et nuits et comment il les montre se débattant avec leurs utopies respectives.
Au gré de ces promenades dans un Paris livré à la torpeur d’une saison qui s’obstine à taire son nom, hésitante entre début de printemps et prémices d’automne, le cinéaste élit des couleurs et des lumières à la mesure de pérégrinations qui semblent suspendre, ralentir le cours de vies vacantes. N’écoutant que son penchant naturel pour les paradoxes, Bresson choisit non pas le noir et blanc (qui a souvent sa préférence) pour filmer ses Quatre nuits, et comme on s’y attendrait, a priori, eu égard à la tonalité des œuvres de Dostoievski, mais défie à nouveau la couleur (peut-être aussi pour ne pas rester sur le demi échec d’une précédente adaptation d’un récit de l’auteur russe, Une femme douce, que d’aucuns jugèrent un peu ratée, compte tenu, justement, d’une maîtrise approximative du registre chromatique) et fait appel au chef opérateur Pierre Lhomme, habile technicien complice dans ce style.
Furtifs, quelques éléments, comme le son d’un orchestre brésilien invite à la liesse les quelques touristes anonymes qui battent le pavé, ou le passage d’un bateau mouche dont les feux discrets illuminent le fleuve, le chant choral d’un groupe de beatniks en vogue dans les années 70, semblent imiter les échos d’une fête irrésolue à se poursuivre ou se terminer. Mais tout semble comme nimbé dans des fanages de teintes, des lavis de couleurs qui s'empêcheraient d'époumoner leur éclat ou comme si un peu de nuit s'était glissée en chacune d'elles.
DOUBLE INCONSTANCE
Le film se découpe donc en quatre nuits énoncées, chaque fois, par un insert qui morcelle le temps de la narration. Or, on s’aperçoit assez vite qu’en fait de nuits, ce sont surtout les jours qui les séparent qui l’emportent. La « nuit bressonienne » est un temps mental plus qu’astrologique, elle n’a rien de commun avec la nuit d’un Antonioni précédant une Eclipse. De même qu’il y a de l’ombre en plein jour, l’éclat lumineux d’un sentiment amoureux se confond dans les strates sourdes et sombres de son inconstance.
Double inconstance, même, oserait-on avancer, mais sans les afféteries d’un quelconque marivaudage. Car Marthe exprime plus d’une nuance, plus d’une contradiction lorsqu’elle évoque son attachement progressif innomé à Jacques. « Vous savez pourquoi je vous aime, en ce moment ? » lance-t-elle à son soupirant (qui, lui, ne fait pas mystère de ses sentiments pourtant rapides) « Précisément parce que vous n’êtes pas amoureux de moi ». Le défi n’a rien de burlesque : il met à distance et prévient qu’il ne saurait être question de mélanger les genres et qu’elle tient l’amitié pour aisance plus probante que l’amour. Ce qui ne l’empêchera pas, plus tard, d’avouer une plus grande complexité pour ce qu’elle éprouve mais qui ne peut l’empêcher de continuer à aimer d’autant plus celui qui l’a abandonnée, un an plus tôt, et peut-être quittée, bien qu’elle soit persuadée du contraire.
La narration se morcelle alors en des directions volontairement erratiques. Comme si c’était le seul moyen pour faire percevoir à quel point la prédisposition amoureuse était comptable d’un ensemble de fausses vérités, d’élans chaque fois déçus, de fantasmes dénués de raisons. Prédisposition qu’on peut apparier avec celle pour l’utopie : jusqu’où faut-il savoir être déraisonnable pour céder aux caprices d’un engagement qui vous emmène vers l’absolu inconnu ?
Aux paradoxes décuplés par la narration, s’ajoute le goût pour les bribes, les reliefs, les motifs inachevés. Reliefs de repas, chez Jacques, qui encombrent un cageot faisant office de table, restes de bougies finissant de se consumer en bavant sur le rebord d’une housse de guitare d’un chanteur hippie avachi sur son bout de trottoir… l’attention pour ces résidus témoins d’un banquet ou d’une fête est assez constante. De même qu’on ne voit, sur les toiles que peint Jacques, qu’esquisses, dessins à peine ébauchés, demi ronds de couleurs en attente d’être travaillés…
C’est ainsi que, progressivement, on aborde, on regarde autrement le film, chaque plan suggérant (plus qu’énonçant) qu’il est surtout la métonymie d’une humeur générale qui n’a plus rien de collectif, ou comme si toute joie était condamnée à la sourdine, aux oripeaux d’un carnaval interrompu avant son terme, flonflons en haillons et guirlandes aux teintes défraîchies, échos dérisoires des bruits d’une danse privée de rythme aguicheur… deux ans après mai 68, Paris ne s’est pas totalement démaquillée d’une contestation sociale et politique qui se voulait d’envergure et a fini par n’ôter qu’à peine un tiers de ses pavés. Alors, rétrospectivement, le geste d’autolyse de Marthe apparaît lui aussi chargé de la métaphore d’une volonté, pour l’utopie, de crever dans l’oeuf même de son innocence perdue. Sauf que, plus prévoyant (ou plus idéaliste, encore, que ses « modèles » (1) ), Bresson ne renonce pas complètement à faire encore briller la splendeur naturelle, nue car sans artifices, aveuglément livide comme un linceul blanc, quand il filme Marthe s’observant au miroir, à la fin du film : telle que Jacques ne l’imaginera ni ne la peindra jamais ?
Qu’importe qu’une fête dure ou soit empêchée, semble encore nous murmurer à l’oreille Bresson. Qu’importe que le plaisir qu’on en retire ne soit à la hauteur de nos trop vives espérances ? Toute révolution, à l’instar de toute liesse, ne résout pas toutes les failles et approximations d’une société qui menace d’étouffer, à force de ployer sous le joug des allégeances aux pouvoirs de la réalité. L’essentiel demeure surtout dans la tentative, dans le chemin parcouru, même si le but à atteindre est déçu par une dérobade des suiveurs incertains. Qu’importe si, au final, Marthe et Jacques ne regardent pas dans la même direction : ils ont essayé d’accorder leurs regards dans l’apprivoisement respectif de l’un vers l’autre. Mais tandis que lui observe la lune, elle est déjà captivée par l’approche de l’homme qu’elle n’a cessé d’aimer et qui revient.
Dans le calendrier des saints chrétiens, la St Jacques a lieu le 25 juillet, tandis qu’on célèbre Marthe le 29 du même mois. Bresson n’a pas pu choisir ces prénoms au hasard... Cinq jours et donc quatre nuits séparent ces deux fêtes. On peut aussi voir en Marthe, telle que sa signification biblique l’indique, la maîtresse de maison, celle qui veille à l’organisation tandis que la signification biblique de Jacques, elle, nous enseigne qu’il est celui qui talonne, le frère, l’accompagnant. Et, indubitablement, c'est elle qui mène la danse, décide de la cadence. Il a beau s'égosiller, quand il est solitaire ou qu'il heurte la décence de deux voyageuses à bord d'un bus, lorsque Jacques répète, tel un motif obsessionnel, le prénom "Marthe", dans le micro du magnétophone qu'il trimballe avec lui, elle échappe à son contrôle, ne cède pas à ses appels. Si bien qu'on finit par penser que tout le film n'est que la représentation, animée, d'une chimère totale inventée par le peintre incapable de la coucher graphiquement sur l'étendue d'un châssis.
PEINDRE LES BOUQUETS DU CÔTÉ OÙ ON NE LES A PAS PRÉPARÉS
Rappelons que le goût pour l'indéfini est un droit qui, selon Bresson, revêt une importance capitale. Ne jamais rien trop préméditer, laisser les sens ouverts, le plus possible est une gageure qu'il est bon de ménager absolument afin de ne pas racornir une histoire, étrangler des liaisons, ou raccourcir la nécessaire distance qu'il vaut mieux maintenir, entre les choses, entre les êtres, pour que le spectateur puisse s'immiscer en ces interstices ainsi laissés. Citant de mémoire un mot du peintre Renoir adressé à Matisse, l'auteur de Au hasard, Balthazar avoue: "Je peins souvent les bouquets du côté où je ne les ai pas préparés".
Et, encore:
"Une chose ratée, si tu la changes de place, peut être une chose réussie."
"Une chose vieille devient neuve si tu la détaches de ce qui l'entoure d'habitude."
lit-on dans Notes sur le cinématographe et Quatre nuits d'un rêveur applique, à la lettre, ces préceptes et d'autres.
Loin de la version de la nouvelle de Dostoievski proposée par Visconti (Nuits blanches) et encore davantage de celle de Carax (Les Amants du Pont-Neuf), puisque aux antipodes d’une démonstration de moyens conséquents, le film de Bresson arase, au contraire, tout superflu. Comme à son habitude, mais chaque fois renouvelée et donc, chaque fois imprévisible et pour cette raison toujours éloquente, sa grammaire cinématographique qui privilégie l’économie des moyens, le refus des redondances (pas un son qui soit pléonasme de la moindre image et pas une image qui soit pléonasme d’un bruit), laisse à celui qui contemple son œuvre, le temps nécessaire pour que, lentement, s’irrigue, dans l’esprit, une autre réalité bien plus vaste que celle qui nous est présentée quand on se contente de filmer, sans apprêts excessifs, comme ici, les bribes fanées de nos espérances épuisées.
Dans les cours d’art dramatique que j’ai, çà et là dispensés, j’ai toujours recommandé auprès d’élèves ou stagiaires volontaires, la lecture attentive des Notes du cinématographe de Robert Bresson. Car tout y est. Tout.e metteur.e en scène débutant.e (ou non) tant pour l’art dramatique que pour l’art cinématographique y trouve matière à éviter la plupart des écueils nombreux qui confèrent à cet exercice.
Peu nombreux, semble-t-il, sont, aujourd’hui, bien des cinéastes ou gens de théâtre qui aiment s’y référer et suivre, non les dogmes, mais les préceptes utiles à la réalisation d’une œuvre qui ose se distinguer, par goût profond pour la vraie liberté, et se défaire des canons habituels auxquels on nous expose de façon souvent systématique car oublieux des portées poétiques, oniriques, symbolistes, métaphoriques ou métonymiques que tout film, toute pièce devraient raisonnablement entraîner à leur suite. Non d’une façon préméditée mais qui adviendront si, justement, l’on suit comme des leçons exemplaires, les aphorismes de Bresson. Lesquels, finement appréhendés par l’écrivain J.-M.G. Le Clézio, dans sa belle préface à l’opus cité, observe que « Dans cette quête hasardeuse et rigoureuse, Bresson nous enseigne la nécessité de l'économie, mais aussi la volupté de la création. L'art n'est pas dans l'esprit. L'art est dans l'oeil, dans l'oreille, sur la peau tout entière.»
NOTES:
(1): réfutant les termes d' "acteurs" et même de "personnages", Robert Bresson avait coutume de nommer les uns comme les autres "ses modèles".
Toutes les autres citations de cet article sont extraites de Notes sur le cinématographe, de Robert BRESSON, © Editions Gallimard, Paris, 1973.
Quatre Nuits d'un rêveur
- Réalisation : Robert Bresson
- Scénario : Robert Bresson d'après Les Nuits blanches de Fiodor Dostoïevski
- Photographie : Pierre Lhomme
- Son : Roger Letellier
- Musique : Michel Magne
- Montage : Raymond Lamy
- Comptable : Michel Cuénin
- Tournage : du 10 août au 7 octobre 1970
- Production : Albina Productions (Paris) - Victoria Films - I Film Dell'Orso (Roma)
- Distribution : Imperia Films
- Durée : 87 minutes/ sortie: 13 mai 1974 (Festival de Cannes) puis 2 février 1972 (sortie nationale)
- Sélection officielle Cannes Classics 2024 - Version restaurée 4K puis 19 février 2025 (sortie nationale)
Distribution
- Isabelle Weingarten : Marthe
- Guillaume des Forêts : Jacques
- Patrick Jouané : le gangster
- Giorgio Maulini : Locksmith
- Jean-Maurice Monnoyer : l'amant de Marthe
- Lidia Biondi : la mère de Marthe
- Jacques Renard : un passant dans la rue, à la sortie d'un square



