La tristesse est un mur entre deux jardins ,Algérie, France, féminisme, Michelle Perrot et Wassyla Tamzali, Editions Odile Jacob, 2021, 238p.
Dès que j‘ai reçu ce livre je me suis jetée dessus comme une affamée. Ces deux femmes, intellectuelles réunies me laissaient présager un niveau certain de qualité et d’intérêt dans le propos. On pourrait y ajouter l‘éditrice Odile Jacob qui a senti la possibilité concrète d’une écriture à quatre mains, l’une historienne, répondant à l‘autre, avocate et inversement.
En effet, le livre happe dès les premières lignes, donne à penser, à réfléchir, à rebondir et à sauter le pas de l‘archaïsme des sociétés actuelles.
Cette proposition n‘a été le fait d’aucun chef d‘état dans le monde ! Et pourtant revoir l‘histoire et l‘actualité du féminisme entre ces deux pays est l‘essence même d’une culture, d’une portée à long terme de la construction d’une civilisation, d’un nouvel humanisme !
Odile Jacob leur propose d’échanger sur « les problèmes du temps, de l‘Algérie, de la mémoire et de l‘oubli, des femmes, du féminisme, du foisonnement des différences et …de ce qu‘elles voudraient ».
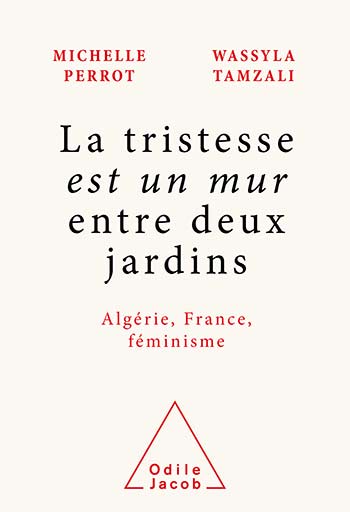
Tout y passe à l‘aune du vécu comme le mouvement du Hirak lancé en 2019, le mouvement #MeToo, interférence du social et du religieux, les Harkis, le voile, la colonisation, le patriarcat, le « decolonial »,le Rapport Stora tantôt « considéré comme une avancée dans le dialogue » pour l‘une, tantôt « pétard mouillé ».
Ce dernier point et d’autres encore est important parce que sans une reconnaissance importante des deux états, la mémoire et l‘oubli qui permettront de tourner la page des deux peuples ne peut se faire : les algériens du pays et ceux de France restent marqués par le silence épais de leurs pères, de leurs ancêtres, les blessures restent à vif.
Ordonné en cinq parties comme les cinq doigts de la main, le livre est composé de lettres échangées avec pour support le féminisme « dans sa pluralité est la révolution du dernier demi-siècle ». Cette révolution « copernicienne » s’est accélérée ces dernières années, de ce fait, beaucoup de bastions restent à conquérir, à partager.
Toutes deux s’expriment sur la capacité de l‘universalisme (qui n’est pas forcément l‘universel)à intégrer la différence qu‘elle soit religieuse, culturelle ou encore et surtout sans doute, le monde d’une manière générale construit sur le prisme de la domination masculine depuis l‘aube de l‘humanité.
« Je hais les gens qui prennent le feu avec des mains d’éponge mouillée »René Char.
La période coloniale suivie de la guerre d’indépendance sont et restent un problème, une plaie ouverte entre les deux pays.
A fortiori parce que « la décolonisation par les armes installait immanquablement des régimes militaires dans les pays colonisés ».
On ne s ‘en sort pas ! Quelle réparation ? On ne veut rien réparer sur le fond. Alors pourquoi l‘Algérie ? Pourquoi 132 ans ? Pourquoi encore toute cette haine ? Pourquoi aujourd’hui la question des émigrés algériens est remise sur la table, en période électorale qui plus est ? Ce sont les algériens qui suscitent la crainte voire plus. « Alors que ce sont eux qui étaient menacés » et le restent !
« Aujourd’hui c’est le peuple algérien qui essaie de raconter au peuple français son histoire, comme dans le rêve de Primo Levi, celui-ci ne veut pas l‘entendre ».
A chaque élection présidentielle, les algériens de France surtout, tremblent : la stigmatisation du faciès au quotidien, va t-on renouveler les certificats de résidence et même pour ceux qui ont acquis la nationalité française, que va-t-on trouver pour la contester, chercher la petite bête comme ce fut le cas lors du quinquennat de Nicolas Sarkosy ?
Et toute cette jeunesse frustrée, fracassée, désenchantée, n ‘a –t –elle pas fini de payer les pots, les refoulements, le fardeau de leurs parents, les issues obstruées, les rêves anéantis ?
Les algériens en ont assez d’être considérés comme des étrangers depuis tant d’années où leurs parents, grands-parents sont venus accomplir les besognes les plus difficiles de la construction de la France d’après la seconde guerre mondiale.
Ce climat délétère se poursuit encore aujourd’hui dans toutes les sphères de la société, alimenté par une frange politique à qui est donné pignon sur rue, qui fait la tournée des popotes médiatiques : A qui profite le crime ?
L’ampleur de cette conversation unique et nécessaire (et ce sont des femmes qui la pose) reste ouverte parce qu’il « est plus facile de clore que de conclure ». Les deux femmes ont évité l‘écueil, le piège comparatiste entre leur situation, entre la France et l‘Algérie, qui les aurait laissé chacune à sa place. « La posture différentielle conduit soi et l‘autre à deux solitudes, l‘altérité conduit à la rencontre avec l‘autre ». Parce que dans toute situation binaire, il faut rechercher la troisième voie ainsi que le préconise Hannah Arendt, « surtout quand les deux premières sont formatées par la société patriarcale ».
Non seulement cela n‘aurait pas permis le débat et en plus cela n’aurait pas servi à grand chose. Ces différences sont bien connues, le temps est venu de les dépasser pour dialoguer vraiment. C’est ce qu’elles font.Elles s'adressent à toutes les femmes de la planète.
Michelle Perrot en fin de volume, promet de s’intéresser à ce pays qu‘est l‘Algérie : « ses paysages revisités, ses cultures, ses penseurs, son immense littérature, déployée des deux côtés de ma Méditerranée » et cela grâce à Wassyla Tamzali, femme de loi et culture, d’engagements, de luttes et de projets réalisés tel Les ateliers sauvages à Alger.
Or, la teneur de cet échange est d’une qualité, d’un niveau remarquable au point de nécessiter plusieurs lectures tant il est dense en rappels historiques, en rappels de faits présents, en défis, en références à tous les niveaux (un renvoi à des notes substantielles en fin de volume en témoigne).
« On peut toujours passer la porte du jardin sans la refermer ».
C’est certain, Michelle Perrot et Wassyla Tamzali ont ouvert davantage de portes, elles ont ouvert l‘infini, l‘infini humain des possibles pour toute une génération d’ « individues »*à l‘écoute et au désir fou de tourner la page d’un ordre établi qui n‘a que trop duré.
Un livre d’une grande richesse, un très bel et nécessaire éclairage pour ce qui peut advenir en thésaurisant d’abord ce qui est, parce qu’« on ne peut pas être libre seule » mais collectivement.
*« Il est question de féminiser « individue » afin de reconnaître dans et par le langage l‘évolution du statut de la femme ».



