Rester barbare, Louisa Yousfi, La Fabrique Editions, 2022, 113 p.
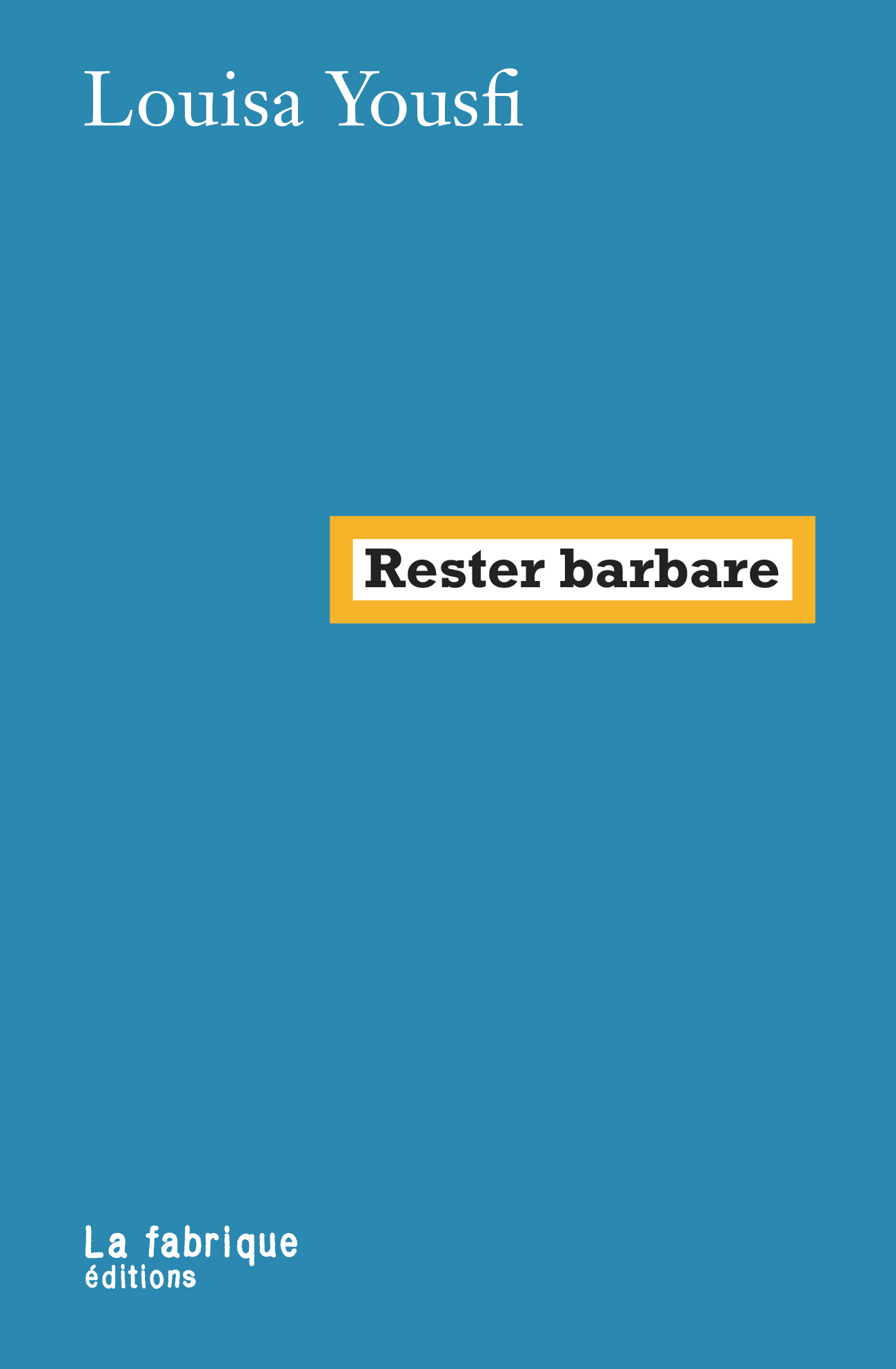
©
Comment rester insensible à la pensée, aux propos, aux actes, aux réalisations de Kateb Yacine ? Plus encore, son œuvre est un legs précieux, il l’a conçue comme tel : cela se sent à chaque ligne dans ses livres, dans sa voix lors d’émissions de radio et sur son visage dans les vidéos.
L’auteure cite aussi Mohamed Dib, Sony Labou Tansi, Toni Morrison, Chester Himes, Aimée Césaire, le rappeur PNL et d’autres comme autant de tentatives destinées à résister à l’entreprise de formatage de personnes passées au crible de la « civilisation blanche ». Autant de haltes, de regards qui donnent à penser, à réfléchir que cela fait des siècles que cette situation dure, celle du refus de l‘autre qu‘il soit « naturalisé, droit-du-soliste, à double nationalité, déchéançable de nationalité… »,p18, ajoutons-y le blédard renvoyable par charter chez lui. Et puis une fois que l‘on a compris ce qui se passe a société, comment l‘étranger est, considéré et traité, c’est toujours là, dans la tête, le corps, les émotions, l‘inconscient, on vit avec…(Je renvoie au livre implacable de vérités de Rachida Brahim « Le racisme tue deux fois »).
La journaliste Louisa Yousfi ne s’y est pas trompée : elle en a tiré la substantifique moelle, livrée dans ce livre absolument remarquable, écrit dans un ton vif, pressé, parlé, enthousiaste et militant.
« Je sens que j’ai tellement de choses à dire qu’il vaut mieux que je ne sois pas trop cultivé. Il faut que je garde une espèce de barbarie, il faut que je reste barbare. » Kateb Yacine.
Personne n‘est à l‘abri dès lors que sa face, son nom, sa famille porte le stigmate que l‘autre a figé sur l‘étranger, le noir, le colonisé. Cela fait beaucoup de monde, beaucoup plus qu‘une minorité d’individus.
C’est un livre terrifiant aussi parce qu‘il est sans détours, sans filtre, qu‘il regarde la société regarder l’autre.
Les diverses et différentes politiques migratoires ont toutes menées à l’échec. Cela aurait du alerter, questionner ? Pourquoi continuer à confiner un pan de la population dans une « zone de non-être » p 15 ? Et s’il y avait une véritable politique de reconnaissance de l‘étranger, lui donnant figure humaine, en capacité de vivre comme « tout le monde » ? Oui, le problème est là : Pourquoi donner quelque chose à quelqu‘un que l’on n’aime pas, dont on veut bien exploiter la force de travail, sans plus ?
Le fil rouge dans ce dédale c’est Kateb Yacine. Il a compris, lui qui a vécu la colonisation, la répression mortifère du 8 mai 1945, la guerre en Algérie ; il a organisé son œuvre comme un bouclier, un rempart, enrichie de messages à transmettre pour parer aux assauts du colonisateur en terre coloniale et hors d’elle, il savait qu‘il y en aurait d’autres encore.
L’écriture lui est venue à un moment clé de sa vie, il a 15 ans, un gosse d’une grande maturité, lors de la répression du 8 mai 1945 à Sétif, il est emprisonné avec d‘autres hommes en prison dans une cellule. Sa mère perd la raison, devient folle en l‘apprenant, il découvre le peuple, le peuple analphabète, il apprend beaucoup, il devient en cellule, écrivain public pour ses frères, cette expérience va le changer définitivement. Il s’est exprimé aussi lors de sa venue à Paris, interrogé lors d’une émission de radio où il dira la difficulté de rester lui-même de rester barbare malgré le tourbillon des tentations de la capitale française, il prône une culture « naturelle » faite de bon sens, de principes de vie éprouvés émanant de personnes proches de la terre vivant, au rythme des saisons, un peu à la manière de Montesquieu lorsqu‘il dit « qu‘il aime les paysans parce qu‘ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers ».
« Kateb Yacine : Il y a un côté, si vous voulez, assez barbare. Je rejette en partie notre culture. C’est un grave dilemme que d’être obliger à la fois de vivre, d’écrire et de se cultiver. On ne peut pas faire les trois, surtout si on veut en plus faire œuvre de révolutionnaire, et en plus rester libre dans la vie, libre toujours, libre de tout voir, si on veut pousser les choses jusqu’au bout. Alors, évidemment, il faut choisir. Ça a l’air facile mais c’est très, très difficile, parce qu’il y a toujours, surtout dans une vielle comme Paris, la tentation du cosmopolitisme, la tentation de vouloir acquérir des notions de culture qui en fait ne sont pas essentielles, qui sont des choses qu’on peut avoir connues mais pour celui qui veut créer vraiment, celui qui veut abattre, ça peut le gêner. Or, moi, je sentais qu’il y avait beaucoup de choses à abattre. Par exemple, je serais devenu une espèce de monstre, une espèce de glouton qui a dévoré des tas de plats étrangers, qui ensuite en fait un, pour dire : voilà, je connais la cuisine universelle. Mais en fait, ce n’est pas ça un poète. C’est quand même très difficile. Parfois il faut toute une vie, il faut aussi beaucoup de solitude, puis il faut chercher, ce que je n’ai pas encore trouvé moi, la vie profonde du pays, en Algérie. En Algérie, les plus cultivés c’est les analphabètes. Ceux qui m’en apprennent le plus, avec qui j’ai du plaisir à être, c’est ceux-là. Les chômeurs, par exemple, qui n’ont jamais été à l’école, c’est les plus riches.(Extrait d’une émission de radio du 19 mars 1998, une vie, une œuvre, Kateb Yacine, le poète errant (1929-1989).
On aurait apprécié que Louisa Yousfi poursuive la réflexion sur la pensée de Kateb Yacine, nous entraîne plus loin encore afin d‘en explorer tous les recoins. C’est sans doute à chaque lecteur concerné par cette problématique de le faire.
Plus encore, Louisa Yousfi amorce avec son livre une entreprise de décolonisation des esprits, pour inaugurer une voie nouvelle afin de couper le cordon mortifère d’une société encline à s‘adonner à des penchants répressifs.
C’est à ce prix que les barbares restaureront leur dignité.



