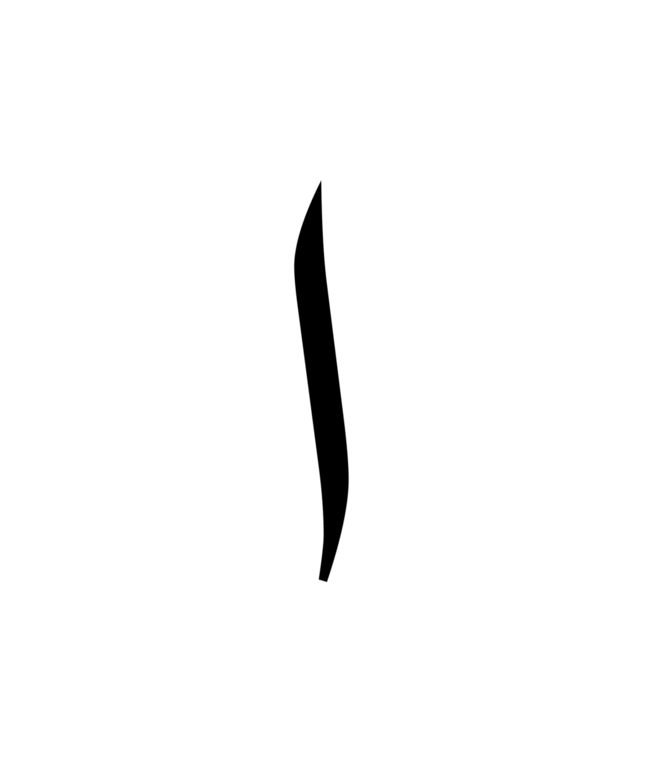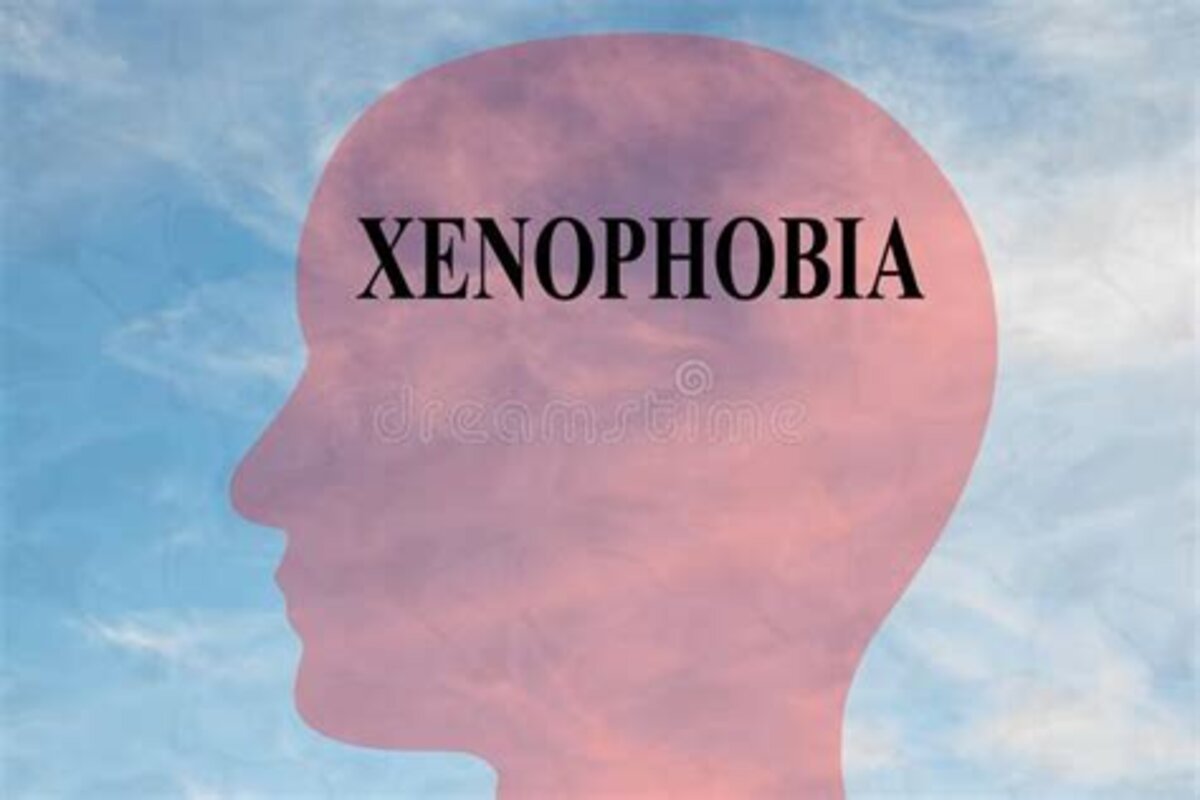
"Le terme de xénophobie est un néologisme du XIXème siècle. Il a été forgé par Anatole France dans le cadre de l’affaire Dreyfus. L’homme de lettres assemble deux mots du grec ancien Xénos (étranger) et phobos (peur) afin d’expliquer la fureur antisémites des antidreyfusards. Ainsi la xénophobie se définit comme « posture d’hostilité envers les étrangers, de ce qui vient de l’étranger ».
Si cette définition permet de se faire une idée du phénomène, elle ne donne in fine aucune information quant à sa nature, quant à ce qui la suscite et sur les ressorts de son déploiement. La peur étant un sentiment, elle ne peut donc en aucun cas être une cause déterminante à l’origine de la xénophobie (un sentiment est une conséquence non une cause - si nous avons peur c’est que quelque chose nous fait peur).
À y regarder de plus près et en adoptant un point de vue historique, il apparait que la xénophobie est en plus une opinion sociale versatile.
En premier lieu, son intensité varie selon les époques au grès des conjonctures sociales et économiques. Les cibles des xénophobes changent également selon les époques. Hier les italiens (les ritals) et les espagnols (les espingouins) étaient les « nuisibles », aujourd’hui ce sont les maghrébins et les subsahariens qui sont principalement pointés du doigt.
Cette versatilité historique est problématique pour l’identification et la compréhension des ressorts premiers de la xénophobie. Elle fragilise, pour ne pas dire qu’elle remet en cause, l’idée selon laquelle la xénophobie naît et s’alimente principalement du rejet des différences. Accepter simplement l’explication reviendrait ni plus ni moins à confondre la xénophobie et le racisme.
Selon nous, contrairement au racisme, la méfiance xénophobe à l’égard des différences n’est pas un de ses principaux ressorts. Elle relève plutôt du prétexte. Sinon, comment expliquer sans équivoque qu’un immigré en France d’ascendance norvégienne est certainement moins exposé à des attitudes xénophobes qu’un français de seconde génération descendant d’immigrés maghrébins ?
Si pour ce dernier sa nationalité française peut lui être disputée, il n’en sera rien pour l’enfant de seconde génération issu de l’émigré norvégien. Les carences des théories du « rejet des différences » ne cessent de donner à de nombreuses autres théories « complémentaires » ?
Face à cette « inflation » de rustines théoriques, n’importe quel lecteur assidu finit par admettre que la nature et les déterminants premiers de la xénophobie restent finalement encore à préciser. Ce qui est certain est que la xénophobie n’est pas un sentiment dont l’intensité est socialement stable et qu’il n’a pas pour cibles tous les étrangers.
Si la xénophobie échappe à notre pleine compréhension c’est parce que l’état des contextes sociaux et les préoccupations individuelles s’y intriquent. Ce constat de complexité nous invite à interroger la nature de la xénophobie à partir de ce qu’elle est : une opinion sociale versatile.
Et quoi de mieux face à une opinion que de s’interroger à savoir ce qu’elle cherche à nous dire ? N'est-elle qu’une posture de rejet de l’Autre ? Et finalement en quoi se distingue-t-elle des prises de positions racistes ?
La vraie nature de la xénophobie et ses ressorts ne se laissent pas appréhender aussi facilement. Comme toute opinion sociale, la xénophobie prend vie et s’exprime au travers des individus qui portent ses idées. Les xénophobes légitiment leur rejet de la différence sur la base de soupçons qu’ils projettent sur L’Autre.
Ces discours, souvent partagés avec ceux des racistes, s’appuient sur des a priori et des stéréotypes quant à la nature négative / toxique de certains autres et de leur culture. Une analyse un peu attentive de ces justifications révèlent rapidement qu’ils ne sont rien d’autre que des discours fallacieux.
Si peur et inquiétude il y a, les étrangers cibles ne sont ici que des boucs émissaires, un moyen, une voie détournée pour revendiquer le droit à des traitements préférentiels au nom de l’appartenance à la Nation. Le soupçon et la méfiance à l’égard de ceux désignés comme différents imposent une distinction entre un Nous et un Eux.
Cette distinction permet ensuite d’introduire l’idée centrale qui veut que défendre les intérêts individuels des nationaux revient finalement à défendre ceux de la Nation (et réciproquement).
La xénophobie a une double dimension indissociable. Elle est à la fois une posture individuelle de méfiance à l’égard de l’Autre et une dimension sociale et politique attachée à la souveraineté populaire nationale. Elle est à la fois, au niveau individuel, une inquiétude quant à la capacité future de chacun à préserver ses capacités de maintenir et faire fructifier ses intérêts personnels et, comme dimension sociale, une revendication politique de les préserver au nom de l’appartenance nationale. Autrement dit, la xénophobie est une revendication politique et populaire en faveur de la préférence nationale.
Pour certains acteurs politiques la xénophobie est un remarquable « couteau suisse » ; le moyen de se doter de rhétoriques mobilisatrices associant subtilement des propos rationnels à des sentiments d’inquiétudes et de peurs.
Dans le cadre de leurs stratégies de conquête du pouvoir, elle leur permet d’attiser les insatisfactions et les inquiétudes populaires. Et une fois au pouvoir, de se dédouaner de certaines de leurs responsabilités. Mais en absence de réponses concrètes et face aux sentiments d’inquiétude quant à l’avenir, il n’est pas certain que les populations citoyennes sensibles aux accents xénophobes continuent longtemps à croire aux culpabilités des boucs émissaires. A moins qu’ils ne basculent finalement dans une dimension plus radicale et inquiétante : le racisme. Et la responsabilité des politiques y sera pour beaucoup.
Finalement, l’étude de la xénophobie revient à s’interroger, selon un certain angle, sur la nature des liens entre égalité, solidarité et souveraineté populaire dans le cadre coalitionnel qu’est la Nation."
Ce texte est signé par Nordine Chouraqui
Nordine Chouraqui a 58 ans. Il est l'enfant d'Algériens immigrés dont le père est venu dans les années 1940 travailler dans les mines de charbons du Nord - Pas-de-Calais. Economiste de formation, il a essentiellement consacré sa carrière au développement et à la consolidation de l'Economie Sociale et Solidaire en France et à l'aide au développement à l'international (Afrique de l'Ouest, Haiti, Pologne...).. Il est à présent agriculteur. Il vit dorénavant entre la France et le Portugal où il exploite des oliviers, des fruitiers et produit de l'huile d'olive.
L'intégralité du texte en version pdf
article-quest-ce-que-nous-dit-finalement-la-xe-nophobie-vfinale