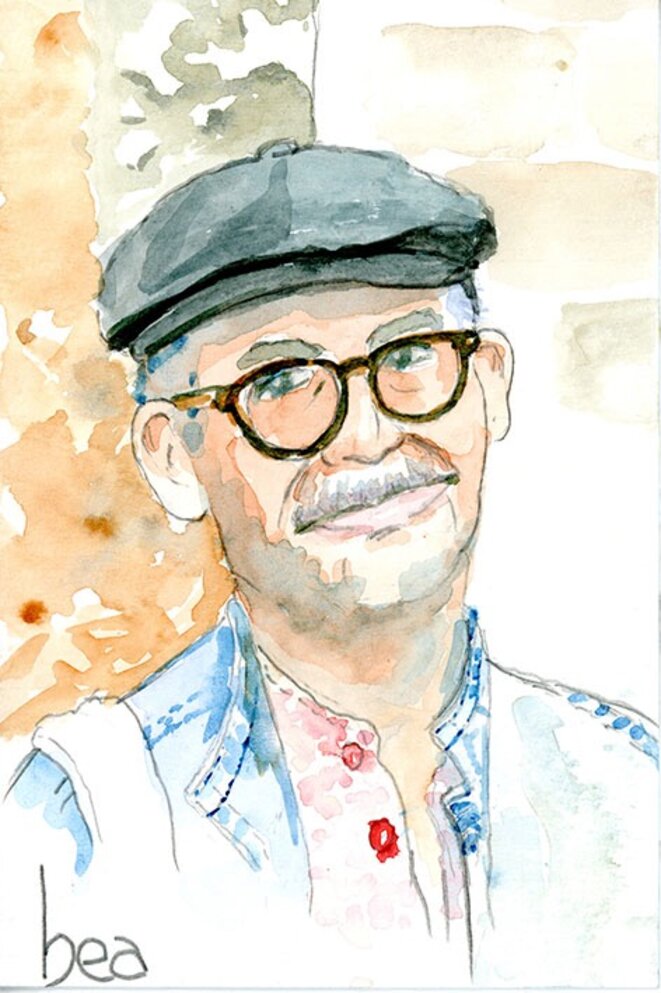Formé en 1942, avec le soutien de Staline, voire à son initiative, le Comité antifasciste juif (CAJ) a pour objectif d’appeler à la solidarité de l’opinion internationale, d’organiser le soutien matériel au combat de l’URSS contre le nazisme et de venir en aide aux Juifs victimes du génocide nazi. Sur proposition d’Albert Einstein et avec l’accord des autorités soviétiques, deux de ses principaux dirigeants, l’acteur Solomon Mikhoels et le poète Itzik Fefer, ont effectué en 1943 une tournée triomphale de plusieurs mois aux États-Unis : elle a permis à la fois de récolter des sommes considérables et de rehausser l’image de l’Union soviétique outre-Atlantique.
C’est encore sur la suggestion réitérée d’Einstein et après avoir obtenu l’aval de la direction du Comité central du Parti communiste d'Union soviétique (PCUS), que le CAJ décide dès l’été 1943 de se lancer dans la préparation d'un Livre noir sur l'extermination scélérate des Juifs par les envahisseurs fascistes allemands dans les régions provisoirement occupées de l'URSS et dans les camps d'extermination en Pologne pendant la guerre de 1941-1945. Les écrivains Ilya Ehrenbourg et Vassili Grossman coordonnent les recherches et notamment les interviews des témoins sur le terrain, puis l’écriture de l’ouvrage, avec 38 autres auteurs.
C’est un travail gigantesque et horriblement éprouvant. Car le génocide continue. Entre l’invasion hitlérienne de l’URSS, le 22 juin 1941 et le départ du dernier soldat allemand, plus de 1,5 million de Juifs sont exterminés, des pogroms « spontanés » aux fusillades de masse en passant par les camions à gaz, version modernisée des engins rudimentaires utilisés entre 1939 et 1941 pour liquider les handicapés allemands. Les historiens datent en général de juillet-août 1941 le passage du massacre au génocide : au moment où les directives appellent à tuer, non plus seulement les hommes (décret dit« des commissaires »), mais aussi les femmes et les enfants. À des degrés divers selon les Républiques, les régions et les villes, des milices de collaborateurs, voire une partie de la population civile assistent les tueurs nazis, quand elles ne les précèdent pas, notamment dans les Pays baltes.
La réalisation du Livre noir devient plus ardue et plus risquée au fur et à mesure que Staline change de politique vis-à-vis des Juifs soviétiques. En 1947, le Livre noir sera purement et simplement interdit. Entretemps, la répression antisémite a pris de l'ampleur. Les premiers rapports hostiles au « nationalisme bourgeois » du CAJ apparaissent dès 1943. Ils se multiplient et deviennent inquiétants en 1946. Et, à partir de 1948, à l'initiative d'Andreï Jdanov, se développe une vaste campagne de répression dite « anticosmopolite ».
L’année 1948 commence tragiquement avec, le 13 janvier, l'assassinat du président du CAJ, Mikhoels, puis des arrestations massives parmi ses camarades. Le Comité est bientôt dissous, son journal et sa revue fermés. À la suite du procès secret du CAJ, en mai-juillet 1952, tous les accusés – sauf une – seront condamnés à mort et exécutés. Puis vient l’interdiction de la quasi-totalité des institutions juives. La purge, massive et violente, va crescendo jusqu'à l’affaire des « Blouses blanches », ces médecins juifs accusés d'avoir comploté pour assassiner Staline et d'autres dirigeants. Seule la mort du Maréchalissime, le 5 mars 1953, aurait empêché – selon des sources polonaises citées dès 1956 et des historiens russes des années 1990 – une déportation massive des juifs soviétiques vers la Sibérie.
C’est ici que l’explication de Ribot me paraît courte. Certes, Staline était sans doute antisémite. Son passage, adolescent, par le séminaire orthodoxe de Tiflis (aujourd’hui encore, ces Églises, contrairement à l’Église catholique depuis le Concile Vatican II, considèrent encore les Juifs comme un « peuple déicide »…), la prégnance des préjugés anti-Juifs dans la société russe, leur inévitable reflet au sein du Parti bolchevik bien que (ou parce que) nombre de ses dirigeants étaient juifs, notamment ceux qui formeront l’opposition au successeur de Lénine expliquent sans doute cette tendance, attestée par de nombreux témoins. Mais cet antisémitisme ne saurait expliquer à lui seul la volte-face de la direction soviétique à l’égard du CAJ, qu’elle avait créé, soutenu et largement utilisé au profit de l’image – et des finances – de l’URSS.
Étonnamment, Ribot fait l’impasse sur la principale clé de ce « mystère » : l’engagement massif de Moscou aux côtés des forces juives dans leur combat pour la conquête de la Palestine et l’expulsion des 4/5e de ses habitants arabes. D’abord diplomatique (l'URSS se prononce le 14 mai 1947 à l’ONU pour le partage de la Palestine, qu’elle vote avec presque toutes les « démocraties populaires » le 29 novembre de la même année), cet engagement devient bientôt politique (le PCUS impose son choix à l’ensemble du mouvement communiste, provoquant même des scissions dans les PC arabes) et surtout militaire : Staline fait livrer par Prague des armes lourdes et légères en grande quantité et qualité à la Hagana à partir de la fin mars 1948 : « Les armes tchèques ont sauvé le pays (…). Elles constituèrent l’aide la plus importante que nous ayons obtenue. Je doute fort que, sans elles, nous aurions pu survivre les premiers mois », reconnaîtra vingt ans plus tard David Ben Gourion. Moins connu : le PCUS invite ses homologues des pays de l’Est à laisser les Juifs aller prêter main forte à leurs « frères » en Palestine, ce que feront 300 000 d’entre eux entre 1948 et 1951.
Contrairement à ce qu’a soutenu Hélène Carrère d’Encausse, Staline, anti-sioniste convaincu, ne rêvait d’un Israël socialiste – aux premières élections, en 1949, le PC n’y obtiendra que 3,5% des voix, et le Mapam, sioniste de gauche, 15%. Dès août 1948, Ben Gourion accueillait l'ambassadeur américain en affirmant : « Israël salue le soutien russe aux Nations unies, mais ne tolérera pas de domination soviétique. Non seulement Israël est occidental dans son orientation, mais notre peuple est démocrate et réalise qu’il ne peut devenir fort et rester libre qu’à travers la coopération avec les États-Unis. »
Non : la position soviétique est purement géopolitique et pragmatique : elle vise à chasser les Britanniques de Palestine pour miner leur influence, vacillante, au Moyen-Orient. Les Américains se donnent d’ailleurs exactement le même objectif, sauf qu’ils veulent et peuvent y prendre pleinement à terme la relève des Britanniques. Cette convergence – qui se traduit par l’appui de Moscou et de Washington au plan de partage de la Palestine, donc à la création d’Israël – serait incompréhensible si on oubliait qu'en 1947, la guerre froide commence à peine : c’est le coup de Prague, en février 1948, qui en donnera le signal. L’ URSS et les États-Unis mesurent déjà le caractère stratégique de la région, voie de communication Europe/Asie/Afrique, détentrice des plus grandes réserves de pétrole du monde et ceinture méridionale du« camp socialiste ».
Mais politique extérieure et politique intérieure ne sont jamais étanches. Au-delà du climat antisémite propre de longue date à la Russie, l’obsession du régime depuis les années 1930, c’est le maintien à tout prix du caractère pyramidal du pouvoir. Sa principale crainte, c’est qu’une minorité, a fortiori juive, conquière son autonomie. Or le CAJ, son influence en URSS même, aux États-Unis et ailleurs dans le monde occidental inquiètent Staline. D’instrument ami, il devient progressivement un ennemi menaçant pour le Kremlin. Car il s’enhardit jusqu’à suggérer officiellement, par exemple, la création d’une République juive en Crimée, une région beaucoup plus importante que le lointain Birobidjan, créé en 1934 à 6 000 km de Moscou et aux confins de la Chine, dont la langue officielle reste le yiddish…
Le 11 septembre 1948, Staline panique. Ce jour-là, plus de 20 000 Juifs moscovites – au lieu des 2 000 fidèles habituels –se retrouvent à la Grande synagogue pour accueillir en liesse la première ambassadrice d’Israël, Golda Meïr. Cette mobilisation se répète le 4 octobre pour Rosh Hachana (le Nouvel an juif) et le 10 octobre pour Kippour (le Grand pardon). À mon avis, Ribot analyse unilatéralement le fameux article d’Ilya Ehrenbourg paru au beau milieu de ces événements, dans La Pravda du 18 septembre. Transmission d’un message menaçant de Staline, sans doute, mais aussi mise en garde du plus célèbre des intellectuels juifs encore en vie à ses « frères » : « L’avenir des travailleurs juifs de tous les pays est lié à celui du socialisme. Les juifs soviétiques, avec tout le peuple soviétique, travaillent à la construction de leur mère patrie socialiste. Ils ne regardent pas vers le Proche-Orient – ils regardent uniquement vers le futur. Et je crois que le peuple travailleur de l’État d’Israël, qui ne partage pas le mysticisme des sionistes, regarde maintenant vers le Nord – vers l’Union soviétique. »
Pour la direction du PCUS, que Moscou soutienne les forces juives en Palestine n’autorisait pas les Juifs soviétiques à manifester en toute indépendance pour cette cause. Et afin que nul n’en doute, Staline fait un exemple : l’épouse du ministre des Affaires étrangères Viatcheslav Molotov, qui avait osé s’entretenir en yiddish avec la représentante d’Israël lors d’une réception officielle au Kremlin, est arrêtée, contrainte à divorcer et envoyée au Goulag.
« La contradiction entre la politique intérieure – de répression des Juifs d’URSS – et la politique extérieure – de neutralité passive à l’égard d’Israël [était] devenue insurmontable », écrit mon ami Laurent Rucker, auteur d’une thèse remarquable, fondées sur les archives soviétiques, et d’un livre passionnant, Staline, les Juifs et Israël (PUF, 1991), qui éclairent toute cette histoire.
Y compris celle des procès qui se suivent et se ressemblent dans les « démocraties populaires ». À partir de celui de Laszlo Rajk (Hongrie, 1949), ils viseront souvent des Juifs, désignés comme tels ou comme « sionistes ». À Prague, les organisateurs de l’aide militaire à Israël seront jugés en marge du procès Slansky (1952) : Mordechaï Oren, dirigeant de l’Hachomer Hatzaïr (sioniste de gauche), qui avait coordonné l’opération, est condamné à quinze ans de prison – il n’en fera que quatre.
De fait, le grand écart ne durera pas. Israël arrimé avec la guerre de Corée à l’Occident, les relations entre Tel-Aviv et Moscou se dégradent progressivement jusqu'à la rupture diplomatique du 12 février 1953, après un attentat contre la légation soviétique. Trois semaines plus tard, Staline meurt et, avec sa disparition se referme cette page étrange.
Bientôt, les Soviétiques se tourneront dans le monde arabe, pour cueillir les fruits de l’effondrement de l’influence britannique aux Proche et Moyen-Orient : les révolutions qui renversent les monarques pro-britanniques d’Égypte et d’Irak amènent au pouvoir des dirigeants qui, snobés par l’Occident, s’allieront durablement à l’Union soviétique.
Devant le Soviet suprême, un Nikita Krouchtchev « amnésique » s’exclamera : « Nous comprenons les aspirations des peuples arabes qui luttent pour leur pleine libération de la domination étrangère. En conséquence, nous ne pouvons que condamner les actions d’Israël qui, depuis les premiers jours de son existence, a menacé ses voisins et adopté une politique hostile à leur égard. » Doté d’une meilleure mémoire, le ministre israélien des Affaires étrangères Abba Eban explique : « En 1948, Moscou nous avait soutenus parce que nous étions le meilleur garant du départ des Britanniques de Palestine. Une attitude identique de la part des pays arabes vis-à-vis de la Grande-Bretagne et de ses alliés amena par la suite les Russes à adopter une attitude pro-arabe. »
Dominique Vidal