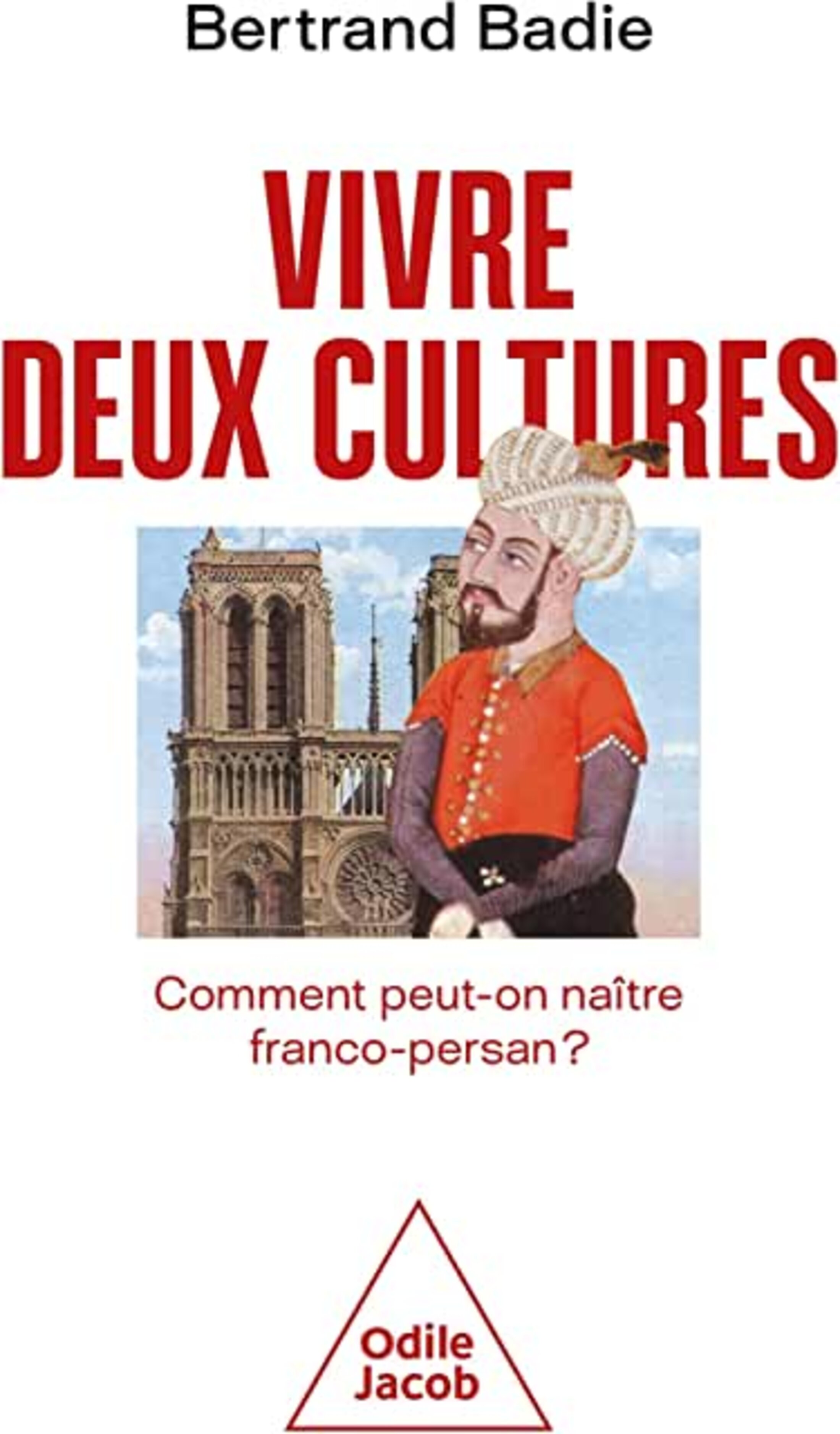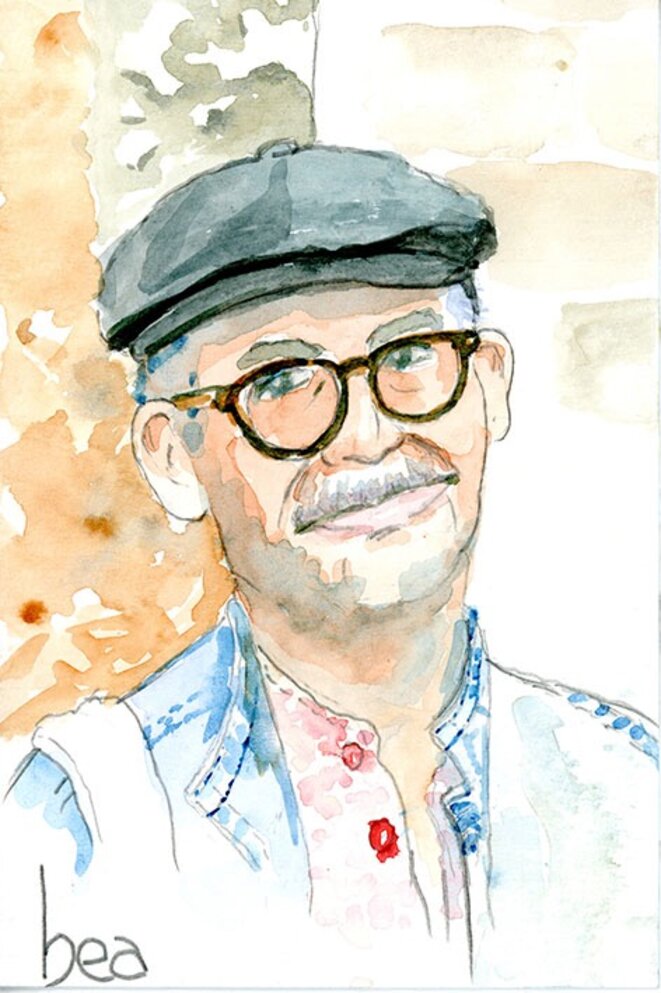J’ai la chance de travailler depuis treize ans avec Bertrand Badie, co-dirigeant à ses côtés l’annuel L’État du monde, qui, après quatre décennies à La Découverte, connaît en cette rentrée une nouvelle vie aux Liens qui libèrent [1]. Paradoxalement, je n’ai réellement compris ses ressorts intimes qu’à la lecture de son dernier livre : Vivre deux cultures. Comment peut-on naître franco-persan?[2].
J’en suis bien sûr conscient : notre complicité intellectuelle devrait me décourager de recenser ce livre comme les précédents. Si je m’y risque pourtant, c’est que ma familiarité avec sa pensée me permet sans doute de mieux apprécier la sorte d’auto-analyse à laquelle il se livre – mais aussi parce qu’à bien des égards, nos jeunesses respectives présentent certains points communs.
Les idées-forces de Bertrand Badie sont connues. Le cadre westphalien n’existe plus. À l’ère bipolaire a succédé, après un bref moment d’illusion unipolaire, un monde a-polaire, mais rendu interdépendant par la mondialisation. La puissance n’est plus la puissance, et l’impérialisme américain se voit bousculé par d’autres, russe et chinois notamment. Le Sud, qui n’a cessé de s’affirmer, refuse de prendre parti dans ces conflits inter-impérialistes. Au-delà, ce sont toutes les sociétés qui deviennent un acteur majeur et parfois même décisif des relations internationales.
Cette perception originale de l’histoire contemporaine, développée dans les dizaines de livres qu’il a écrits ou dirigés, Bertrand Badie l’a forgée tout au long des décennies, au fil de ses voyages, de ses rencontres, de ses cours et de ses conférences en France et aux quatre coins du monde. Il s’agit évidemment d’une construction intellectuelle, mais dont le lecteur mesure, en tournant les pages de Vivre deux cultures, combien elle s’enracine dans une enfance et une adolescence marquées par le cosmopolitisme.
Sa mère vient de ce qu’il appelle « une bourgeoisie de sous-préfecture », en l’occurrence une famille catholique et réactionnaire de Soissons pétrie « de préjugés ancestraux reproduits à l’infini par la bonne conscience ». Son père, jeune Iranien, arrive à Paris en 1928 avec ses parents et sa fratrie. Pour leur enfant unique, ce multiple terreau culturel, religieux et linguistique représente d’abord un formidable atout, tant il va puiser dans sa persanité, qu’il approfondit avec son père et sa famille iranienne lors d’émouvants voyages sur place. « Je vivais très jeune enfant, écrit-il, dans ce double monde, de façon tellement quotidienne et intime qu’ils me semblaient constituer, l’un et l’autre, un ensemble unique, mon propre univers, celui qui était vite devenu inséparable de mon cheminement individuel. »
Mais il découvre aussi très tôt le revers de la médaille. Dans le célèbre collège religieux où ses parents l’inscrivent, en pleine guerre d’Algérie, ses condisciples de (très) bonne famille le traitent comme un « bicot-youpin » qu’ils transforment vite en souffre-douleur : aux insultes s’ajoutent des coups, et les lunettes régulièrement cassées. « Que voulez-vous, dira le directeur à ses parents, votre fils est tellement faible en gymnastique ! »
Bis repetita non placent : les humiliations infligées à Mansour Badie avaient dépassé de loin celles endurées par Bertrand. « Mon père avait jadis voulu quitter ce “tiers-état” du monde, mais il ne s’en est pour autant jamais dissocié : c’était le secret de sa force , de sa manière de combattre ce qu’il percevait comme une asymétrie du monde. Asymétrie qui se fit méprisante, qui pesait chaque jour sur la vie de cet homme, perceptible à tant de “petits riens”, invisibles par tant de “gens bien intentionnés”, petites vexations dont il souffrait en silence avec une dignité dont j’ai tant appris ».
Il n’y eut pourtant pas que des « petits riens » : après-guerre, le grand médecin – qui a pourtant été en charge de deux hôpitaux et promu chevalier de la Légion d’honneur par le général De Gaulle pour sa contribution à la Résistance – se verra refuser le droit de s’installer en France comme chirurgien : il restait… étranger ! Sa nomination, plus tard, à l’ambassade de Téhéran à Paris vengera cet outrage…
À quelque chose malheur est bon. « J’ai conquis à travers quelques-uns de ces moments de souffrance, écrit Badie, la certitude de mon bon droit lorsqu’il était outrageusement blessé. » Et de reconnaître : « Peut-être même y ai-je appris une forme d’intransigeance, le refus de certains compromis ou de diverses complaisances. » La leçon dépasse sa seule personne : « N’est-ce pas là, ajoute-t-il, le très pâle reflet d’un trait devenu familier des relations qui se sont construites entre le Nord et le Sud de notre monde, la clé de bien des outrances, verbales ou matérielles, commises par ceux qui ont été nourris à l’école de l’humiliation subie ? »
Avec le temps et les études, mais surtout après Mai 1968, les épreuves subies imprègnent toute sa vision du monde : « Moi qui avait dû, pendant des années, affronter les rebuffades des porteurs de souches et de racines, j’étais heureux de baigner dans un air nouveau grâce auquel l’humanité dans son entier était enfin tenue pour une grande famille solidaire.[…] L’Autre avait désormais un droit affiché à l’existence et à la dignité, il accédait à la dignité de servir d’exemple ; on admettait enfin qu’un Palestinien puisse aussi souffrir d’avoir tout perdu de l’héritage de la vie. On était bien dans le monde global, dans cet espace où l’itinéraire de mon père et celui de ma mère pouvaient enfin se réconcilier. »
Par-delà joies et peines, c’est le croisement même des identités qui imprègne la pensée du jeune Badie. « La double culture, écrit-il plusieurs décennies plus tard dans son dernier livre, offre le privilège rare de pouvoir toujours se regarder depuis quelque part, depuis un ailleurs qui donne un vrai relief à ce que vous contemplez. Elle aide à débusquer les arrogances, les préjugés, les réactions abusivement affectives. » Et d’ajouter : « Loin de moi l’idée qu’elle confère un statut de neutralité, mais au moins sert-elle de marqueur pour souligner les outrances, les audaces instinctives qui gouvernent la parole automatique et les jugements à l’emporte-pièce. »
[i] Bertrand Badie et Dominique Vidal (dir.), Le monde ne sera plus comme avant, LLL, Paris, 2022.
[2] Odile Jacob, Paris, 2022.
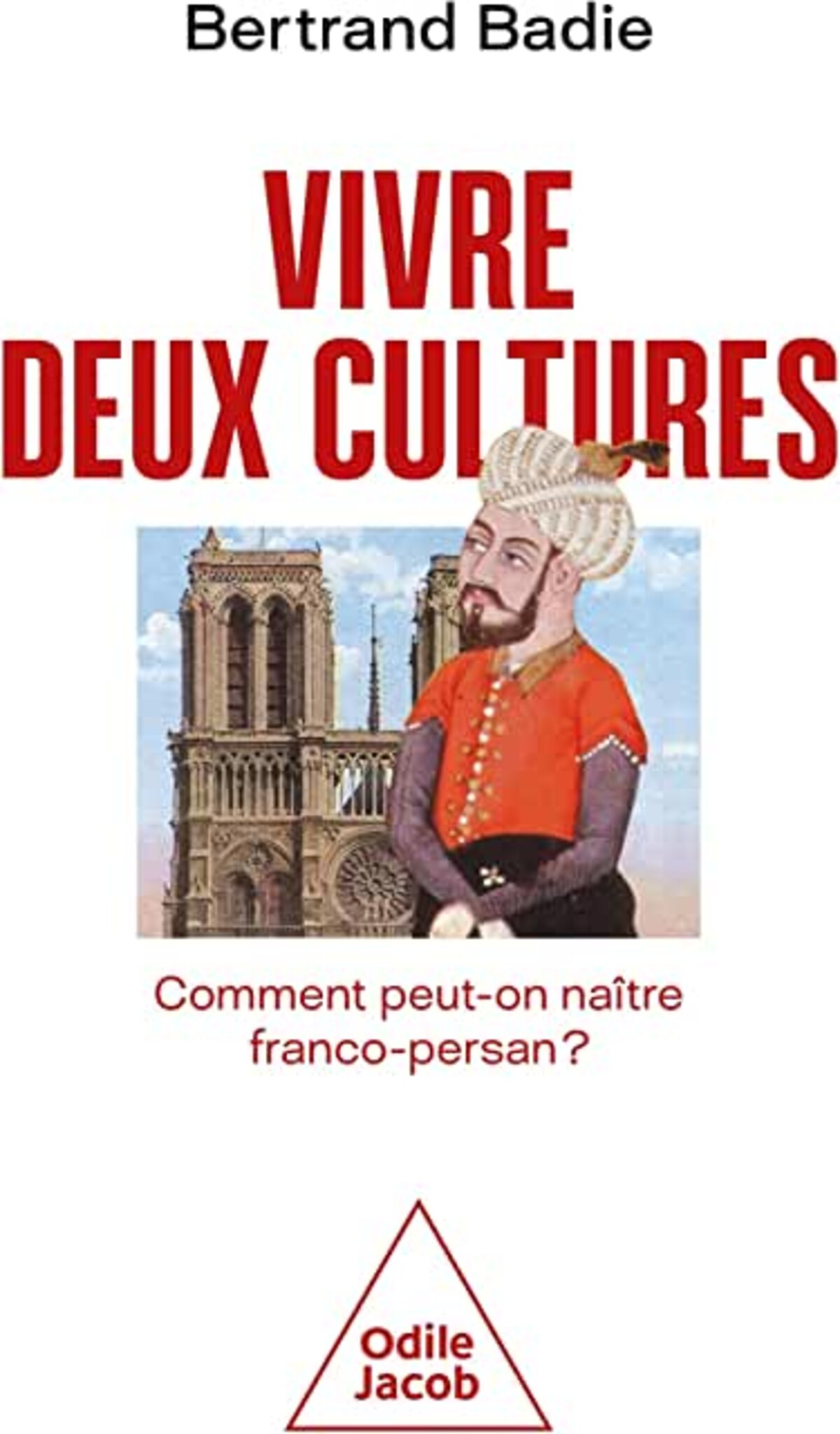
Agrandissement : Illustration 1