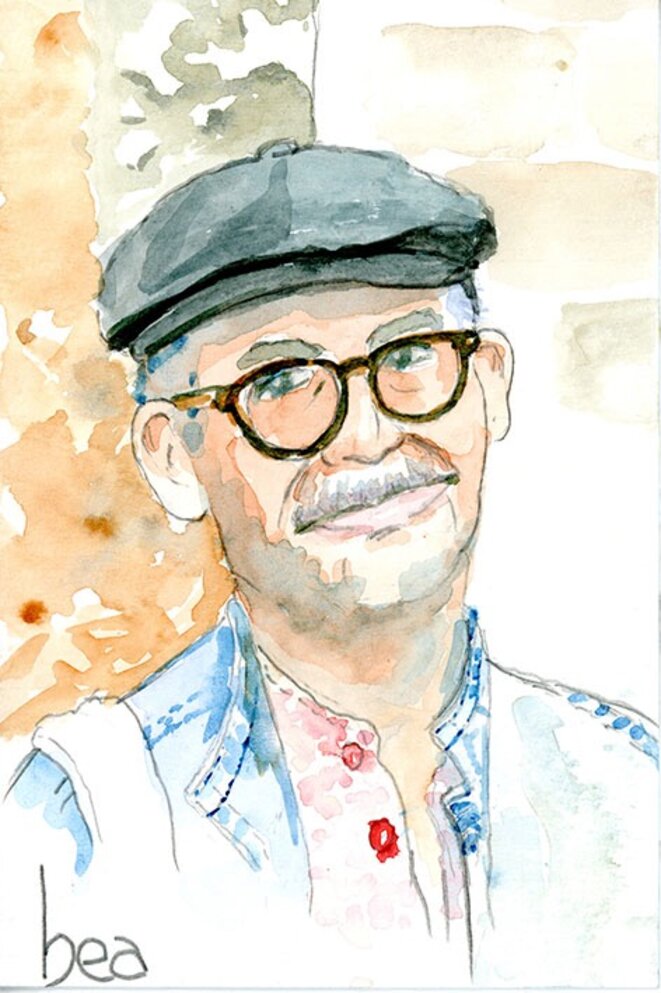D’abord un problème d’échantillon
L’échantillon témoin qui fonde la « Radiographie de l’antisémitisme en France [1] » de la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol) de 1 509 personnes dit « représentatif de la population française dans son ensemble », constitué grâce à la méthode des quotas, comporte les difficultés habituelles. Plus une : le fait de n’interroger que les plus de 18 ans constitue un biais sérieux, nombre d’études sociologiques soulignant que les jeunes sont nettement plus résistants au racisme que les adultes…
Créés à partir de groupes beaucoup plus larges constitués par l’IFOP, les deux autres échantillons « représentatifs » de 501 personnes « de confession ou de culture musulmane » et de 521 personnes « de confession ou de culture juive », les unes et les autres « auto-déclarées », présentent des difficultés spécifiques. D’abord la loi interdit le recueil de données religieuses : la Fondapol l’a-t-elle violée ? Plus généralement, nul n’ignore que le rapport à l’islam et plus encore au judaïsme est très diversifié : les opinions d’un croyant vivant essentiellement au sein de la « communauté organisée », plus facile à identifier, peuvent différer sensiblement de celles. d’une personne non croyante, pas ou peu insérée dans ladite communauté. Comment, dans ces conditions, parler DES juif et DES musulmans en général sans différencier cette diversité ?
Ensuite des problèmes de définition
S’agissant de l’antisémitisme, l’enquête entretient une évidente confusion entre idéologie, préjugés et actes de violences – l’absence de références à des statistiques fiables sur ces derniers étonne. Plus grave encore, les sondeurs ne distinguent pas suffisamment les faits et leur perception.
Ainsi, les sondés ont à 64 % l’impression que l’antisémitisme est « répandu » et « en augmentation ». Mais, interrogés sur leurs « antipathies », ils placent les juifs en avant-dernière position (5 %, - 4 % par rapport à 2016), juste devant les protestants (4 %), mais loin derrière les Roms (34 %), les musulmans (21 %), les Maghrébins (20 %), les Turcs (19 %), les Noirs (9 %), les étrangers en général (9 %), les homosexuels (7 %) et les Asiatiques (6 %).
D’où de nombreuses réponses contradictoires
Une grande majorité de répondants voit dans l’antisémitisme un problème qui concerne la société tout entière (73 %) et pas seulement les juifs (8 %).
La proportion de Français, qui estiment que l’on n’en parle pas assez, progresse nettement par rapport à 2019 (34 %, + 8 points). « Vous est-il arrivé d’entendre dire, dans votre entourage, du mal des juifs ? » Oui répondent 23 % des sondés, contre 77 % de non.
Enfin, s’agissant de la commémoration de la Shoah, 39 % des sondés la jugent « indispensable », 45 % « importante mais pas indispensable » et 16 % seulement « secondaire ». Empêche-t-elle « l’expression de la mémoire d’autres drames de l’histoire (traite négrière, guerre d’Algérie, génocide au Rwanda) » ? « Oui », répondent 35 % des sondés, et « non » 65 %. L’hypothèse d’une convergence des mémoires n’est même pas suggérée…
Enfin des confusions dans la définition des causes
En tête, avec 53 % des réponses, apparaissent le « rejet » et la « haine d’Israël ». Que signifient ces termes pour les sondeurs de la Fondapol ? Certes, ils notent que « l’analyse chronologique des actes antisémites violents montre que la multiplication des agressions est en lien avec les périodes de tensions au Proche-Orient ». Mais ils ignorent étrangement (?) la politique d’occupation et de colonisation, voire d’annexion d’Israël, a fortiori les crimes que son armée et ses colons commettent quotidiennement en Palestine.
Faut-il déduire de cette contradiction que la Fondapol assimile la « critique » au « rejet » et à la « haine » ? L’excellente politiste Nonna Mayer avait déjà dénoncé ce biais de la Fondapol en 2014, appelant à « parler d’antisémitisme avec rigueur » et critiquant la référence à Pierre-André Taguieff qui « voit un antisémitisme masqué derrière la critique d’Israël et du sionisme [2] ». Parlons clair : si les juifs français ne sont évidemment pour rien dans les horreurs en Palestine occupée, quand le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) défend inconditionnellement Israël en leur nom, ne les transforme-t-il pas volens nolens en cibles ? Voilà qui explique sans doute pourquoi – note la Fondapol – « 55% des Français juifs interrogés [72 % de ceux qui portent des signes religieux] indiquent se sentir davantage en danger lors des phases d’affrontements opposant Israéliens et Palestiniens ».
En deuxième position des causes de l’antisémitisme arrivent à 48 % « les idées islamistes ». Faute d’une définition plus précise de celles-ci, dans un contexte d’islamophobie décomplexée, difficile d’interpréter le sens cette réponse. Viennent ensuite à 37 % le « complotisme », à 36 % les « idées d’extrême droite » et enfin à 13 % les « idées d’extrême gauche [3] ». La disproportion entre ces deux dernières réponses, soulignons-le, contredit de manière flagrante aussi bien la thèse fumeuse de l’« islamo-gauchisme » que le renvoi dos-à-dos des « extrêmes ».
Ce renvoi trouve néanmoins un aliment dans la plus grande perméabilité des électorats de la France insoumise (FI) et du Rassemblement national (RN) à certains préjugés antisémites :
- les juifs, selon le plus répandu, seraient « très unis entre eux » de l’avis de 72 % des sondés. La proportion monte pour les électeurs de la FI à 81 % et pour ceux du RN à 76 % ;
- ils seraient « plus riches que la moyenne » pour 30 % des sondés, mais pour 36 % des proches de la FI et 37 % de ceux du RN ;
- ils auraient « trop de pouvoir dans l’économie et la finance » aux dires de 26 % des sondés, pourcentage grimpant à 34 % pour la FI et à 33 % pour le RN ;
- ils auraient « trop de pouvoir dans la politique » pour 19 % des sondés, 23 % des proches de la FI et 26 % de ceux du RN ;
- ils auraient aussi « trop de pouvoir dans les médias », estiment 24 % des sondés, 29 % côté FI et 27 % côté RN ;
- ils utiliseraient « dans leur propre intérêt leur statut de victimes du génocide nazi » selon 30 % des sondés, mais 47 % des sympathisants FI et 39 % de ceux du RN ;
- enfin, 10 % les prétendent « responsables de nombreuses crises économiques », pourcentage atteignant 15 % côté FI et 13 % côté RN ;
- à l’inverse, une proportion similaire dans tous les électorats les juge « injustement attaqués quand les choses vont mal » : 57 % des sondés, 56 % des FI et 57 % des RN.
On regrettera que la Fondapol ne fournisse pas, notamment sur ces préjugés, les réponses des sympathisants de TOUTES les sensibilités politiques. Hélas, la comparaison avec la moyenne des sondés souligne un phénomène préoccupant. Et, semble-t-il, assez récent : une enquête, publiée il y a quatre ans, dépeignait les sympathisants de la France insoumise (et du Parti communiste) comme à la fois les plus critiques vis-à-vis de la politique d’Israël ET les plus résistants aux préjugés antisémites [4]. « Au niveau individuel, concluait-elle, il n’y a pas de relation évidente entre l’antisionisme et l’antisémitisme. » Et Brice Teinturier affirmait alors : « On ne peut pas, rapidement et un peu caricaturalement, dire que le premier [l'antisionisme] dissimulerait le second [l'antisémitisme] [5]. »
Juifs et musulmans : relativiser
Pour les raisons évoquées plus haut, il conviendrait de relativiser les réponses des échantillons juif et musulman.
S’agissant des juifs, la Fondapol enfonce des portes ouvertes : ils sont évidemment plus sensibles aux manifestations verbales et a fortiori physiques d’antisémitisme. De là à affirmer que 68 % des juifs ont subi des « moqueries », 53 % des « insultes ou des injures », 24 % des « menaces d’agression » (et même 28 % sur les réseaux sociaux), 22 % des « vols » et 20 % des « violences »… Si c’est le cas, comment expliquer qu’interrogés sur l’avenir, leurs réponses ne soient pas radicalement inférieures à celles de la moyenne des sondés : 8 % des juifs sont « très optimistes » (6 %), 40 % « plutôt optimistes » (48 %), 41 % « plutôt pessimistes (48 %) et 10 % « très pessimistes » (8 %).
S’agissant des musulmans, les mêmes réserves s’imposent que pour les juifs : la diversité des degrés de religiosité et d’appartenance communautaire est-elle prise en compte ? Les réponses que recense l’enquête de la Fondapol marquent un niveau d’antisémitisme un peu plus élevé que la moyenne : 15 % des sondés musulmans disent, par exemple, éprouver de l’antipathie pour les juifs (contre 4 %). Idem pour les différents préjugés évoqués plus haut.
L’enquête de Fondapol nous indique qu’« il arrive » à 48 % des musulmans « de se sentir menacés dans leur vie quotidienne en raison de leur appartenance religieuse » et à 40 % « en raison de leurs origines ethniques » – pour les juifs respectivement 37 % et 22 %. Mais la Fondapol, visiblement, ne croit pas à l’islamophobie, que la Commission consultative des droits de l’Homme (CNCDH) dénonce pourtant depuis 2013 comme une forme de racisme. Et son dernier rapport observe par exemple que :
- l’« indice de tolérance » n’atteint que 60 % pour les musulmans, derrière les Noirs et les juifs (79 %), les Maghrébins (72 %) et devant les seuls Roms (36 %) ;
- l’injure « sale Arabe » est jugée moins grave (67 %) que « sale Français » (84 %) ;
- combattre l’antisémitisme (76 %) est considéré plus nécessaire que lutter contre l’islamophobie (66 %) ;
Les sondeurs de la Fondapol n’ont visiblement pas interrogé les musulmans, contrairement aux juifs, ni d’ailleurs les Arabes sur les « moqueries », « insultes », « menaces d’agression », « vols » et « agressions » qu’ils subissent. Ils ne se sont pas non plus intéressés aux discriminations qui les frappent massivement dans la vie économique, sociale et politique. Sans parler des violences policières au faciès : Dominique Reynié penserait-il, comme Gérald Darmanin, qu’elles n’existent pas ? Ce n’est bien sûr pas en France que des membres des forces de l’ordre pourraient espérer qu’un Arabe se noie car « les bicots ne savent pas nager »…
D. V.
[1] Anne-Sophie Sebban-Bécache, Dominique Reynié, François Legrand, Simone Rodan-Benzaquen : www.fondapol.org/etude/radiographie-de-lantisemitisme-en-france-edition-2022/
[2] Le Monde, 6 décembre 2014.
[3] Les idées d’extrême gauche sont aussi les dernières citées par les juifs (21 %), les catholiques (14 %) et les musulmans (13 %).
[4] Cf. « L’évolution de la relation à l’autre dans la société française (2018) : www.ipsos.com.fr
[5] www.akadem.org/conferencier/Teinturier-Brice-6669.php