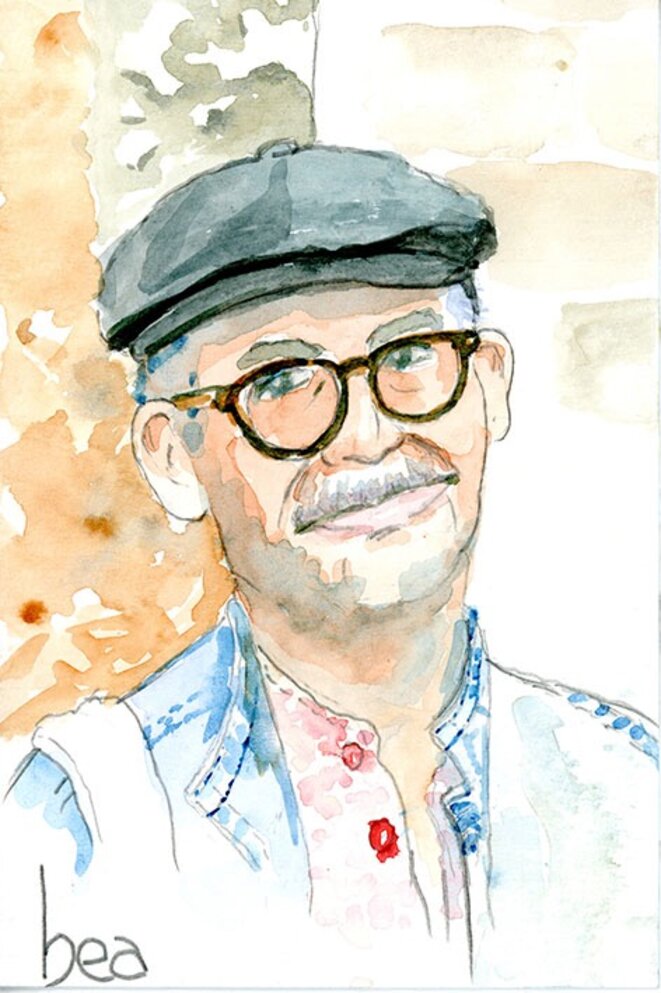Jusqu’au 6 avril dernier, la députée Silman, membre du parti nationaliste-religieux Yamina, dont le Premier ministre Naftali Bennett est issu, était cheffe de la coalition majoritaire à la Knesset. À l’origine de son départ, il y a le refus du ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, par ailleurs leader du parti de gauche sioniste Meretz, d’imposer aux hôpitaux publics les règles religieuses de Pessah, la Pâque juive. Pour Silman, l’attitude du ministre est « l’atteinte de trop à l’identité juive d’Israël ». Engagé contre l’influence des religieux sur les affaires publiques, Horowitz représente cette tendance « laïque » du gouvernement.
À ses côtés, le ministre des Finances, Avigdor Liberman, nationaliste mais farouchement engagé contre les religieux, a accepté de repousser sa loi qui devait réduire les subventions aux garderies pour certains enfants de familles ultra-orthodoxes. À l’annonce du projet, d’autres députés de Yamina menaçaient de quitter le gouvernement. L’objectif du ministre vise à conditionner ces aides aux parents travaillants au moins 24 heures par semaine.
Ainsi, selon Liberman, les 12 % d’ultra-orthodoxes qui vivent en Israël, et qui représentent la population juive la plus pauvre mais au plus fort taux de natalité, seraient contraints de s’intégrer sur le marché du travail voire de se soumettre à la conscription militaire, dont la majorité d’entre eux reste exemptée. À l’annonce du projet de loi, certains députés de Yamina menaçaient de quitter le gouvernement.
Tout porte à croire que ce report ne suffira pas pour atténuer les tensions entre ceux au sein du gouvernement qui bataillent pour une séparation entre le rabbinat et l’État, quand nationalistes religieux y voient une alliance logique au sein d’un pays censé être celui du « peuple juif ». Les premiers peuvent s’appuyer sur une majorité nette : dans son dernier Index, l’organisation israélienne Hiddush, qui défend les libertés religieuses et l’égalité, indique que 59 % des Juifs israéliens soutiennent une telle séparation.
Au clivage entre laïcs et religieux s’ajoute celui pour le modèle de société. En janvier, la ministre de l’Intérieure Ayelet Shaked, également issue du parti Yamina, s’est félicitée du vote en faveur de la loi sur la citoyennetéindiquant ainsi renforcer l’identité juive de la société israélienne au détriment d’une société de tous ses citoyens. La loi, introduite en 2003, est régulièrement renouvelée. Suite aux multiples crises politiques en Israël ces dernières années, le renouvellement n’avait pas été validé depuis juillet 2021. Le nouveau gouvernement y a remédié, limitant encore davantage le droit au regroupement familial pour les citoyens palestiniens d’Israël.
Actuellement, environ 12 500 Palestiniens vivent avec un-e conjoint-e de citoyenneté israélienne. Ils/elles doivent constamment renouveler leur titre de résidence et ne disposent pas, entre autre, du droit d’ouvrir un compte bancaire. Par ailleurs, en cas de décès du ou de la conjoin-te, ils/elles risquent l’expulsion, y compris s’ils/elles ont des enfants. Plusieurs députés avaient manifesté leurs vives oppositions, tandis que le ministre Horowitz parlait explicitement à son encontre de dispositions discriminantes et racistes. Mansour Abbas, leader du parti islamo-conservateur Ra’am, également membre de la coalition gouvernementale, s’était aussi prononcé contre la loi.
Du tout sauf Netanyahu au tout sauf Odeh ?
Si la coalition gouvernementale est menacée, c’est aussi parce que le Likoud ne lui reconnait aucune légitimité. Aux dernières élections, Netanyahu avait obtenu un million de voix, sur 6,5 millions d’inscrits, soit presque deux fois plus que son premier opposant, le sioniste libéral Yair Lapid, censé devenir Premier ministre dans quelques mois comme le veut l’accord passé avec ses alliés de droite. Autant dire qu’un retour de Netanyahu n’est pas à écarter. Celui-ci s’est d’ailleurs montré particulièrement offensif en organisant, le 7 avril, une manifestation pour la sécurité, après qu’Israël ait connu une vague d’attaques meurtrières : quatorze israéliens tués en trois semaines.
De nouvelles élections paraissent bien trop risquées pour la coalition gouvernementale, qui va devoir rapidement trouver de nouveaux alliés au sein de la Knesset. Les derniers sondages donnent des tendances relativement similaires aux résultats de mars 2021, mais le risque est fort de voir cette fois un rassemblement de la droite, des religieux et de l’extrême droite, aux côtés du Likoud, reformant l’historique bloc qui avait permis à Netanyahu d’assoir son hégémonie sur le pays pendant douze ans.
Surtout, le jeu politique israélien amène souvent les membres de l’opposition à une forme de marginalisation. Un ministre tel qu’Horowitz sait qu’il partage peu avec la majorité du gouvernement, mais son poste lui permet d’obtenir des victoires décisives pour une part de son électorat. Il s’est par exemple montré actif pour permettre aux couples homosexuels d’accéder à la Gestation pour autrui, disposition validée l’été dernier par la Cour suprême.
Au lendemain de la décision de Silman, les regards se sont portés vers l’opposition de gauche non sioniste, incarnée par la Liste unifiée d’Ayman Odeh. Si une partie de ses alliés, à l’instar d’Ahmad Tibi, n’est pas fermée à l’idée de travailler sur certains points avec la coalition gouvernementale, Odeh affirme refuser d’être une « bouée de sauvetage » pour Bennett, sans pour autant soutenir le vote d’une motion de censure aux côtés de l’opposition de droite si cela risquait de favoriser Netanyahu.
La ligne politique de la Liste unifiée semble, en théorie, en radicale opposition avec la majeure partie du champ politique israélien, en premier lieu du fait de leur attachement au sionisme. Là où Odeh défend une société d’égalité, des libéraux laïcs comme Lapid rejoignent un nationaliste-religieux comme Bennett sur le fait qu’Israël doit être et demeurer un pays contrôlé par et pour la population juive. Seules les modalités de ce contrôle diffèrent entre eux.
Les dernières rumeurs d’un ralliement des députés de la Liste unifiée s’interrompent brutalement le 10 avril. Ce jour-là, depuis la porte de Damas à Jérusalem, Odeh poste un message sur les réseaux sociaux. Face caméra, il appelle les Palestiniens de citoyenneté israélienne à ne pas s’engager dans les services de sécurité qu’il nomme les « forces d’occupation » : « Jetez-leur les armes au visage et dites-leur que notre place n’est pas avec vous. Nous ne prendrons pas part à l’injustice et au crime ».
Condamnation unanime de la classe politique. La ministre Shaked demande son expulsion de la Knesset, quand d’autres réclament son incarcération et saisissent le Procureur général pour ouvrir une enquête à son encontre. Au sein de la gauche sioniste, même son de cloche où Odeh est accusé d’avoir fermé la porte à son entrée au gouvernement, tandis que la (seule) députée palestinienne du Parti travailliste Ibtisam Mara’ana, lui a intimé l’ordre de « se taire ».
À l’image de la société israélienne : ne rien voir et ne rien entendre
Derrière cette vidéo, il y a les témoignages recueillis par plusieurs députés de la Liste unifiée, de jeunes palestiniens qui accusent des policiers arabes israéliens d’être particulièrement violents à leur encontre. Il y a aussi cette violence quotidienne, à Jérusalem-Est comme dans toute la Cisjordanie, qui a vu depuis le 1er janvier 2022, 42 Palestiniens être tués, dont huit enfants, et 524 autres être blessés. Face aux meurtrières attaques contre des Israéliens, le gouvernement a donné un blanc-seing à l’armée pour assouvir le désir de vengeance d’une part de leur société. Vingt-et-un Palestiniens ont ainsi été tués ces quatre dernières semaines qui correspondent au mois du Ramadan.
Pourtant, le champ politique israélien fait mine d’ignorer ces faits et de faire porter une part de la responsabilité des tensions actuelles à Odeh. Un déni similaire à celui qui accompagne la publication de rapports faisant état, à l’instar de la dernière publication du rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des droits de l’homme dans les Territoires palestiniens occupés, Michael Lynk, de l’existence d’un régime d’apartheid imposé par Israël aux Palestiniens. Jusqu’à ces derniers jours, des députés tels que Mara’ana ou Abbas servaient de « caution arabe » au gouvernement pour délégitimer, notamment, les accusations d’apartheid.
Le 22 avril, Mara’ana, la figure arabe du Parti travailliste, s’est fendue d’un tweet pour témoigner de sa gêne face aux images de l’esplanade des mosquées où des fidèles sont frappés et dispersés à coup de grenades lacrymogènes. Quelques jours auparavant, Abbas avait annoncé le « gel » de son soutien au gouvernement pour une durée de deux semaines afin, dit-il, de calmer la pression qui pèse sur les quatre députés de son parti. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses caricatures palestiniennes les montrent organisant la vente de l’esplanade des mosquées à des colons israéliens.
Entre la pression populaire et les impératifs politiques, les islamo-conservateurs semblent être parvenus à un compromis : s’ils ne participeront plus à des réunions de la coalition, ils assurent celle-ci de leur vote contre l’attribution de subventions conséquentes aux villes et villages palestiniens d’Israël, et des avancées majeures concernant les plans de logement en faveur de la minorité arabe. Jusqu’à quand Mansour Abbas et ses colistiers tiendront-ils sur cette ligne de crête ?
ÉchecIl aura fallu des centaines de blessés à Jérusalem pour que ces députés réagissent et brisent le consensus politique qui s’était établi contre Ayman Odeh. Surtout, par sa révolte, la jeunesse palestinienne a contraint ces dirigeants à regarder en face la réalité de l’occupation, sur laquelle la gauche et la droite sionistes pensaient pouvoir avoir le luxe de détourner le regard afin de former une coalition avec le soutien des Palestiniens d’Israël.