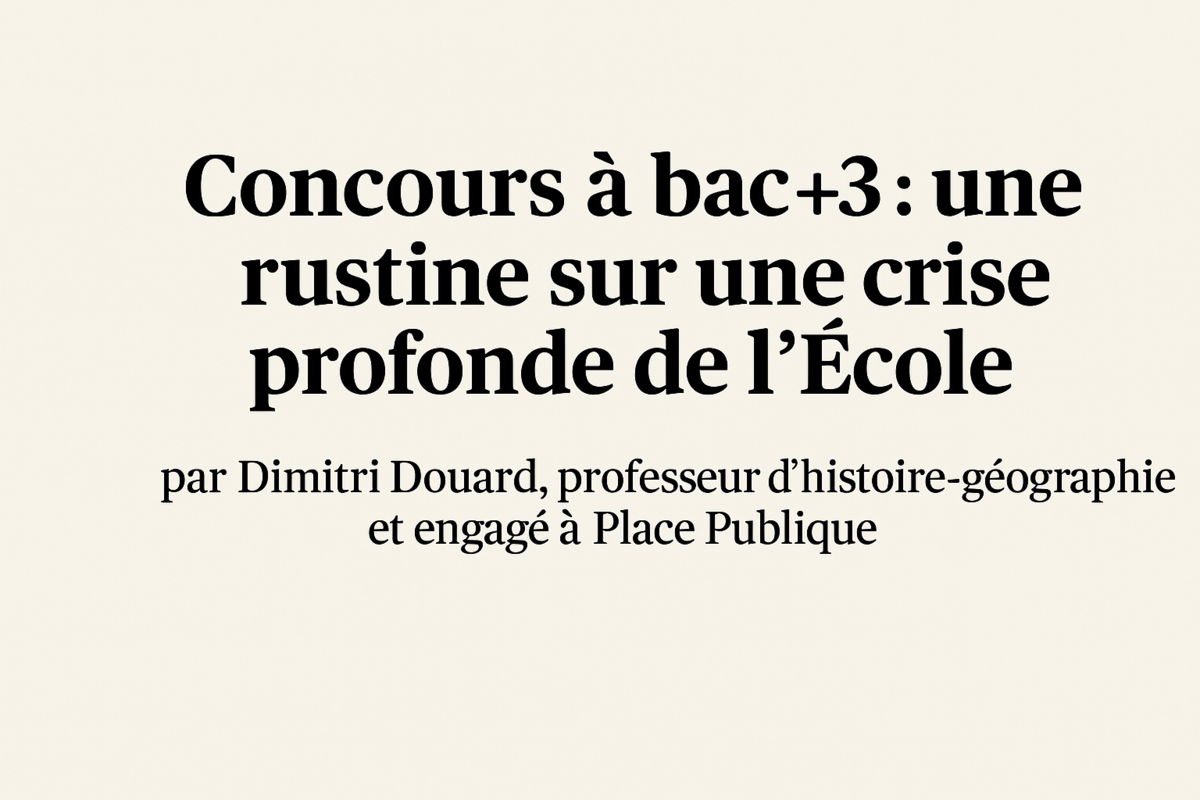
Agrandissement : Illustration 1

Sous couvert de relancer la formation des enseignants, François Bayrou et Élisabeth Borne signent en réalité une réforme qui contourne les vrais problèmes de l’École. En avançant le concours à bac+3, le gouvernement prétend restaurer l’attractivité du métier. Mais chacun sait aujourd’hui que le mal est ailleurs, profond, identifié, documenté. Et il exige bien plus qu’une opération technique sur le calendrier des concours.
Un malaise ancien et structurel
Depuis deux décennies, le pouvoir d’achat des enseignants français a chuté de plus de 20 % en euros constants. Les comparaisons internationales sont accablantes : à temps de travail égal, un enseignant français gagne moins qu’un collègue allemand, italien ou espagnol. La dévalorisation salariale est constante, y compris chez les jeunes professeurs, souvent contraints à cumuler ou à quitter le métier. La conséquence est simple : les candidats désertent. En primaire, les inscriptions aux concours ont baissé de 45 % depuis 2021, dans le secondaire de 21 %. Et le choc de la réforme Blanquer (concours à bac+5) n’a rien arrangé.
Une réforme de surface
Ce gouvernement a donc choisi d’avancer le concours en fin de licence. Une solution qui revient à dire : « puisque le métier n’attire plus à bac+5, allons chercher les étudiants plus tôt. » Mais c’est un raccourci dangereux, un bricolage de crise. Car si l’on ne change ni les salaires, ni les conditions d’exercice, ni les effectifs par classe (la France est parmi les pires élèves de l’OCDE avec plus de 26 élèves par classe au collège et au lycée), on se contente de remplir un seau percé sans jamais colmater la fuite.
Les étudiants recevront 1 400 € nets en M1, puis 1 800 € en M2, tout en assurant un mi-temps en responsabilité. Présentée comme un geste fort, cette rémunération est surtout un levier d’attractivité à court terme, un appât pour attirer des jeunes en quête de sécurité professionnelle, dans un contexte d’inflation et de précarité étudiante croissante. Mais derrière cette mesure ponctuelle, rien n’est dit sur la suite de la carrière. Une fois titularisés, ces mêmes jeunes découvriront un métier où la rémunération stagne, les primes restent inéquitables, et les perspectives d’évolution sont minces. Ce contraste entre l’effort consenti au moment de la formation et l’absence d’une revalorisation salariale structurelle traduit bien le cœur du problème : on cherche à remplir les rangs sans s’attaquer à la crise de reconnaissance du métier.
Un manque d’ambition politique
La réforme se pare d’un vernis nostalgique : “écoles normales du XXIe siècle”, filières lisibles dès le bac, engagement de quatre ans envers l’État… Mais elle dissimule mal l’absence d’un projet éducatif digne de ce nom. Ce qu’il faudrait, tout le monde le sait : un plan pluriannuel de revalorisation salariale, une politique active de réduction des effectifs par classe, une refonte ambitieuse de la formation initiale ancrée dans la recherche pédagogique.
Or ce gouvernement, affaibli politiquement, contraint budgétairement, et limité par les arbitrages de Bercy, n’a ni la force, ni les moyens, ni le cap pour proposer une telle politique. On répond à une crise structurelle par une mesure conjoncturelle. On parle d’attractivité sans jamais parler de dignité.
L’École mérite mieux
Cette réforme ne changera pas la donne. Elle est un signal envoyé à court terme, dans un paysage éducatif qui continue de se déliter. C’est une rustine technocratique sur une fracture sociale.
Pourtant, l’École mérite mieux. Elle mérite un cap clair, de la stabilité, des moyens, et surtout de la considération. À ce titre, cette réforme, malgré ses effets d’annonce, n’est pas une réponse. Elle est une diversion.
⸻
Signature :
Dimitri Douard est professeur d’histoire-géographie et engagé à Place Publique. Il s’investit pour une école publique ambitieuse, plus juste, et mieux reconnue.



