Le Trouble Déficit de l’Attention avec Hyperactivité (TDAH) est censée être une condition naturelle, indépendante des contextes socio-historiques. Or, force est de constater qu’un appareil discursif se déploie massivement pour faire de cette condition neurodéveloppementale une réalité intangible, déstigmatisée voire désirable…ce qui pourtant n’a pas toujours été le cas dans la généalogie de ce trouble…
Désormais, la prescription de psychostimulant est censée optimiser les performances comportementales infantiles, et fournir des enfants malléables en dépit des conditions de vie dégradées qu’ils traversent. Comme le soulignait Julien Brygo dans "Le Monde Diplomatique", « grâce à sa potion magique, plus besoin de punitions ou de ruses pédagogiques pour mater les têtes brûlées ».

Agrandissement : Illustration 1

Belle promesse pour les éducateurs…Or, selon Christiane Rochefort, « les parents sont les pigeons de l’Entreprise. Leur énergie leur est volée. On se sert d’eux pour rendre les jeunes exploitables et contrôlables ».
Dès lors, histoire de rendre le produit marketing du diagnostic encore plus désirable, on va en faire un signe d’élection, en retournant le stigmate pour mieux faire avaler la pilule. Ainsi, « de nombreuses célébrités, du chanteur Justin Timberlake à l’actrice Emma Watson, en passant par le chef d’entreprise Richard Branson, le nageur Michael Phelps, feu le musicien Kurt Cobain ou encore… Leonard de Vinci, ont été diagnostiquées comme en étant atteintes » (Julien Brygo). Heureusement que le méthylphénidate n’existait pas à la Renaissance, sinon la Joconde n’aurait peut-être jamais été peinte…Mais Kurt Cobain sous traitement serait-il devenu un employé de bureau modèle, efficace et productif ? …Pour rendre le trouble encore plus sexy, on peut désormais, d'après certains sites internet, rajouter Johnny Dep - ce qui excuse sans doute ses violences conjugales ? -, Ryan Gosling, Will Smith, Tom Cruise....Britney Spears, Liv Tyler....Muhammad Ali, Mickaël Jordan...Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Walt Disney...Socrate, Abraham Lincoln, JF Kennedy....John Lennon, Stevie Wonder, WA Mozart - celui-là même qui, âgé de 14 ans, aurait accompli l’exploit de transcrire de mémoire l’intégralité du long chœur à 5 voix du Miserere d’Allegri après l’avoir entendu une seule fois à la chapelle Sixtine ; pas mal pour un supposé troublé de l'attention.......En tout cas, il y en a pour tous les goûts ! Et puis, Albert Einstein est également recruté, comme ce fut déjà le cas pour les Troubles du Spectre Autistique...Bientôt, il sera aussi bipolaire, ou borderline, entendeur de voix voire pervers narcissique...Décidément, c’est la relativité généralisée…De tout temps, ces personnalités atypiques auraient donc présenté un neurodéveloppement divergent en rapport avec un génome singulier, leur conférant un cerveau à part, qui leur aurait permis de développer leur génie créateur....Mais franchement, de quoi parle-t-on exactement ? Et pourquoi vouloir en faire une pathologie à foutre sous traitement ? Et pendant ce temps, est-ce qu'on fait encore attention aux schizophrènes à la rue ou en prison, aux enfants maltraités, aux adolescents suicidaires ?...

La conception exclusivement neurobiologique du TDAH tend indubitablement à effacer les dimensions sociales, culturelles, historiques qui viendraient relativiser cette étiologie voire la disqualifier totalement, en soulignant la dimension « construite » de ce trouble. Pour les promoteurs de la réalité « naturelle » et anhistorique d’un tel diagnostic, l’argument décisif est le consensus réputé « universel » des experts, et la disparition consécutive de toute équivoque… De telles déclarations performatives constituent des formes de « pensée magique » ou de « prophétie auto-réalisatrice », qu’il serait désormais impossible de critiquer ou de relativiser.
Or, comme le souligne Christiane Rochefort, « les dominants donnent toujours leurs valeurs comme éternelles ». Celles-ci ne doivent pas appartenir à l’Histoire, mais à l’Éternité. Et la vraie question est alors de savoir « entre les mains de qui est la Science, entre les mains de qui est l’industrie, entre les mains de qui est le pouvoir » …
« Ils ont la science. La science est l’arme n°1 contre le hasard. L’organisation précoce de l’exploitation se fait aujourd’hui scientifiquement. C’est-à-dire en utilisant des chiffres. La science psycho-technique chiffre la valeur du petit, sur le marché du travail. Son avenir n’est pas orienté par ses désirs ».
L’argument en faveur de la « réalité naturelle » du TDAH serait donc son caractère transhistorique ; ce trouble existerait déjà depuis le XVIIIème siècle, et serait donc indépendant des facteurs socio-culturels et des préjugés contemporains. Or, ce qui émerge à cette époque dans le monde occidental correspond déjà à aux ébauches d'organisation libérale-capitaliste de la société, avec des structures institutionnelles et idéologiques dont nous sommes encore imprégnées. Les troubles attentionnels ont-ils la même prégnance chez les populations de chasseurs-cueilleurs, ou dans des organisations sociales non exclusivement orientées par le profit et le rendement ? Y aurait-il une corrélation entre un certain usage de l’attention et des significations imaginaires sociales spécifiques ?
En reprenant la construction historique du concept d’hyperactivité infantile, on se rend compte que chaque époque projette sur le comportement perturbateur des enfants ses propres présupposés normatifs, en les faisant passer pour une observation neutre et scientifique. Nonobstant, l'enfance est une surface de révélation des préoccupations dominantes de telle ou telle époque, et les troubles infantiles révèlent surtout les doctrines médico-pédagogiques hégémoniques très imprégnées d'impératifs politiques à l'aune desquelles on catégorise la déviance.
Dès 1775, le médecin et philosophe allemand Melchior Adam Weikard, adepte du rationalisme radical et d’une psychologie matérialiste, fait une description médicale d’états d’inattention qu’il impute à une organicité « nerveuse » sous-jacente. Dans son ouvrage « Der Philosophische Arzt », il relève cette sémiologie : « Tous les bourdonnements de mouches, toutes les ombres, tous les bruits et même le souvenir de vieilles histoires suffisent à l’extraire de sa tâche vers d’autres imaginations. Si d’une part, il n’étudie que superficiellement ses matières, son jugement est, d’autre part, totalement erroné ».
En 1798, Sir Alexander Crichton, médecin écossais, aurait décrit pour la première fois une condition médicale d’agitation mentale évoquant un trouble attentionnel avec hyperactivité. Dans son ouvrage « Une enquête sur la nature et l’origine du dérangement mental : compréhension d’un système concis de la physiologie et pathologie de l’esprit humain et l’histoire des passions et de leurs effets », il rapporte que « l’incapacité de maintenir un degré d’attention constant sur tout objet, résulte presque toujours d’une sensibilité anormale ou pathologique des nerfs, avec pour conséquence que la faculté d’attention est constamment tiraillée d’une perception à une autre ». Avec les débuts de l’industrialisation, il faut garantir que les prolétaires puissent accomplir des tâches répétitives, en maintenant la cadence sans se laisser distraire….
A travers ce regard médical, les déviances comportementales ne sont plus imputables à la misère, à la prolétarisation des conditions de vie, au délitement des structures familiales et communautaires, mais à des dysfonctionnements nerveux.
Au début du XIXème, la littérature dresse également le portrait d’enfants distractibles. En France, Pierre Blanchard publie en 1817 "Les Jeunes Enfants", un recueil de contes dont l’un se nomme « Touche-à-tout » ; il s’agit de l’histoire d’un gamin curieux mais écervelé, passant sans cesse d’une activité à l’autre, sans crainte d’être corrigé. « On ne pouvait rien mettre à l’abri de sa main ». Évidemment, il ne prête aucune attention aux avertissements de ses parents ; il est réfractaire et opposant. Si seulement le méthylphénidate avait existé à l’époque, le sale gosse aurait été immobilisé… A partir de 1844, le médecin prusse Heinrich Hoffmann, précurseur de la psychiatrie infantile, également poète, librettiste, et auteur pour enfants, publie plusieurs récits mettant en scène des enfants agités, instables, espiègles, aventureux, atypiques, qui seraient à l’évidence diagnostiqués TDAH de nos jours…En 1847, le « Struwwelpeter oder Lustigen Geschichten » propose des illustrations colorées d’un gamin turbulent, impulsif, réfractaire, et des conséquences de son attitude sur les relations familiales – sur un mode punitif et coercitif…
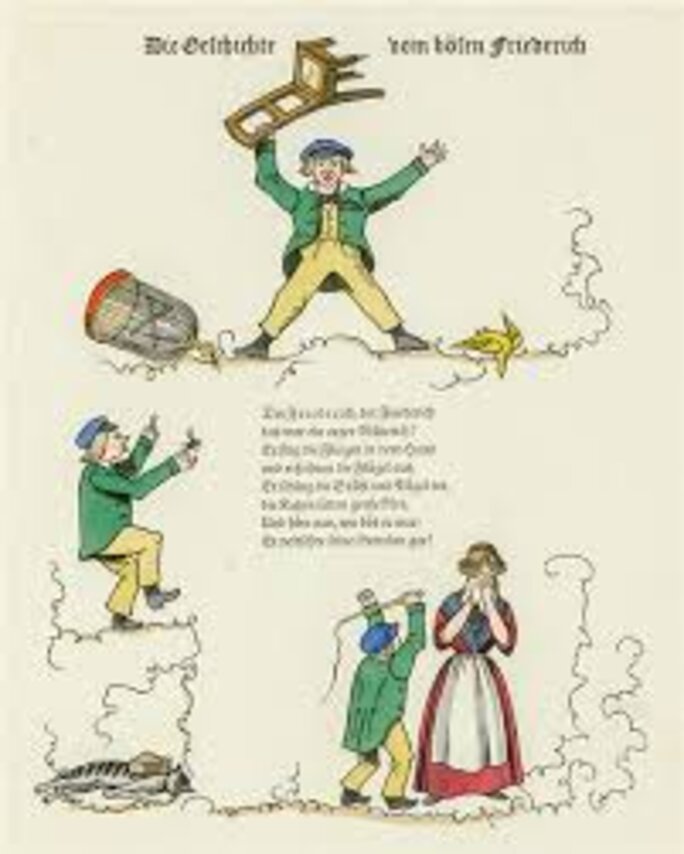
A cette époque, la délinquance juvénile et l’arriération infantile des dégénérés, avec le spectre des perversions et des insurrections, sont les deux préoccupations essentielles des pouvoirs publics concernant l’enfance. De fait, il ne faut pas produire de futurs agitateurs, contestataires, révolutionnaires, mais fournir une main d’œuvre servile et obéissante.
Les descriptions cliniques sont alors imprégnées de préjugés moraux, très en phase avec l’affirmation idéologique de la bourgeoisie, et de ses valeurs. Il faut donc repérer les enfants anormaux, déviants, agir précocement pour les redresser, et les adapter aux cadres sociaux hégémoniques.
En 1885, l’aliéniste Désiré-Magloire Bourneville introduit le concept d’« instabilité mentale », dans un rapport annuel de son service à l’Hôpital Bicêtre, provenant de l’observation d’enfants et d’adolescents placés dans des structures asilaires et des institutions médico-pédagogiques.
Dans une publication publiée en 1889, il relate l’observation d’un adolescent de 14 ans, admis à Bicêtre en 1881, présentant une « instabilité mentale », associée à des troubles des conduites sexuelles. Bourneville évoque au passage des déficits attentionnels : « on ne peut lui confier aucun paquet, il l’oublie, ou le laisse sur un banc, ou sur l’omnibus ». Or, il est tout de même intéressant de souligner que ce jeune a été abusé sexuellement par un infirmier de Bicêtre. Cette observation clinique pointe finalement les enjeux de l’impact des abus traumatiques sur les aspects comportementaux et cognitifs…
Un élève de Bourneville, Charles Boulanger, publie sa thèse en 1892, intitulée "Contribution à l’étude de l’instabilité mentale, avec la description de quatre situations cliniques". Ces enfants « sont intelligents, mais leur incohérence répétée, leurs excentricités continuelles ont bientôt attiré l’attention sur eux. Il semble qu’une force inconnue les pousse périodiquement à des écarts de conduite dont ils ne peuvent donner raison lorsqu’on les interroge ». Leur comportement est « turbulent » et « indiscipliné », « les facultés morales sont atteintes ». Les difficultés très importantes à intégrer les règles sociales sont appréhendées en tant que « perversion des instincts ».
Un des cas cliniques concernant un garçon de 12 ans insiste sur le rôle de la consommation d’alcool du père, qui « a causé tout le mal ». Une autre observation concerne le développement d’un adolescent hospitalisé à Bicêtre en 1881, entre ses 12 et ses 20 ans. Le compte-rendu clinique insiste sur le poids « héréditaire » des parents qui ont eu « une influence délabrante sur l’organisme des héritiers ».
En arrière-plan, l’influence de la théorie de la dégénérescence reste manifestement très prégnante. Il faut alors repérer les ferments de perversité infantile, afin de confiner précocement ces germes contaminants. « Le dégénéré contrarie la société et pèse sur elle ; il convient donc d’exercer une prophylaxie » (Bénédict Augustin Morel).

Dans "Le traitement médico-pédagogique des différentes formes d’idiotie" (1897), Bourneville revient sur la définition de l’instabilité mentale : « elle est parfois simple, constituant alors une variété distincte, mais est le plus souvent liée à l’imbécillité, à l’arriération intellectuelle, désignée encore sous le nom de débilité mentale ». Son observation clinique, au-delà des aspects descriptifs, reste à nouveau très imprégnée de représentations moralistes socio-historiquement déterminées : « leur mobilité est exubérante, ils ne restent en place nulle part, se lèvent de table à chaque instant sans motif. S’ils jouent, ils passent rapidement d’un jeu à l’autre. Dans le service, ils se font remarquer par l’indifférence aux observations, la désobéissance et l’indiscipline, mais ils sont suggestibles et peuvent se soumettre aux personnes qu’ils aiment ». En arrière-plan, se déploient ainsi toutes les représentations et appréhensions concernant l’opposition infantile, la transgression des normes, le refus de se « soumettre » aux attendus sociaux.
C’est dans ce contexte que la « psychologie scientifique » commence à s’intéresser à l’attention, non sans rapport avec les exigences de productivité, de rendement et de contrôle des populations – avec en arrière-plan la généralisation de la scolarisation.
Selon Théodule Ribot ("Psychologie de l’attention", 1889), « l’attention dépend de la restriction du mouvement ». « Une foule d’exemples démontrent que, entre une grande dépense de mouvements et l’état d’attention, il y antagonisme ». Il faut donc viser à « immobiliser » l’enfant, ou en tout cas à contraindre sa motricité : il doit prioritairement rester en place.
En 1897, le philosophe et psychologue James Mark Baldwin note que l’on reconnaît l’enfant « incapable de coordination attentive » « aux premiers signes d'agitation, ou simplement à une cessation brusque d'intérêt, d'ailleurs sans motif apparent. » Il précise également que, pour ce type de profil infantile, « toute expérience commencée dans ces conditions doit être abandonnée aussitôt. L'enfant est souvent indisposé, irritable, rêveur. Il faut avoir grand soin de s'en rendre compte avant de ne rien entreprendre ». Insupportables ces rêvasseries, ces tendances à papillonner, ce manque d’entrain et de collaboration...
En 1898 le psychiatre allemand Kraeplin décrit les « psychopathes instables », insistant sur leurs troubles de l’humeur, leur imagination débordante, l’insuffisance de leur jugement, et surtout sur leur absence générale de ligne de conduite, responsable de distractions et de fatigabilité. Ils ne savent pas se tenir ! Le rendement va baisser…
En 1901, le médecin belge Jean Demoor circonscrit une entité clinique spécifique, qu’il dénomme « chorée mentale ». L’enfant atteint de ce syndrome « a des sens normaux, toutes ses capacités intellectuelles sont intactes ; mais sa concentration est si inconstante qu’elle vagabonde et change d’objet. L’enfant bouge sans arrêt, regarde, écoute et pose des questions. Ses mouvements et ses paroles ont quelque chose d’abrupte et de très étrange. Il est souvent indiscipliné et incapable d’apprendre en raison de sa mobilité inouïe. Il est étrange de tous les points de vue, et il est souvent considéré comme simple d’esprit ou même comme un idiot de deuxième degré. Alors qu’en réalité il n’est pas si mal placé dans la vie. ». Comme on peut le percevoir, le « trouble » est à nouveau suscité par le caractère insaisissable de l’enfant, par sa tendance à « échapper », à être ailleurs, curieux, hors-norme. Il désarçonne.
En 1902, Sir George Frederic Still, père de la pédiatrie britannique, présente une série de conférence au Collège Royal de Médecine à Londres, les « Goulstonian Lectures ». A cette occasion, il revient sur certaines conditions psychiques anormales chez les enfants, concernant notamment une « déficience dans le contrôle moral ». Il décrit effectivement 43 enfants présentant des troubles du comportements, à type de conduites agressives, de provocation, de résistance à la discipline. Ces enfants sont très émotifs, font preuve de peu d’inhibition, et manifestent des difficultés d’apprentissage, malgré une intelligence normale. Ils sont réfractaires et ne rentrent pas dans le cadre scolaire.
Décrivant les « conditions psychiques anormales » chez l’enfant, Still décrit finalement la « perte de contrôle moral » en rapport avec des atteintes neurologiques ou à ce qu’il postule comme des lésions cérébrales mineures (minimal brain damage).
En 1905, deux élèves de Bourneville, Georges Paul-Boncour et Jean Philippe, publient « Les Anomalies mentales chez les écoliers ». Ils décrivent de manière plus approfondie « l’instabilité mentale », avec à la fois le défaut d’inhibition comportementale, mais aussi la persistance de ce qui apparait à nouveau comme des « troubles moraux ». Ces enfants s’avèrent « insupportables » en classe, du fait notamment de leur impulsivité. « Ils parlent à haute voix et réalisent toutes les idées qui leur passent par la tête sans se préoccuper d’aucune surveillance ; ils répondent insolemment et lâchent des mots injurieux à la moindre observation, parfois même sans raison » (p. 48). Ils donnent l’impression d’être à l’école « pour tout autre chose que pour écouter ». Des cancres et des perturbateurs, qui n’ont pas stabilisé leur identité d’élève apprenant. Des cerveaux indociles.
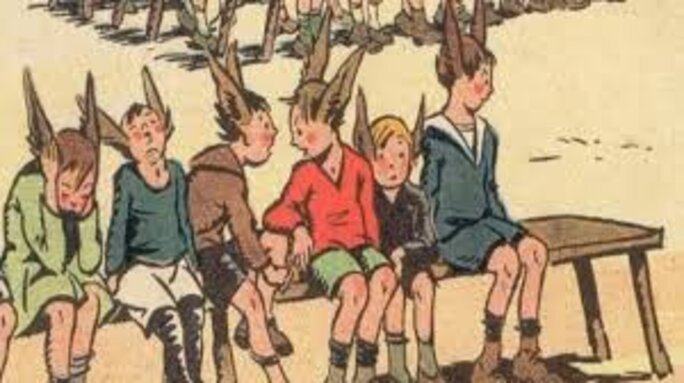
Par exemple, un écolier âgé de 8 ans « habituellement convenable, présente, à dates fixes, des périodes d’abattement : il est alors distrait et inattentif. […] La mère observe qu’il a passé également des nuits mauvaises, qu’il s’agite et dort mal. ». Faut-il d’emblée y voir une altération mentale, ou prendre en considération des enjeux psycho-affectifs ? Un autre adolescent de 14 ans est arrêté pour vagabondage : « en général, il aime le mouvement, est toujours à tracasser, arrangeant un meuble, dérangeant, etc. […] Peu de mémoire : il lui arrive souvent d’oublier les choses qu’on lui a dites et parfois celles qu’il a faites depuis peu. ».
A nouveau, l’instabilité est associée à la délinquance juvénile, au refus de l’ordre. Manifestement, il est préférable de désigner une déficience, une tare constitutionnelle, plutôt que de pouvoir considérer une forme de refus volontaire, voire une intentionnalité transgressive délibérée ou réactionnelle, du côté de l’enfant….
Car ce type de profil irrite ; et on perçoit bien les contre-attitudes des experts de l’époque, infiltrés de réprobations indignées, de jugements moraux, et de préjugés de classe.
Le grand pédagogue et psychologue Alfred Binet n’est pas en reste…En 1905, il affirme, dans son ouvrage « Les enfants anormaux. Guide pour l’admission dans les classes de perfectionnement » que « l’instable est pour l’École une gêne perpétuelle ; le maître juge sans bienveillance ce mauvais élève qui trouble constamment l’ordre dans la classe et compromet son autorité. ». Ces enfants pénibles et indociles « ont le caractère irritable, le corps toujours en mouvement, ils sont réfractaires à la discipline ordinaire […] Ils sont turbulents, bavards, incapables d’attention […] ils témoignent de méchanceté vis-à-vis de leurs camarades et d’indiscipline vis-à-vis du maître […] Le principal ressort de l’instable, c’est la gamme des penchants égoïstes […] » (Binet et Simon, 1907, pp. 8 et 33)
Indéniablement, la prétention scientifique à la neutralité et à l’objectivité semble singulièrement se fissurer face à ces enfants « méchants » qui viennent mettre à mal le cadre normatif de l’institution scolaire et, au-delà de l’expertise clinique, révéler davantage les condamnations morales des spécialistes véhiculant tout le poids de leur condescendance bourgeoise, de leur mépris de classe, et de l’invisibilisation des conditions réelles de vie – dans quelle mesure la « prolétarisation » du quotidien, les carences et autres maltraitances sont-elles impliquées, outre les déficiences cérébrales ? ….
En tout cas, en ce début de XXème, la distractibilité des enfants, et leur opposition, deviennent une préoccupation récurrente, que ce soit en termes de discipline à l’école, mais aussi d’évaluation, de tri, et d’orientation. Lors du 3ème congrès international d’hygiène scolaire, qui se tient à Paris en 1910, Miguel Martinez suggère que l’inattention de l’enfant puisse « produire de fréquents mouvements », altérant en retour les apprentissages à travers un véritable cercle vicieux. Une telle "aprosexie" (perte de la faculté volontaire d’attention) est alors appréhendée comme le symptôme d’un trouble psychique ou organique sous-jacent.
En 1913, dans l’ouvrage "Débilité et déséquilibration motrices", Ernest Dupré approfondit le concept d’instabilité psychomotrice, avec la conception d’un « déséquilibre moteur congénital ». Outre les aspects moteurs, il observe chez des enfants anormaux « de l’incapacité d’attention, de l’étourderie, une grande labilité de l’humeur, des troubles du caractère, des caprices, des crises de colère, etc. ». Des salles gosses quoi…Comment redresser la Nation avec de tels dégénérés, instables et inéducables, à la constitution viciée ?... Dupré relève également l’association entre « agitation motrice continue » et « incapacité attentionnelle ». L’instabilité est alors appréhendée comme constitutionnelle, traduisant un déséquilibre à la fois mental et moteur.

Agrandissement : Illustration 6

Comme on peut le voir, l'émergence du concept de trouble attentionnel infantile est manifestement repris dans les préoccupations, les préjugés et les idéologies dominantes d'une époque. Cependant, au-delà des revendications de scientificité, un recul historique permet de mieux saisir les mouvements contre-transférentiels, les postures classistes, la façon dont les conditions concrètes d'existence, la fréquence des abus et des maltraitances sociales, sont systématiquement évacués en faveur d'un dogme constitutionnaliste, très imprégné des théories de la dégénérescence...Par ailleurs, il est important de souligner qu'à travers la généalogie de ce trouble, il s'agissait alors de décrire des enfants institutionnalisés à l'asile, souffrant de très graves troubles du développement, avec des facteurs neurologiques manifestes et des profils de carences multiples et profondes...Ce qui n'a plus rien à voir avec la généralisation massive des diagnostics de TDAH à l'heure actuelle. On ne parle pas vraiment de la même chose, et les entités cliniques sont absolument incommensurables ; faut-il en être dupe ?
Néanmoins, le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité est-il finalement devenu consensuel, ou est-il resté semé de controverses ?
A suivre...



