On a vu précédemment à quel point l’institution patriarcale vient « mutiler » les aspirations désirantes, normer les devenirs et contraindre les subjectivations. Dès lors, une interrogation s’impose : comment ce système impose-t-il son hégémonie ? Quels sont les ressorts d’un tel canevas de domination ?
Le patriarcat, une maladie sociale
D’après bell hooks, « le patriarcat est la maladie sociale la plus meurtrière qui s'attaque aux mâles de notre société, dans leur corps et dans leur esprit ». De fait, il s’agit d’une « facette majeure du système politique qui façonne l'identité et la subjectivité des mâles », en insistant sur le fait que les hommes sont intrinsèquement appréhendés en tant que dominants, immunisés face à la vulnérabilité, dotés du droit d’opprimer, de gouverner, de consommer les faibles à travers diverses formes de terrorisme psychologique et de violence.
Ainsi, les rôles de genre patriarcaux sont assignés dès l’enfance, et s’apprennent par l’expérience, voire par la violence mobilisée pour renforcer l’endoctrinement ; les filles apprennent qu’elles doivent servir, rester faible, être exemptée d’avoir à penser, devant prioritairement s’occuper du soin et de l’éducation des autres ; les garçons intériorisent que c’est leur « rôle », « d’être servi, de pourvoir, d'être fort, de penser, d'élaborer des stratégies et de planifier, et de refuser de prendre soin » ou d’exprimer des sentiments, et que leur valeur dépendait de leur capacité à faire preuve de violence dans des contextes appropriés. Selon bell hooks, il s’agit là d’une « traumatisation normale », notamment des garçons, à travers la négation de leurs sentiments et la revendication d'une capacité à tolérer la douleur sans l’exprimer.
Dès lors, les comportements de chacun doivent suivre « un script genré, prédéterminé », conforme aux identités normatives du patriarcat, et sécrétant une culture tyrannique, maintenant les sujets captifs de ses normes. Or, nous sommes tous socialisés dans ce système, ayant intériorisé une forme de servitude aveugle et étouffé certaines possibilités d’échappement. D’ailleurs, « la plupart d'entre nous ont appris les attitudes patriarcales dans notre famille d'origine, ce sont généralement nos mères qui nous les ont enseignées ». De fait, « de nombreux ménages dirigés par une femme adoptent et encouragent une pensée patriarcale avec une passion bien plus grande que les ménages biparentaux. Parce qu'elles ne font pas l'expérience d'une réalité permettant de nuancer les fantasmes concernant les rôles genrés, les femmes de ces ménages sont beaucoup plus susceptibles d’idéaliser le rôle patriarcal masculin et les hommes patriarcaux que les femmes qui vivent quotidiennement avec des hommes patriarcaux ». Ainsi, « nous devons souligner le rôle que jouent les femmes dans la perpétuation et le maintien de la culture patriarcale afin de reconnaître le patriarcat comme un système que les femmes et les hommes soutiennent à parts égales, même si les hommes en tirent plus de privilèges ».
En conséquence, il s’agit là d’une problématique systémique, et non pas individuelle ou « communautaire », ce qui rend absolument vain la misandrie et le combat contre les hommes : « en dépit de la pensée féministe contemporaine éclairée qui montre clairement qu'on n'a pas besoin d'être un homme pour penser de façon patriarcale, la plupart des gens continuent à considérer les hommes comme le problème du patriarcat. Ce n'est tout simplement pas le cas. Les femmes peuvent être aussi attachées que les hommes à la pensée et à l'action patriarcales ». Pour bell hooks, « en imputant la perpétuation du sexisme aux hommes uniquement », certaines femmes maintiennent finalement « leur propre allégeance au patriarcat, leur propre soif de pouvoir ». « Elles ont masqué leur aspiration à être elles-mêmes dominantes en se donnant le rôle de victime ».
Là se déploie une « idéologie séparatiste [qui] encourage les femmes à ignorer l'effet négatif du sexisme sur les hommes », une « rhétorique qui imputerait la perpétration du patriarcat et de la domination masculine aux hommes seulement ».
Or, en dépit des privilèges masculins évidents et de la coercition prédominante des femmes en régime patriarcal, « nous sommes tou·te·s blessé·e·s par une conception rigide des rôles attribués aux sexes ». Le « lavage de cerveau que l'idéologie patriarcale inflige aux hommes » tend à négliger les restrictions drastiques, les mutilations émotionnelles que ceux-ci doivent accepter, de gré ou de force, en leur faisant croire que la domination en vaut la peine… « Tant que les hommes seront endoctrinés à assimiler la domination violente et l'abus des femmes comme un privilège, ils ne comprendront pas les dommages causés à eux-mêmes ni aux autres, et n'auront aucune motivation à changer ». Nous reviendrons plus longuement sur le complexe identitaire masculin en régime patriarcal dans un billet ultérieur.

Agrandissement : Illustration 1

Cependant, on peut déjà affirmer que déconstruire un tel système suppose préalablement de s’extraire d’une forme de déni collectif, de reconnaitre sa participation, sans chercher à désigner les responsables en attisant la haine et le rejet. Ce qui implique aussi de nommer et de dénoncer toutes les violences sexistes qui entretiennent le système, et de lutter à la fois contre l’invisibilisation et l’impunité. « Démanteler et changer la culture patriarcale est un travail que les femmes et les hommes doivent faire ensemble ».
Mais si le système patriarcal suscite autant de souffrance, comment expliquer son hégémonie ? Les enjeux politiques de domination et de privilèges suffisent-ils à expliquer la prégnance des normes du patriarcat ? Si non, faut-il y chercher des motivations psychologiques plus profondes, des bénéfices secondaires partagées entretenant la perpétuation de ce carcan, en dépit des terribles sacrifices qu’il impose ?
Une pédagogie de la cruauté
Dans « la guerre aux femmes », Rita Laura Segato souligne que la question du genre, appréhendée dans sa dimension familialiste et patriarcale, « est la pierre angulaire et le centre de gravité de la structure de l'ensemble des pouvoirs ». En effet, en tant qu’institution de l’inégalité des rapports sociaux entre les sexes, le patriarcat serait la structure politique la plus archaïque et constante de l'humanité. Cette matrice anthropologique contribuerait à ajuster « les rapports entre toutes sortes de position différenciées de prestige et de pouvoir ».
De fait, ce ciment de la domination tend à se réactualiser de manière structurelle et continue, du fait de sa profondeur historique. Mais pour expliquer cette forme fondatrice et récurrente du pouvoir patriarcal, il faut pouvoir en faire « l’ethnographie », et notamment comprendre la pédagogie spécifique qui entretient, alimente, impose sans cesse cette structure de domination. Pour l’anthropologue argentino-brésilienne, le « mandat de la masculinité », c’est-à-dire la façon concrète dont elle s’exprime et s’exerce, constitue justement « la première des pédagogies permanentes d'expropriation de la valeur » : une véritable matrice de la domination, qui vient mettre en scène et incarner une forme de pouvoir à travers la légitimation de sa violence. Dès lors, les violences sexuelles n’auraient pas une finalité purement pulsionnelle, mais relèveraient aussi de l’ordre de la domination mise en pratique, servant à la fois de preuve et de pédagogie : « la libido se dirige, ici, directement vers le pouvoir ». De fait, l’épreuve de la masculinité, ce qui cautionne l’appartenance au groupe des dominants, est bien « l'extorsion d'un tribut aux femmes », en tant que rappel d’une structure hiérarchique : « à travers ce type de violence, le pouvoir s'exprime, s'exhibe et se consolide de manière cruelle ».
Michelle Perrot rappelle ainsi qu’au Moyen Âge « les garçons réalisent très tôt leur virilité par le viol, et particulièrement le viol collectif, qui fait partie des exploits de la bande ». « Conquérir la fille, le château, la ville, c’est un rite de virilité. C’est une guerre ».
Cette violence manifeste ainsi une fonction démonstrative, expressive, performative. A travers elle, les hommes sont incités à affirmer leur docilité « vis-à-vis du mandat de masculinité et donc vulnérables face à l'exemplarité d'une masculinité victorieuse ». Une telle affirmation de l’identité de genre suppose la reconduction d’un pouvoir et une expropriation violente sur des corps subalternes. Là se déploierait donc « le ciment patriarcal qui fonde toutes les inégalités », avec une cristallisation des structures de domination permettant sa réitération. De fait, ce mandat de la masculinité, via l’appropriation performative de l’existence et du corps des « autres », devient une forme de pédagogie ; « la répétition de scènes violentes produit un effet de normalisation » et « elle promeut ainsi de faibles seuils d'empathie au sein de la population indispensable à l'entreprise prédatrice ». En conséquence, « si le pacte et le mandat de la masculinité ne légitiment rien, ils protègent et dissimulent finalement toutes les autres formes de domination et d'abus, qui y sont cultivées et qui en découlent ».
Cette cruauté « pédagogique » se préciserait ainsi comme message et fonction en s’exprimant sur le corps des femmes - ou des enfants - : « en tant que victime sacrificielles, leurs corps scellent un pacte de complicité avec le pouvoir et mettent en spectacle le caractère arbitraire de ce pouvoir exhibitionniste ». Cette « exécution cruelle et sacrificielle, non utilitaire, mais expressive de la souveraineté » constituerait ainsi l’ « acte par lequel le pouvoir exhibe son autorité discrétionnaire et juridictionnelle ». A travers cette domination agie du patriarcat se manifestent donc « les différents formes actuelles du pouvoir, l'arbitraire sur la vie exercée par les propriétaires, ainsi que la permanente conquêtualité violatrice et expropriatrice ». La « pédagogie de la cruauté » réaffirme sans cesse une structure binaire, hiérarchique, oppressive et intrinsèquement violente. Et ce sont donc des identités essentialisées et normatives qui se reconfigurent, des gradients d’humanité, à travers des mises en acte performatives. Toutes les déviations, les écarts, les anomalies, se trouvent finalement réduits, ordonnés et classifiés « en termes d'identités politiques iconisées ». « Une fois conformes, elles peuvent alors être réintroduites dans la sphère publique en tant que sujets possibles ». Certaines structures psychiques et modes de subjectivation se voient alors renforcés, en tant que vecteurs de la reproduction de l’ordre hégémonique. Car, en définitive, cette pédagogie patriarcale de la cruauté « impose, à la personnalité modèle de notre temps, une structure psychopathique caractérisée par une pulsion instrumentale et non relationnelle ».

Agrandissement : Illustration 2

Dans la même veine, l’ouvrage collectif « La culture de l’inceste » invite à « penser la violence sexuelle en termes culturels et non individuels, non pas comme un exception pathologique, mais comme une pratique inscrite dans la norme qui la rend possible en la tolérant, voire en l’encourageant ».
Ainsi, selon Juliet Drouar, l’inceste est un « acte de domination structurel, et donc également structurant de notre société ». En effet, « il faut des relations et des actes de domination pour reproduire/constituer performativement ces positions de domination » et affirmer un narratif social qui « légitime l’accès au corps de l’autre, l’effraction de son intimité et la rupture d’une lecture emphatique de ses émotions ». Ce dispositif idéologique a besoin de s’incarner, de se mettre en acte, de réitérer l’expérience du « pouvoir sur » afin d’entretenir des identités constituées par des liens de domination. Ainsi, pour maintenir la position des dominants, les interactions concrètes de domination doivent se répéter, à la fois dans la sphère collective mais aussi dans les lieux de l’intimité et de l’attachement affectif. De la sorte, le fonctionnement social par la domination se reconduit par son expression et son intériorisation…
Un mécanisme de défense collectif …
Néanmoins, une telle pédagogie patriarcale de la domination est-elle suffisante pour perpétuer l’ordre patriarcal ? N’y-a-t-il pas en jeu d’autres motifs psychiques, plus inconscients, susceptibles de maintenir ce système ?
C’est la thèse que déploient Carol Gilligan et Naomi Snider dans « Pourquoi le patriarcat ? » : le système patriarcal aurait une fonction collective de défense psychique, notamment par rapport aux enjeux de la perte d’attachement. Ainsi, nous serions prêts à accepter une « culture fondée sur la binarité et la hiérarchie des genres », un système de règles et de valeurs, de codes et de lois qui « impose une scission entre l’individu et le collectif », qui aliène les identités, en faveur d’un pacte garantissant une certaine sécurisation.
En effet, les déterminismes socio-politiques, le profit concret que tirent certaines personnes des arrangements institutionnels et économiques attachés au système patriarcal, les faits bien réels rattachés aux privilèges et au pouvoir, ne semblent pas pouvoir expliquer à eux seuls la persistance d’un système collectivement néfaste. D’autres forces plus invisibles semblent opérer de manière souterraine, pour entretenir les structures de domination. Par ailleurs, expliquer la persistance du patriarcat uniquement par son caractère « rétributif » pour les dominants revient à adopter implicitement une hiérarchie de valeurs résolument patriarcale, avec un raisonnement tautologique.
Dès lors, il faut sans doute concevoir d’autres ressorts psychologiques très profonds pour maintenir ce système immémorial, « intrinsèquement nuisible, parce qu’il oblige les hommes à agir comme s’ils n’avaient pas – ou n’avaient pas même besoin- de rapport avec autrui, et les femmes à se comporter comme si on leur niait l’existence ou la nécessité d’avoir une identité propre ». Ainsi, le patriarcat peut mettre chacun en tension, car « nous sommes en mesure non seulement d’intérioriser, mais aussi de concrétiser inconsciemment, un système auquel nous nous opposons par ailleurs activement et consciemment ».
Mais pourquoi nous soumettons-nous malgré tout, pourquoi sommes-nous prêts à faire tant de sacrifice ? Selon Gilligan et Snider, le patriarcat s’érigerait en « rempart contre la vulnérabilité associée au fait d’aimer », en « bouclier contre la perte ». Dès lors, « neutraliser le patriarcat, déconstruire la culture patriarcale, constitue aussi une menace contre certains moyens de défense psychologique ».
En effet, les normes hiérarchisées de genre et les codes régissant la masculinité et la féminité selon le modèle patriarcal correspondraient à ce que le psychiatre psychanalyste John Bowlby identifie comme des réponses pathologiques à la perte relationnelle.
Face au ressenti de vulnérabilité en rapport avec la privation d’un contact affectif, les individus suivent une certaine trajectoire : en premier lieu, il y a une phase de protestation, d’insurrection, de colère. Puis, il est constaté un mouvement de délitement de l’espoir. Enfin, le stade ultime est celui d’un détachement résigné.
Selon Gilligan et Snider, face aux menaces relatives à l’éventualité d’être privé de liens affectifs, de reconnaissance ou d’amour, le patriarcat proposerait d’en arriver à une forme de détachement émotionnel protecteur, en sacrifiant non seulement le désir de pouvoir partager des relations authentiques et profondes, mais aussi une forme de connexion avec sa propre vie affective. En substance, le pacte patriarcal, à travers ses rituels de passage en territoire de masculinité et de féminité, procure une pseudo sécurité, en favorisant l’émergence d’un faux self et d’une identité conformiste et préétablie. Au fond, il s’agit d’un véritable sabotage des capacités à créer et recréer des liens « véritables », tant avec les autres qu’avec soi-même.
« Sans possibilité de réparation, c’est l’amour – une force de nature assez puissante pour déraciner la patriarcat – qui se retrouve sacrifié sur l’autel de la protection contre la douleur de la perte. Et c’est ce même sacrifice de l’amour qui profite d’abord à l’instauration d’un modèle hiérarchique, avant d’enfoncer les portes qui permettent sa préservation ».
La douleur des séparations et l’angoisse de perte amènent ainsi à investir le « compromis patriarcal » en tant que « rempart contre d’autres ruptures à venir » ou contre la crainte d’être trahi. Voici donc l’impératif du patriarcat : évitez précisément ce que vous pourriez désirer mais qui pourrait vous décevoir et vous blesser, de façon à maintenir l’illusion que vous n’aurez plus à souffrir ou à éprouver votre propre vulnérabilité à l’égard des autres. Ainsi, outre les bénéfices très concrets dont peuvent bénéficier ceux qui jouissent de la domination patriarcale, il « existe encore d’autres mobiles plus profonds, pour tenir » (Freud) au patriarcat, des facteurs dont « on ne peut comprendre la nature » « sans une nouvelle excursion dans le domaine de la théorie psychologique » : « le patriarcat persiste encore parce qu’il impose une trahison de l’amour avant de rendre sa perte irréparable ».
Sacrifier les liens en faveur d'une "sécurisation identitaire"
En étudiant le développement d’un groupe de garçons depuis la crèche jusqu’à leur première année de primaire, la chercheuse Judy Chu de l’université de Stanford, a pu s’apercevoir qu’ils devenaient progressivement de moins en moins attentifs, qu’ils éprouvaient des difficultés de plus en plus grandes à s’exprimer, qu’ils restreignaient leurs investissements relationnels et émotionnels, que leur créativité et leur imaginaire s’asséchaient. Ainsi, à travers certaines épreuves « initiatiques », ces enfants se voyaient contraints d’intérioriser les normes de la masculinité, de s’approprier les constructions genrées et hiérarchisées de l’ordre patriarcal, en rejetant tout ce qui pouvait être perçu comme féminin. De fait, certains comportement perçus comme naturels pour les garçons ne sont que le reflet d’une adaptation culturelle, d’une mise en conformité normative, d’un alignement performatif avec les attendus collectifs, au détriment de secteurs essentiels au développement humain, tels que l’affectivité, l’expressivité, la socialité, la sensibilité ou la vulnérabilité. Une telle amputation et neutralisation des réactions émotionnelles vont d’ailleurs de pair avec l’intensification des signes de mal-être et de « troubles », désormais catégorisés en tant que manifestations neuro-développementales…
Dès l’âge de quatre ans, des garçons peuvent donc se trouver « stratégiquement » contraints de manifester certains codes dominants, en substituant des « conduites fallacieuses et autres faux-semblants à leur présence relationnelle (leur sollicitude, leur authenticité, leur expressivité et leur franchise) ».

Agrandissement : Illustration 3

Comme le souligne le sociologue Gérard Neyrand, « l'enfant est un être social auquel est transmis, par de multiples médiateurs, l'ordre de la société dans laquelle il s'inscrit » et ces « discours largement prescripteurs de normes de comportements et d’attitudes visent non seulement les enfants mais aussi avant tout les acteurs centraux de leur socialisation : parents, éducateurs, professionnels des institutions de prise en charge… ».
De son côté, Niobe Way, professeur de psychologie à l’Université de New York, montre également que les adolescents font l’expérience d’une « crise de connexion » et d’une perte d’intimité, parce qu’ils doivent se conformer à des rôles stéréotypés et déplacer leur individualité hors du relationnel.
Ces rituels d’initiation imposent donc de trahir tout besoin d’affection voire de dépendance, de se fractionner, pour se protéger de la peur d’être trahi et abandonné…
Ainsi, à travers la promesse d’une sécurité, d’une stabilité, d’une adaptation sociale, ou d’une conformité, le patriarcat prescrit des parcours scénarisés culturellement par le genre.
« Ces étapes ont une importance culturelle, parce qu’elles servent à préserver les structures politiques et hiérarchiques, de même qu’elles justifient ou dissimulent l’oppression ». A travers ces trajectoires identitaires normées et ces sacrifices, le système patriarcal institue effectivement des clivages qui permettent de ne plus percevoir les luttes de pouvoir, les enjeux autour de la domination et de la coercition, la rationalisation des inégalités, etc. De fait, la culture patriarcale valorise également la séparation entre les domaines du sensible et du rationnel, favorisant une appréhension désaffectée, neutre, objective du monde, et l’acceptation désabusée de « gradients d’humanité ».
Chez les enfants, la résistance saine à cette perte relationnelle et affective se doit d’être étouffée, normalisée, régulée. De gré ou de force, ils doivent internaliser des divisions et des hiérarchies sur la base du genre, intégrer la culture patriarcale et renoncer à s’insurger. D’une forme de lutte politique, on en passe alors à des défenses psychiques individualisées, lesquelles s’accompagnent, pour la plupart des garçons, « des problèmes traditionnellement associés à leur genre (par exemple, les troubles du comportement, de l’attention et de l’expression, de même qu’une attitude désinvolte voire apathique chez les adolescents, tout comme le taux élevé de suicide et de violence létale). Chez les filles, on reconnaitra comme signes caractéristiques la dépression, les troubles alimentaires, les mutilations et leur mutisme qui s’installent graduellement à l’adolescence ». Les injonctions à la binarité sont internalisées, au prix d’une amputation et d’une forme de conspiration du silence et de la violence. Le détachement vis-à-vis de soi et des autres est affirmé comme inévitable, avec une forme de répression des forces vives de la sexualité infantile, des pulsions épistémophiliques, de la curiosité, du polymorphisme, de l’instable, de l’indéterminé, etc.
« Chaque groupe social définit l’enfant selon des normes qui sont utiles au groupe : commodes aux parents et aux aînés, bien plus que conformes à la réalité objective qu’est l’enfant » Georges Devereux, Essais d’ethnopsychiatrie générale
D’ailleurs, on peut se demander si, de façon contemporaine, les revendications transgenres et les « troubles identitaires » chez les enfants et les adolescents ne constituent pas des symptômes d’un refus de l’ordre patriarcal….
De fait, tous les germes de refus face au sacrifice des affects et des liens, toute colère d’espoir, toute remise en cause des prescriptions hostiles aux désirs ne sont pas des signes d’immaturité et d’infantilisme, mais l’expression d’une résistance saine, susceptible de devenir politique. Au contraire, l’intériorisation et l’acceptation des entorses relationnelles et affectives imposées par l’ordre patriarcal conduisent au ressentiment, au renoncement, au consentement résigné, à la restriction de l’expression des besoins émotionnels, mais aussi à « l’aversion malveillante, dirigée contre soi-même ou projetée sur les autres, souvent plus vulnérables que soi ».
« Le fait que les enfants se refusent à observer certains rites de passage justifiés par un modèle binaire fondé sur la distinction et la hiérarchie entre hommes et femmes (les briques élémentaires de l’ordre patriarcal) suit la même trajectoire que celle de leurs réactions à la perte : protestation, désespoir, détachement. La portée du patriarcat dépend du fait que celui-ci investit beaucoup dans la phase de transition entre protestation et détachement, c’est-à-dire dans la perte relationnelle – la trahison de l’amour ou le silence de soi – qui ôte du chemin un obstacle majeur à la préservation de l’ordre hiérarchique (et ce au gré des générations) ».
L’enfant « se comportera de façon de plus en plus égocentrique et, plutôt que de diriger ses désirs et ses sentiments vers d’autres personnes, se préoccupera davantage des choses matérielles » (John Bowlby).
Ce sont alors « le silence et la violence qui signalent le passage de la protestation au désespoir », avec une forme de désactivation subjective, d’autosuffisance compulsive, de pseudo-indépendance, d’assèchement émotionnel, et une sociabilité de plus en plus superficielle et convenue. « Le détachement peut être considéré à la fois, au passé, comme le symptôme d’une perte vécue et, au présent, comme le moyen de se prémunir de la douleur que causeraient d’autres pertes à venir ». Et le désir d’accumulation de biens remplace finalement le désir de liens….
« Le fait que ces signes augmentent lors de ces périodes cruciales du développement donne une idée du lourd tribut que ces épreuves initiatiques fédératrices du patriarcat selon des codes genrés peuvent avoir sur le psychisme de l’enfant ».
Dès lors, dans un véritable cercle vicieux auto-entretenu, « les individus piégés dans un paysage affectif stérile infligent aux autres – précisément par leur indifférence – ces expériences d’abandon et de rejet contre lesquelles eux-mêmes s’étaient employés à se protéger » … « L’internalisation de ces codes de genre imposés par le patriarcat entraîne donc ce cercle vicieux de perte auto-entretenu, par le biais duquel la victime de la perte devient elle-même bourreau (en infligeant la perte à son tour), et contribue à préserver le patriarcat du fait de son silence ou de sa violence ».

Agrandissement : Illustration 4

Bowlby décrit plusieurs mécanismes de défense face à l’angoisse de perte, ainsi que des modalités spécifiques en termes de profil d’attachement insécure. Or, d’après Gilligan et Snider, ces mouvements différenciés de détachement pathologique, soit sur le mode évitant, soit sur le mode anxieux, correspondraient aux idéaux patriarcaux de masculinité et de féminité. Ainsi, « ces réactions défensives à la perte maintiennent en place les conditions de soumission et de domination, de silence et de violence qui sous-tendent l’ordre patriarcal ».
L’identité masculine patriarcale se déploie ainsi comme un refuge, qui déploie un détachement émotionnel et une pseudo-indépendance pour faire face à la vulnérabilité en rapport avec la dépendance aux liens affectifs.
Bourdieu avait déjà analysé le « privilège masculin » comme un piège « qui impose à chaque homme le devoir d’affirmer en toute circonstance sa virilité (…). La virilité entendue comme capacité reproductive, sexuelle et sociale, mais aussi comme aptitude au combat et à l’exercice de la violence, est avant tout une charge. Tout concourt à faire de l’idéal de l’impossibilité virile le principe d’une immense vulnérabilité ».
Ainsi, la masculinité, en tant que dérivation d’un attachement évitant, est une stratégie défensive « d’exclusion des affects », d’autosuffisance compulsive, un bouclier dressé face à la sensibilité émotionnelle. Dès lors, « lorsque la muraille défensive s’effondre », l’hostilité et la violence (contre soi et/ ou les autres) font irruption à la place de la douleur causée par la perte…
En ce qui concerne la normalisation identitaire du féminin en régime patriarcal, l’attachement anxieux conduirait à se déposséder de soi, à travers une répression de ses propres besoins émotionnels, d’affirmation, de reconnaissance, d’indépendance. L’abnégation et la perte d’autonomie seraient ainsi la contrepartie d’un désaveu de sa propre voix en faveur d’une recherche de symbiose et d’une forme de soin compulsif, d’hyper-accommodation, d’altruisme extrême au point d’en devenir désubjectivant. Virginia Woolf fait d’ailleurs une description saisissante de « l’ange de la maison », icône de la bonne féminité du XIXème qui « était ainsi faite qu’elle n’avait nulle pensée, nul désir qui lui fût propre, préférant toujours partager les pensées et les désirs des autres ». A l’évidence, cette féminité patriarcale induit une désactivation des capacités à intégrer les phénomènes de violation des droits, d’instrumentalisation, d’abus, et vient anesthésier les possibilités de refus ou de révolte.
Au final, l’ordre patriarcal impose donc une « internalisation d’un modèle binaire du genre » : « on passe de la relation à l’autocensure féminine et au détachement masculin », en tant que « condition nécessaire afin d’instaurer une hiérarchie qui exige deux formes de perte : l’empathie en haut de la hiérarchie ; et l’affirmation de soi en bas de la hiérarchie ». De surcroit, ce clivage identitaire normatif se trouve auto-entretenu, chaque polarité venant renforcer l’autre : « l’attachement anxieux et l’attachement évitant peuvent fonctionner en tandem, afin de former un système de projection mutuelle ». Ainsi, chaque identité de genre aurait tendance à projeter sur l’autre ses propres parties désavouées : « les tyrans projettent sur leur victime leur vulnérabilité », alors que « la victime projette sur son persécuteur l’assurance et le pouvoir qu’elle n’ose pas revendiquer ».
Dès lors, « les relations mutuelles -autrement dit les piliers de l’intimité- sont donc remplacées par des relations complémentaires ». A la place d’une forme de réciprocité, de spontanéité, « d’authenticité » dans les liens et les dynamiques identificatoires ou désirantes, le patriarcat impose un système hétéronormatif clos, fondé sur une complémentarité normée des identités. Une injonction s’imposerait alors aux femmes, afin qu’elles deviennent un réceptacle dans lequel les hommes peuvent projeter leurs émotions refoulées, de même que leur besoin de sollicitude, leur dépendance. En contrepartie, elles devraient renoncer à prendre soin d’elle-même.
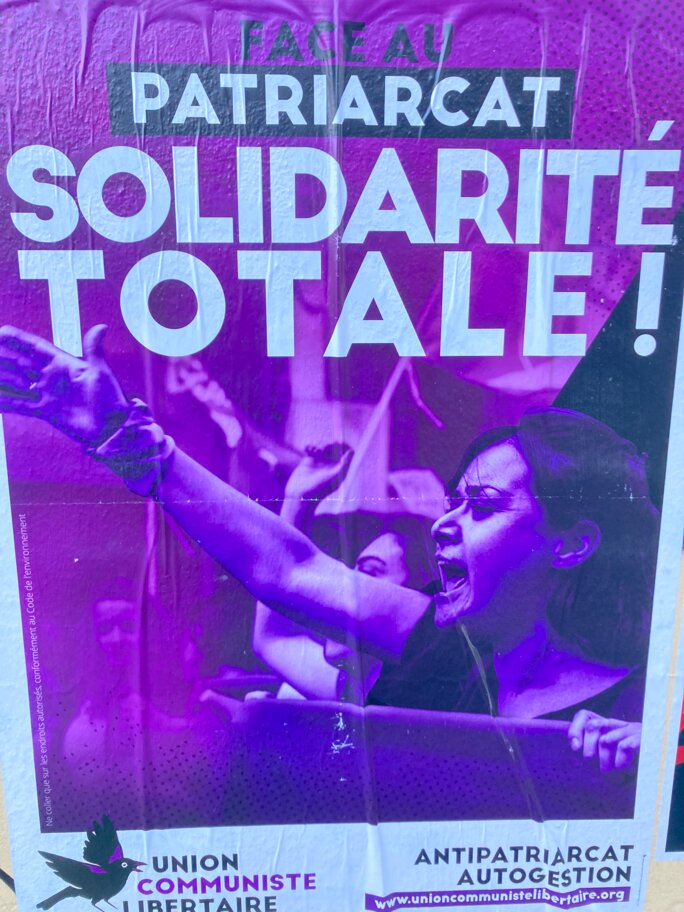
Agrandissement : Illustration 5
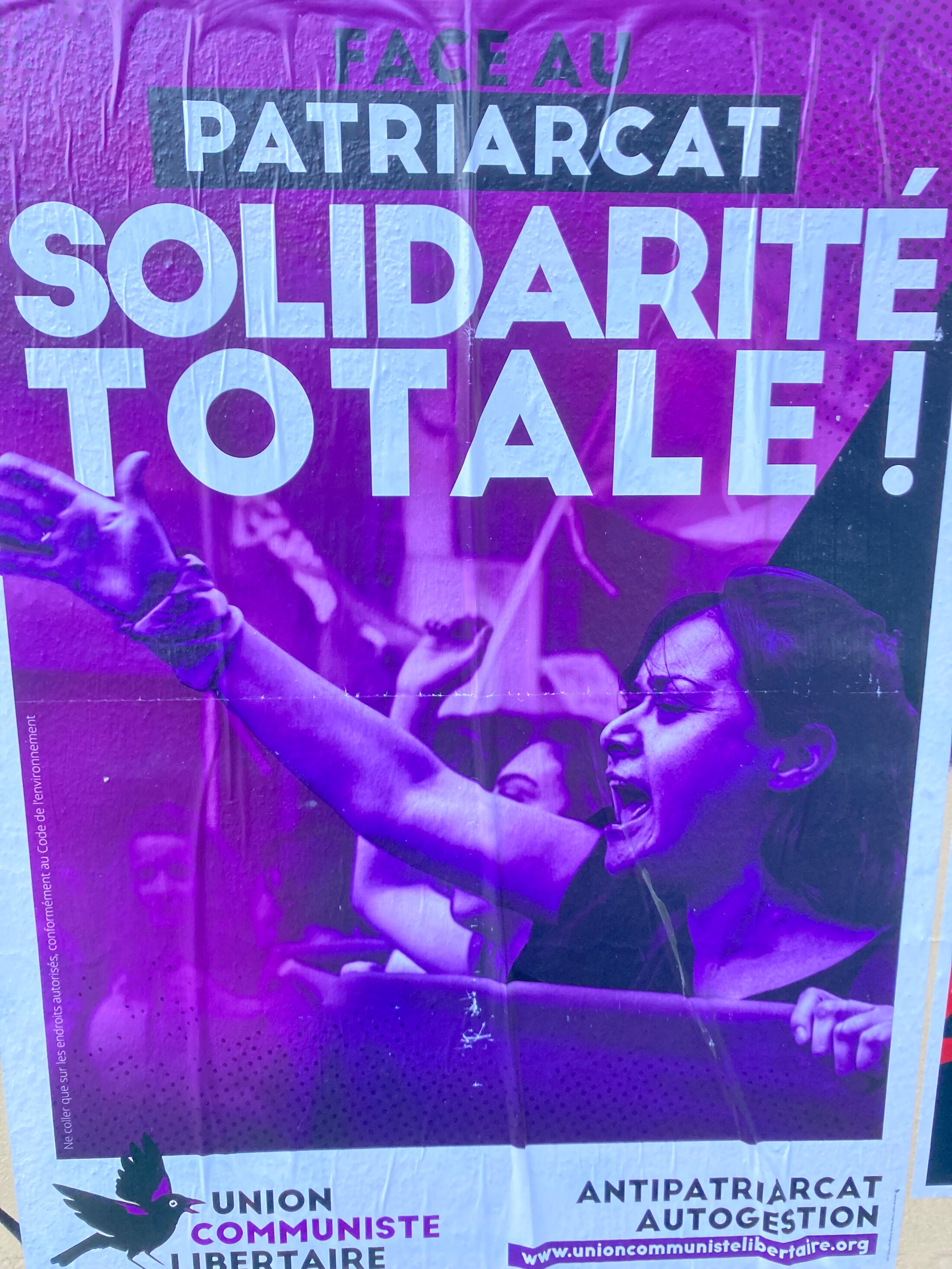
Une mise à mal des velléités de résistance
Initialement, « ces injonctions à se plier aux codes genrés du patriarcat sont accueillis par des contestations parce qu’en compromettant notre intelligence relationnelle, nous perdons les relations que nous désirons vraiment tisser et dont nous avons besoin ». Cependant, cette protestation légitime face à l’amputation de soi peut basculer dans la résignation individuelle, la « psychisation » et la production de mécanismes de défense sclérosants, en l’absence de relais collectifs et politiques.
La dimension traumatique du patriarcat impose finalement un clivage identitaire interne, mais aussi entre l’individu et les collectifs, la pensée et les affects, les aspirations et les rôles, les ayant-droits et les soumis. Morcellement subjectif, coupure des relations, répressions des désirs, « entrave de notre capacité à réparer tout lien social ou affectif » …Ces rôles genrés dénaturent notre humanité, et nous rendent incapables « de ressentir ou de penser les blessures que le patriarcat nous inflige, nous sommes anesthésiés, incapables d’être attentifs à la souffrance ». De même, ces identités encloses entravent les possibilités de décentrement, de jeu et de protestation ; le refus d’être amputé d’une part de soi se trouve alors dénigré, appréhendé en tant que stigmate d’une immaturité et d’une résistance à des deuils nécessaires…Au-delà de la performance socio-culturelle, l’assignation genrée, « pivot de toutes les formes d’oppression », « rend honteuse notre capacité à réparer nos blessures, il ferme la porte à toute forme saine de résistance à l’injustice ».
Dès lors l’institution patriarcale se perpétue, en tant que défense collective pathologique instrumentalisant l’expérience de la perte, « dissimulée sous les chaînes de la honte ». Et, en conséquence, le détachement et le désir de maîtrise ou de domination sont appréhendés comme naturels, alors même qu’ils constituent une tragique limitation à notre réalisation subjective et collective. « Si l’on considère le désir que partagent tous les êtres humains de vivre en relation les uns avec les autres, de même que leurs compétences relationnelles inhérentes à notre humanité, alors il est nécessaire que de telles compétences soient entravées ou retardées afin d’établir puis de maintenir la hiérarchie ». L’initiation au système patriarcal, avec ses normes, ses prescriptions identitaires, ses gradients de droits et de domination, requiert de perdre « sa propre voix », sa conflictualité, ses désirs, sa singularité, etc. L’absence d’antagonisme est d’ailleurs une des marques de fabrique du patriarcat, supposant un consentement et une mise à disposition : la parole du Père ne doit pas être discutée, elle identifie et assigne – d’où la complicité du système patriarcal avec les régimes autoritaires ou totalitaires, et son incompatibilité avec une véritable démocratie...
Clivage des identités sociales et "infrahumanisation"
"L'humanité est mâle et l'homme définit la femme non en soi mais relativement à lui; elle n'est pas considérée comme un être autonome" Simone de Beauvoir, "Le deuxième sexe"
Dans "L'humanité écorchée", Jacques-Philippe Leyens décrypte les phénomènes de psychologie sociale qui amènent les "endogroupes d'appartenance" à inférioriser les "exogroupes" sur le plan de leur dimension humaine. "La différence d’humanité peut s’expliquer par un surcroit d’humanité de l’endogroupe, par une moindre humanité des autres groupes, ou encore, et le plus souvent, par une double démarche qui accorde de l’humanité au groupe d’appartenance pendant qu’il prive les autres groupes d’une part de cette même humanité". Dans cette logique, les groupes dominants se définissent depuis leur intérieur, reconnaissant leurs individualités, leurs différences, et leurs spécificités. Au contraire, les groupes dominés ont tendance à être appréhendés comme des agrégats, formés par une masse indistincte, sans véritable individuation subjective : "les membres des groupes dominés se vivent, ou sont perçus, comme des exemplaires interchangeables et reproductibles". Les identités deviennent alors des formes de catégorisation statiques, closes, grégaires, permettant à la fois de renforcer le besoin d'appartenance et de similitude, tout en légitimant les clivages, les hiérarchies, les statuts et les oppressions. Ces différenciations et catégorisations identitaires sur le plan groupal viennent finalement entretenir l'idéologie des dominants et leur suprématie, à travers notamment le fait de retrancher une part d'humanité aux subalternes. Ainsi, "les groupes de haut statut et qui ont du pouvoir infrahumaniseraient plus que ceux de bas statut" et "les gens qui s’identifient fortement à leur groupe ont tendance à donner un surplus d’humanité à leur groupe d’appartenance par rapport à l’exogroupe". Ces processus d'infrahumanisation sont inconscients, mais c'est justement cette dimension automatique et implicite qui rend compte de leur "puissance", de leur pénétration et de leur fonction défensive, en limitant par exemple les affects en rapport avec l'empathie, en désindividuant les "infrahumains", et en autorisant ainsi leur exploitation et leur invisibilisation, par diffusion de responsabilité.
A l'évidence, le système patriarcal mobilise également ces processus, afin d'entériner les hiérarchies, les statuts, les dominations et les réifications, tel une pieuvre aux tentacules démultipliées…

Agrandissement : Illustration 6

Dès lors, une véritable lutte contre l’institution patriarcale ne pourra faire l’impasse des mécanismes tant politiques que psycho-affectifs qui entretiennent ce système de domination et de hiérarchisation. Résister à l’emprise patriarcale suppose d’en passer par les liens et les affects, à l’interface des enjeux de pouvoir et des manières singulières d’être altéré au sein même de son psychisme. « Le changement politique dépend d’une transformation psychologique, et vice versa. Si nous ne touchons pas à la psychologie du patriarcat, si nous la laissons intacte, nous avons peu de chances de nous débarrasser de la politique patriarcale » (Gilligan). S’attaquer au patriarcat implique donc d’en déconstruire les rouages, inscrits dans les processus identificatoires, dans les dynamiques de subjectivation et d’aliénation, dans la façon dont certains modes d’affection et certains mécanismes de défense sont intériorisés… A cette fin, « toute voix doit être convoquée, accueillie, entendue » ….
Cette institution patriarcale a-t-elle toujours été aussi prégnante ? Et quelles sont ses racines historiques ? Continuons notre exploration paléoanthropologique…
A suivre



