« On les hait non seulement parce que l’on envie leur futur mais surtout parce qu’ils sont porteurs d’un caractère incontrôlable que nous voudrions mater, étiqueter, stigmatiser, endiguer » Laura Pigozzi
Après avoir abordé certaines manifestations de la haine de l'enfance dans le billet précédent, la suite de cette présentation en développe les enjeux sous-jacents, et notamment l’angoisse suscitée par la vulnérabilité infantile.
Mais revenons-en à notre sujet : si l’enfance mobilise de telles contre-attitudes, c’est bien qu’elle doit attiser une forme d’appréhension, voire d’effroi… De fait, pour reprendre les mots de Marguerite Duras, « l’intempérance désordonnée et tragique de l’enfance » bouscule, exige et déconstruit les évidences rassurantes.
La haine se loge déjà dans l’ambivalence du lien à l’enfant. Comme le soulignait nonchalamment Donald Winnicott, avec son flegme très britannique, il existe un certain nombre de raisons pour un parent de haïr son enfant : celui-ci échappe aux désirs, fait interférence, blesse, fait preuve de cruauté et d’ingratitude, monopolise, utilise ses objets d’attachement pour ses satisfactions physiologiques et pulsionnelles, impose ses exigences et ses propres rythmes, excite tout en frustrant…
Par ailleurs, l’intrication pulsionnelle de la passion et de la destructivité se loge aussi en amont, et préexiste à la naissance de l’enfant dans la vie fantasmatique parentale : ainsi, selon Anne Dufourmantelle, « la sauvagerie est ce qui dans une mère la rend capable d’infanticide, mais aussi de sacrifier sa vie pour son enfant. Elle est le versant de la plus grande haine et du plus grand amour. Le maternel est ce passage du murmure à la voix qui verse l’enfant du côté du monde et le retient ».

Agrandissement : Illustration 1

De son côté, Serge Leclaire évoque le nécessaire meurtre symbolique de « l’enfant merveilleux », cette représentation inconsciente primordiale où se condenseraient nos nostalgies et nos espoirs perdus : « il y a pour chacun toujours un enfant à tuer, le deuil à faire et refaire continûment d’une représentation de plénitude, de jouissance immobile, une lumière à aveugler pour qu’elle puisse briller, s’éteindre, sur fond de nuit. Qui ne fait et refait le deuil de l’enfant merveilleux qu’il aurait été reste dans les limbes et la clarté laiteuse d’une attente sans ombre et sans espoir ; mais qui croit avoir une fois pour toutes réglé son compte à la figure du tyran s’exile des sources de son génie et se tient pour un esprit fort devant le règne de la jouissance ». De fait, on pourrait penser que l’impossibilité de s’émanciper symboliquement et d’intégrer harmonieusement cette figure infantile contraint à maintenir une forme de haine active, devant sans cesse se rejouer, à l’égard des enfants « réels », ces intrus vecteurs d’appréhension et d’envie.
Et il suffit d’un rapide survol historique ou culturel pour constater à quel point les enfants peuvent être les victimes de violences impitoyables et collectivement instituées : « l’histoire des mœurs, saisie dans la longue durée, nous apprend que les enfants ont été ignorés, déconsidérés, reniés, écrasés, battus, abandonnés, exposés ou rejetés sans remords et sans espoir d’aucune compensation. Tout simplement parce que l’enfance est fantasmée comme une existence indécise, pas encore humaine, ou vaguement bestiale. L’enfance, c’est de la vie, et encore de la vie, brute et brutale ; de la vie qui se soustrait à la culture, à la fois extrêmement fragile et menacée (en raison de la mortalité infantile), et aussi paradoxalement vivace, insistante, croissant et se multipliant, donc dangereuse » (Pierre Péju).
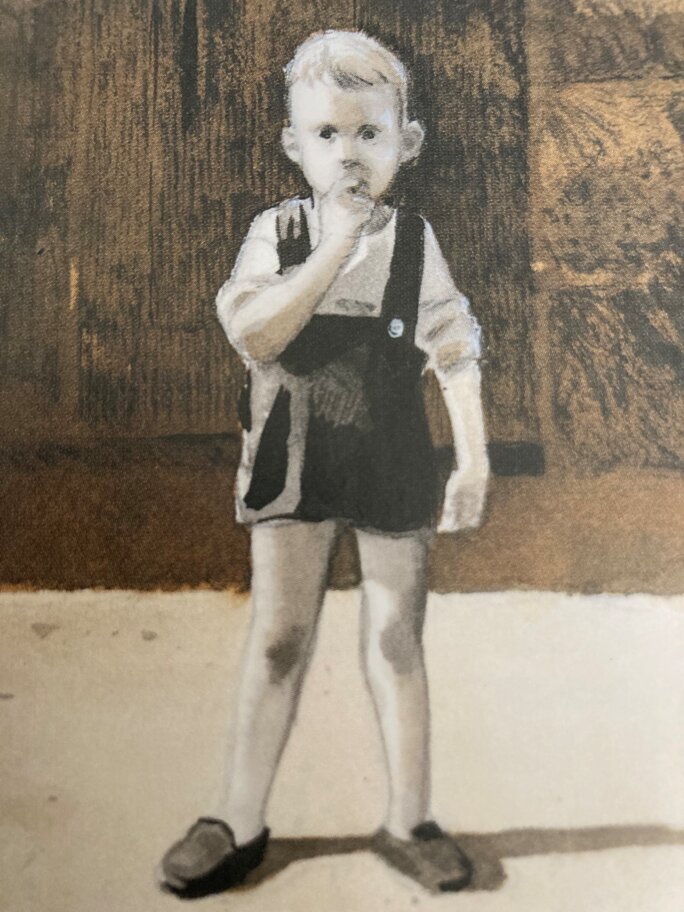
Agrandissement : Illustration 2

De fait, chaque époque excelle à se voiler la face à propos de ce qu’elle inflige aux générations émergentes, à se masquer ses compromissions et ses cruautés spécifiques. N’oublions pas, par exemple, que la surconsommation infantile dans les pays riches possède sa face obscure, à savoir la surexploitation et l’esclavage d’enfants dans d’autres parties du monde…Nous nous indignons lorsqu’est médiatisée la mort d’un enfant, échoué sur une plage méditerranéenne, victime de la guerre, de la famine, ou du paludisme. Et puis, nous détournons aussi vite le regard…
Plus fondamentalement, chaque venue au monde ranime confusément certaines angoisses archaïques, voire une défiance plus ou moins symbolisée à l’égard de l’énigme menaçante que représente tout nouveau-né et son lien supposé avec une forme d’au-delà. L’enfant est le vecteur d’un trouble irrépressible, par son silence, par son retrait ou son ignorance des évidences sociales ; une brèche qui confronte aux plis et aux replis, à l’immanence des genèses inachevées…La puissance de cette fragilité peut alors effrayer, gêner, dégoûter, provoquer des phobies spécifiques, voire attiser une forme de haine immémoriale. On peut ainsi se représenter l’exigence de refoulement et de transformation qu’a dû exiger la valorisation contemporaine de l’enfance, ayant nécessité l’institution de nouvelles sensibilités, de nouvelles dispositions affectives, relationnelles, mais aussi juridiques et politiques. Cependant, en dépit de tous ces dispositifs institutionnels, les relents de terreur, toutes les strates de haines et les fantasmes infanticides irriguent toujours les inconscients individuels et collectifs.
« Toutes ces pédophobies relatives ont un point commun : elles envisagent l’enfance sous l’angle d’une matérialité débordante, d’une animalité troublante, d’une sauvagerie organique, excrémentielle, humorale. L’enfance est non seulement ce qui déforme le corps, ce qui crée du désordre, ce qui rappelle à la quotidienneté de l’alimentation, ce qui exige d’envisager un avenir, mais aussi, en tant qu’impureté et confusion, l’opposé de la vie de l’esprit. L’enfance est non seulement absence de pensée ou « pensée fausse », mais ce qui empêche de penser » (Pierre Péju).
Nonobstant, chaque société secrète ses propres « processus d’infantilisation », au sein desquels rituels, fantasmes, normes, institutions, contribuent à faire avec la part de négatif, d’inconnu et d’obscurité dont chaque enfant est porteur. Toute pédagogie peut à la fois être vectrice d’émancipation, mais aussi manifestation du besoin de contrôle autoritaire voire d’emprise, et source d’aliénation…
Victor Hugo, dans « l’Homme qui rit », décrivait par exemple ces enfants « destiné(s) à être un joujou pour les hommes ». Là se réactive sans doute une ancestrale acrimonie pédophobique, une fabrique de haine sans cesse reconfigurée. Les contes, tel que le joueur de flûte de Hamelin, rappelle qu’au fond des inconscients, les enfants sont les équivalents des rats, immondes, grouillants, avides, ruineux, innombrables, impersonnels, contaminés, etc. Et les contextes pandémiques tendent immédiatement à désigner la responsabilité des morveux, ainsi que le besoin collectif de les sacrifier pour préserver l’ordre social…Dès lors, on entrevoit quelles puissances fantasmatiques millénaires la vision moderne positive de l’enfance a dû refouler pour s’imposer, sans réussir à enfouir totalement cette terreur mêlée de sadisme suscitée par l’enfant…
D’où cette tentation des régimes totalitaires pour endoctriner et enrôler les enfants. Par-là, il s’agit non seulement de contrôler l’incontrôlable subversion infantile, son irréductible anarchie. Mais aussi d’instrumentaliser la violence sans frein des petits soldats fanatisés, leur potentiel d’adhésion totale et sans limite, leur animosité enthousiaste à l’égard des ennemis désignés. Or, « le plus souvent, les enfants ne haïssent qu’en réponse à cette inoculation cynique de peur et de détestation radicale » (Pierre Péju).
Face à la terreur qu’inspirent les enfants, la tentation est forte d’en faire des défenseurs acharnés des idéologies hégémoniques, des régimes les plus violents et totalitaires jusqu’aux velléités les plus libéralisées du marché dérégulé, à travers des promesses séductrices : je fais ce que je veux, quand je veux, sans devoir rencontrer la moindre restriction à ma jouissance instantanée…
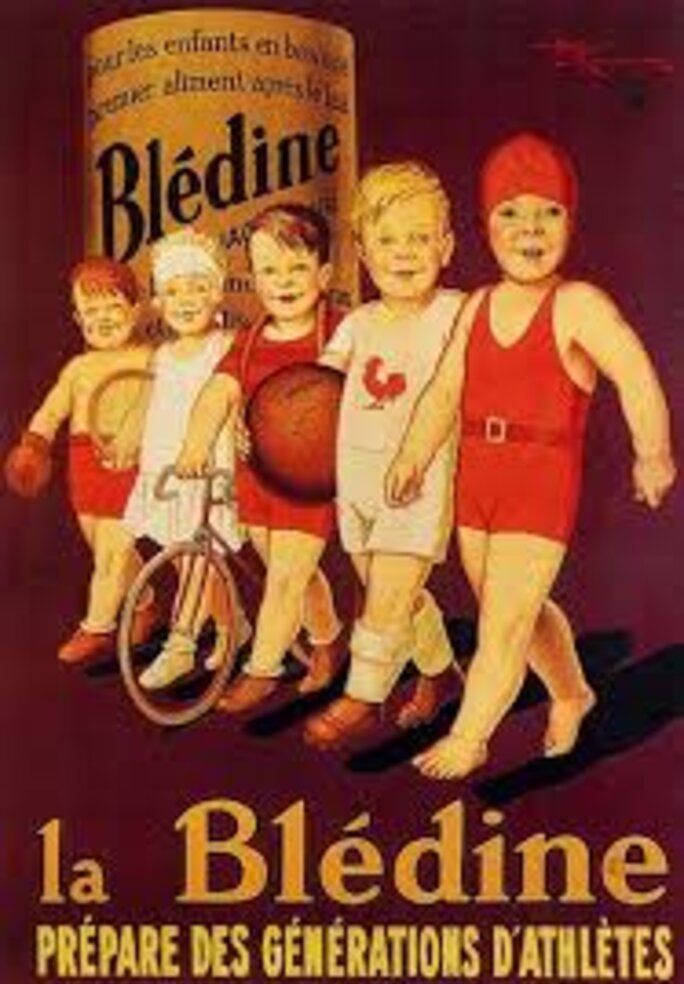
Ainsi endoctrinés et normés, les enfants paraissent moins menaçants à l’égard du monde des adultes, de leur quête de pouvoir, de beauté, de jeunesse, d’appropriation sexuelle, d’immortalité…
Cependant, irrésistiblement, l’enfant suscitera toujours le désarroi par son irréductible altérité, par sa dimension d’étrangeté, par tout ce qui, en lui, échappe à l’appropriation et au contrôle. Il est effectivement porteur d’imprévu, d’inanticipable ; il représente quelque chose de l’insaisissable de la temporalité et de l’ouverture vers l’inconnu. L’enfance incarne aussi la puissance inouïe du négatif (Hegel), une mouvance déployant sa propre négation en devenant autre. Ainsi, son émergence identificatoire ne peut être en lien qu'avec la différence, la non-coïncidence, la scission, l’altération…L’enfant est fondamentalement un EVNI, un « Ensemble de Virtualités non Identifiables », et cela peut être perçu comme assez flippant ou vertigineux. Car, de surcroit, l’enfant titille les certitudes, bouscule les conventions, questionne les préjugés, ébrèche les évidences. Comme le décrit Adorno (« Dialectique négative »), « il veut s'assurer de la signification des mots, cette occupation le conduit à la relation entre le mot et la chose. Il aime à tracasser sa mère avec le lancinant problème de savoir pourquoi un banc s'appelle un banc. Sa naïveté est non-naïve ». Cet empêcheur de tourner en rond est un penseur existentiel impitoyable, incisif, il appuie là où ça fait mal. Il remet sur le chantier des tourments qu’on aurait préféré oublier une bonne fois pour toute…Pour reprendre des formules de Lévinas, l’enfant est « celui qui ne fait pas nombre avec moi », cet étranger « qui trouble le chez-soi ». Il vient s’opposer à la prééminence absolue de l’identique à Soi. Car l’enfant est également un transfuge, toujours en dehors, à côté, échappant aux catégorisations, aux classifications. Il prend la tangente, n’est jamais là où on l’attend. Véritable miroir aux alouettes, jouant l’arlésienne, ailleurs, à côté. Une puissance impersonnelle, au-delà du Moi et de l’identifié.
L’enfant est le pur souverain de son royaume singulier, sans genre ni destin. Il esquive les rôles et les places instituées, par son hermaphrodisme naïf. Tout en lui n’est qu’esquisse, à la fois présence et insuffisance, plein et évidement. Une pure « différance » (Derrida) résistant aux définitions et aux catégories. Et pourtant, l’enfant représente aussi une vulnérabilité essentielle et ontologique, exhumant sans cesse notre condition d’êtres dépendants, aliénés, jetés dans le monde et condamnés à la déréliction…
« Et l’enfant ? Semblable au matelot que les flots furieux ont rejeté sur le rivage, il gît, tout nu, par terre, incapable de parler, dépourvu de tout ce qui aide à vire, dès l’heure où le projetant sur les rives que baigne la lumière, la nature l’arrache avec effort du ventre de sa mère : de ses plaintes lugubres il remplit l’espace, comme il est juste à qui la vie réserve encore tant de maux à traverser » Lucrèce, « De rerum natura »
De cette condition initiale de désaide, de ce drame originel, découle la contrainte de tout existant à devenir captif de l’Autre. Comme le rappelle Simone de Beauvoir (« Le deuxième sexe »), « c’est dans cette perspective qu’il faut interpréter les conduites de l’enfant : sous une forme charnelle, il découvre la finitude, la solitude, le délaissement dans un monde étranger ; il essaie de compenser cette catastrophe en aliénant son existence dans une image dont autrui fondera la réalité et la valeur ». Non sans un certain trouble, l’adulte réalise alors son aliénation primitive comme clause indépassable de son émancipation. Et il prend également conscience que, pour l’enfant, il est comme une figure divine investie du pouvoir de lui conférer l’être…L’enfant est alors un miroir, reflet de la dépendance absolue aux soins et aux récits qui nous ont constitué, rappel du « vaste trou noir comme origine de la mémoire de nous-même » (Radmila Zygouris). De fait, « nos racines plongent dans le terreau d’une contrée perdue. C’est notre faille commune et l’origine obscure et mystérieuse de nos créations ». Dès lors, appréhender l’enfance, c’est faire face à un oubli, à une perte de soi…

Agrandissement : Illustration 4

L’enfant est aussi une représentation de la temporalité, de l’implacable passage du temps, et de l’éphémère. Comme le disait Héraclite, « le temps est un enfant qui s’amuse, il joue au tric-trac. A l’enfant, la royauté », c’est-à-dire l’insouciance et l’ouverture des horizons temporels, auxquels répondent le souci de l’adulte et son être-pour-la-mort…Impitoyablement, l’enfant vient rappeler la fatalité de la succession des générations, les destins et la roue inexorable du Temps…D’où la terreur et l’envie qu’il peut susciter. Car l’enfant renvoie à la fois à la finitude et au désir d’immortalité…Or, « le devenir des enfants, c’est la mort des parents » (Michel Foucault) … Ainsi, l’émerveillement des adultes devant la vie de l’enfant est aussi une tentative de se réconcilier avec l’idée de leur caractère éphémère, une formation réactionnelle par rapport à la perspective de leur propre disparition annoncée par le regard infantile.
En outre, l’enfant représente la trace, indélébile, du passé, de ce qui n’est plus, de ce qui ne peut être transformé, attisant une nostalgie parfois douloureuse… « Le passé nous semble alourdi de toute la vie vécue qu’il nous promet (…). La manière dont ce passé est combiné aux grains de poussière de notre demeure en ruine est peut-être le secret qui explique sa survie » (Walter Benjamin, « Une enfance berlinoise »). Au fond, l’enfant réveille immanquablement nos déceptions et nos regrets, en rapport avec ce sentiment d’irréversible.
« L’enfant qu’on a été jettera toujours un regard déçu ou cruel sur ce qu’il est devenu adulte, même si cet adulte a réalisé son rêve. Cela ne signifie pas que l’âge adulte soit par nature damné ou truqué. Simplement, rien ne correspond jamais à un idéal ou un rêve d’enfance vécu dans sa candide intensité. Devenir adulte est toujours une infidélité qu’on fait à nos tendres années. Mais là réside toute la beauté de l’enfance : elle existe pour être trahie » Mohamed Mbougar Sarr (« La plus secrète mémoire des hommes »).
Et puis, l’enfant joue, imagine, met en scène, transforme, avec autant de légèreté que de sérieux. Il apparait alors comme un démiurge inquiétant, détenteur d’étranges pouvoirs alchimiques, capables de créer des mondes, de révéler les vérités cachées, de dévoiler les fragments suspendus d’inconscient. L’enfant est dans le jeu comme « de passage », devenir dans le devenir. Il s’y jette, s’y perd mais aussi bien le survole et le quitte avec une facilité déconcertante.
Or, ce jeu-là peut devenir aussi fascinant que sidérant, comme le rappelait Winnicott : « il faut admettre que le jeu est toujours à même de se muer en quelque chose d’effrayant. Et l’on peut tenir les jeux (games), avec ce qu’ils comportent d’organisé, comme une tentative de tenir à distance l’aspect effrayant du jeu (playing) ».
Lorsque la déréalisation ludique devient sans limites, que l’imaginaire déborde et s’enfle démesurément, le jeu peut dévoiler son côté obscur : dès lors, « le sens du réel, qui implique de tenir compte de l’autre avec empathie mais aussi de bornes concrètes et de la relativité de toute action, s’étiole et disparait » (Pierre Péju). Et « la cruauté infantile se déchaîne avec des excès inouïs mais aussi avec une innocence déconcertante, à partir du moment où les petits humains n’ont plus la moindre intuition de la convention du « on dirait », cette parole, cette mise en récit et ce conditionnel qui régulent leur jeu et font qu’il reste « du jeu » »…Parasité par le retour du réel ou du refoulé, le jeu est susceptible de devenir cauchemardesque, sans limite dans ses déchainements et ses conséquences…L’ordre du monde chavire, les fondements se fissurent ; ce qui nous tient et nous amarre parait alors si ténu…
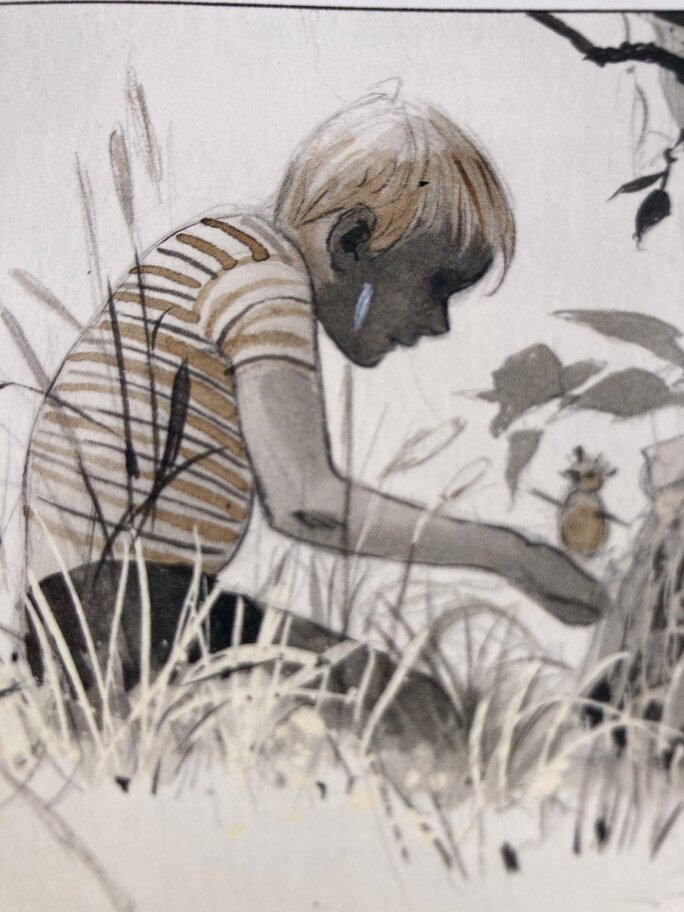
Agrandissement : Illustration 5

« Une minute d’attention aux choses, elles deviennent fantastiques et incompréhensibles ; dangereuses, menaçantes, irréelles » (Alexandre Vialatte)
Il faut dire que le regard phénoménologique de l’enfant fait apparaître les choses et les êtres dans leur réalité nue et évanescente. Il fait surgir le monde tissé par l’inquiétude et l’émerveillement, hanté par d’étranges préoccupations qui concerne le lointain, l’origine, l’invisible, le pourquoi…Les vérités se dissolvent alors dans sa rêverie corrosive…ainsi que l’ordre social.
Mais, au fond, ce qu’il y a peut-être de plus insupportable dans le rapport à l’enfant, c’est qu’il vient aussi réveiller l’infantile des adultes, cette puissance toujours vivace et intempestive qui attend la moindre occasion pour resurgir. Or, l’enfance est un réfléchissement, un appel, pour ne pas dire un gouffre. Un vertige qui inquiète, une vérité qui dérange. On se voudrait « mature », autonome, libéré, et nous sommes toujours nimbés des forces archaïques qui nous déterminent, et contre lesquelles nous érigeons des digues dérisoires. La facticité des rôles sociaux, la condescendance, le sérieux pathétique, la boursouflure des évidences, le désaveu de l’imaginaire et du jeu, l’illusion de savoir et de maîtrise, etc. Tout cela, l’enfant le balaie d’un revers de la main et fait vaciller ces pathétiques prétentions. Indubitablement, nous sommes à la fois étrangers à notre propre enfance, du fait notamment de l’amnésie infantile ; mais, en même temps, comme le soulignait Ferenczi, « il n’y a pas d’êtres humains complètement adultes » et la sève de l’enfantin continue inexorablement à irriguer notre vie psychique, non sans susciter un certain effroi.
De fait, l’enfant n’est pas dupe, et il déconstruit nos évidences adultes, nos sécurités stabilisées. Ainsi, selon Jean Baudrillard (« La transparence du mal. Essai sur les phénomènes extrêmes »), « si les adultes croient qu’ils sont des adultes, les enfants, eux, ne croient pas qu’ils sont des enfants. Ils le sont, mais ils n’y croient pas. Ils naviguent sous le pavillon de l’enfance comme sous un pavillon de complaisance ». Au fond, l’enfant se laisserait passivement désigner et identifier, ce qui lui permettrait de s’opposer, de résister et de prendre la tangente. En effet, laisser croire à l’assignation est une façon de la contester, alors même que l’adulte est persuadé de ses convictions. L’enfant laisse donc les grandes personnes lui dire ce qu’il doit être en tant qu’enfant, et il donne l’illusion de suivre le programme, par complaisance, par jeu, par ironie, ou par commisération. Cela permet en tout cas aux adultes d’être rassurés ; ils sont bien les adultes, ils peuvent adhérer à leur propre essence. Or, « celui qui laisse croire est toujours supérieur à celui qui croit » (Baudrillard)…Et là s’exprime l’irréductible et insupportable liberté de l’enfance…Cet enfant qui ébrèche en permanence l’arbitraire de l’institué, qui dénonce les conventions. Et particulièrement la plus fondamentale d’entre elles, à savoir la langue. En effet, la prise de parole enfantine souligne à quel point le langage est avant tout un jeu, un tissage de croyances et d’arbitraire. Comme l’assène Wittgenstein, « le jeu de langage primitif que l’on enseigne à l’enfant ne requiert aucune justification ». Tout n’est donc que circonstances, usages, gestes, convictions, imaginaires. Soudain, pour l’enfant, cette caisse est une maison, totalement, définitivement. Et il devient véritablement un dinosaure à l’affût, prêt à bondir sur sa proie dans une forêt du jurassique. Dès lors, toutes les certitudes s’effondrent par la puissance instituante du jeu…Et l’adulte se retrouve nu, privé de fondement…L’enfant le destitue impitoyablement, il perce les secrets, révèle les simulacres et les faux-semblants. Il n’est pas là où on voudrait, où il devrait. Toutes nos façons utilitaires, conventionnelles, partagées de s’approprier le monde sont impitoyablement ébranlées ; L’Enfantin, « machine grinçante et agaçante, broyeuse de certitudes » (Pierre Péju).
En outre, l’enfant creuse les réalités ontologiques troublantes, bien au-delà des enjeux familiaux rabougris auxquels on voudrait le cantonner : il réagit effectivement à la totalité de l’existence et du monde. Dans « L’anti-Œdipe », Deleuze et Guatarri insistaient déjà sur ce point : « l’enfant est un être métaphysique. Comme pour le cogito cartésien, les parents ne sont pas dans ces questions-là ». Exit l’importance démesurée que voudraient incarner les figures parentales ; « l’inconscient est orphelin », ce qui peut susciter un certain trouble et mobiliser le désir de tout ramener à l’ordre familialiste afin d’éviter la fugue enfantine, cette altérité radicale qui sans cesse est au-delà…Au fond, l’enfant n’appartient sans doute pas tant que cela au monde familial et familier ; il est peut-être en partie, et de façon confuse, étranger à son environnement intime, plus loin de ses proches que l’on voudrait le croire…
Ainsi, pour Lévinas (« Totalité et infini »), l’enfant « n’est pas seulement mon œuvre, comme un poème ou un objet. Il n’est pas non plus ma propriété. Ni les catégories du pouvoir, ni celles du savoir, ne décrivent ma relation avec l’enfant. La fécondité du moi n’est ni cause ni domination. Je n’ai pas mon enfant, je suis mon enfant », à travers l’expérience du dessaisissement, ce vertige de la différence et du non-moi dans le fantasme d’identique. Ainsi, l’enfant nous rappelle sans cesse que nous ne sommes pas la totalité, que nous sommes troués, béants, traversés par une altérité qui nous ronge et nous constitue. L’enfant nous enchante en nous désenchantant, et parfois en nous désarçonnant par ses révélations, à la fois merveilleuses et effrayantes, belles et terribles. Devenir adulte ne consisterait-il pas à s’épargner, par amnésie, cette tragédie originelle ? A mettre à distance tout ce que l’enfant vient réveiller d’inquiétante étrangeté ? Cette impression de ressentir le familier comme habité par une puissance inconnue et menaçante, soupçon d’une fissure d’altérité dans le même…
N’est-il pas plus rassurant d’oublier l’éprouvante poésie de l’enfance, son impitoyable essentialité, pour s’immerger dans les sédiments du monde commun ? De fait, « le regard de l’enfant laissait être l’objet pour ce qu’il était, sans projeter sur lui une catégorie, un classement ou une volonté » (Pierre Péju). De plain-pied avec le monde, l’enfant est dans une immanence intime et contemplative, immergés dans les bruissements du réel, sans filtre ni symbole ; pure sensation, effroi béant. « Tout proches encore de la nature, ils sont les cousins du vent et de la mer : leurs balbutiements offrent à qui sait les entendre des enseignements larges et vagues » (Sartre, « Les mots »).
L’enfant habite un autre corps, vit dans un autre monde, parle une autre langue, hors des raisons établies, des fixations sclérosées, en phase avec l’indicible. « Ce qu’un oiseau chante, un enfant le jase. C’est le même hymne. Hymne indistinct, balbutié, profond. L’enfant a de plus que l’oiseau la sombre destinée humaine devant lui (…). Ce chuchotement confus d’une pensée qui n’est encore qu’un instinct contient on ne sait quel appel inconscient à la justice éternelle ; peut-être est-ce une protestation sur le seuil avant d’entrer ; une protestation humble et poignante ; cette ignorance souriant à l’infini compromet toute la création dans le sort qui sera fait à l’être faible et désarmé. Le malheur, s’il arrive, sera un abus de confiance » (Victor Hugo, « Quatre Vingt-treize »).
Ainsi, l’enfant et ses sortilèges obligent. L’enfant et ses réminiscences ne peuvent être ignorés, car ils sont le reflet de nos oublis, parfois insupportables.
Dès lors, de façon plus ou moins consciente, les grandes personnes peuvent-elles exiger des enfants qu’ils renient leur propre puérilité, leurs besoins affectifs spécifiques, et qu’ils deviennent de rassurants nourrissons savants, qu’ils progressent, qu’ils soient déjà aussi sérieux et présomptueux que nous. « On pense aux fruits qui deviennent trop vite mûrs et savoureux, quand le bec d’un oiseau les a meurtris, et à la maturité hâtive d’un fruit véreux » (Ferenczi, « La confusion des langues »). De fait, l’enfant est sommé de se désillusionner, de dissocier l’intellect de l’affect, de paralyser toute spontanéité. Sous l’effet de la soumission à l’environnement, on peut alors assister à un divorce contraint entre le Moi prématurément développé et l’expérience psychosomatique.
Au fond, s’exprime là une haine spécifique : la haine de l’enfant en soi. Une haine qui ne fonctionne que sous couvert de déni, qui brouille les places, qui confond les différences. Car, au-delà des traces résiduelles de l’infantile, c’est bien l’enfant blessé, en détresse, négligé, maltraité, qui peut rester comme enclos dans l’adulte. Dès lors, selon Serge Leclaire, « l’enfant à tuer, l’enfant à glorifier, l’enfant tout-puissant, l’enfant terrifiant c’est la représentation du représentant narcissique primaire ». Car l’enfant n’existe plus pour lui, mais en tant que réceptacle de la souffrance inconsciente et indicible, des béances profondes et des dissonances primitives. En conséquence, il faudrait contrôler l’enfant, le catégoriser, le désinfantiliser, le pathologiser, se l’approprier pour le dominer, le déposséder, l’assujettir…
« Cette haine transforme un être qui joue spontanément et en toute innocence, en un automate, coupable de l’amour, et qui, imitant anxieusement l’adulte, s’oublie pour ainsi dire lui-même » (Ferenczi).

Agrandissement : Illustration 6

Telles pourraient alors être certaines finalités des processus de socialisation, d’éducation, d’encadrement voire d’enrégimentement, visant à désenfanter l’enfant, à assécher sa profusion créatrice et à rassurer les sages et grandes personnes. Platon ne disait pas autre chose dans « Les lois » : « de tous les animaux sauvages, l’enfant est celui qui est le plus difficile à manier : autant est abondante, chez lui plus que chez tout autre animal, la source de la pensée, mais une source encore non équipée, autant il se montre fertile en machinations, âpre, et d’une violence dont chez aucun autre on ne trouve la pareille. Aussi a-t-on besoin de la brider comme avec de multiples rênes ». Quand l’effroi se donne l’apparence de la raison…
A suivre



