« Chaque fois que la dignité et la liberté de l’homme sont en question, nous sommes concernés – Blancs, Noirs ou Jaunes – et chaque fois qu’elles seront menacées en quelque lieu que ce soit, je m’engagerai sans retour. » Frantz Fanon, cité par Marcel Manville
Après avoir tenté d’appréhender les racines complexes de la domination masculine et du patriarcat, je souhaiterais désormais questionner les théories qui relient intrinsèquement le sexisme et le racisme au « capitalisme colonial ».
De fait, il y aurait un courant commun dans le fait d’établir une infériorité naturalisée justifiant la sujétion et l’exploitation. Ainsi, selon Elsa Dorlin, la division sexuelle et raciale est inhérente à des « rapports de pouvoir historiquement imposés et éminemment politiques, où s’exercent des formes de violence qui, parce qu’elles sont niées, demeurent licites ».
Dès lors, le sexe et la race ne seraient qu’« un seul et même signifiant d’un dispositif de pouvoir qui se caractérise par la production d’une normativité sexuelle », à travers notamment la production d’une norme dominante de masculinité, « blanche, hétérosexuelle et vertueuse », complice de la domination capitaliste. Ainsi, la soumission féminine, l’esclavagisme des « races inférieures », ainsi que les logiques capitalistes de marchandisation extensive, de productivisme et d’extractivisme forcené seraient des éléments constitutifs de la culture occidentale hégémonique.

Agrandissement : Illustration 1

« Certains dualismes constituent des traits persistants des traditions occidentales ; tous contribuent à la logique et aux pratiques du système de domination des femmes, des gens de couleur, de la nature, des travailleurs et des animaux » Donna Haraway.
Ainsi, sans nuance, ni perspective historique ou anthropologique, la « Culture occidentale », en tant que système de légitimation du mâle blanc, cis-genre, propriétaire, serait intrinsèquement tissée par des significations imaginaires sociales conduisant de façon univoque au Capitalisme, au Racisme et au Sexisme…
Tous les mouvements révolutionnaires, les luttes collectives, les pensées de la désaliénation : pures constructions des hommes dominants pour asseoir leur suprématie, en justifiant l’exploitation des minorités invisibilisées. Il faut donc jeter le bébé et l’eau du bain, puisque les hommes qui ont participé à ces illusions de progrès étaient par ailleurs forcément misogynes, colonialistes, bourgeois ; qu’ils étaient forcément aveugles, ne cherchant qu’à défendre les intérêts de leur classe dominante ; que leurs idées et leurs combats étaient forcément hypocrites, malhonnêtes, partiaux, déterminés par leur sexe et leur « race » ; que de toute façon, il ne faut rien attendre de ces mâles imprégnés de blanchité, de privilège et de pouvoir, puisque, même de façon inconsciente, ils ne peuvent forcément déployer que prédation et asservissement. Leur hétéronormativité n’est qu’un instrument au service de leur reproduction, leur sexualité une arme d’assujettissement, leurs paroles une incitation au silence et à l’oppression.
En contrepoint, les cultures dominées et colonisées, minoritaires, en marge, seraient au contraire « spontanément » en harmonie avec la nature, émancipatrices, respectueuses de toutes les formes de différences ; et en conséquence, les femmes, les personnes racisées et non binaires également, naturellement préservées de la haine, de la volonté de puissance, des dénis d’altérité, des pulsions d’emprise, de l’égoïsme et de la soif de possession…Ainsi, l’avenir de la planète ne pourra être garanti qu’en mettant de côté les ennemis du genre humain, des écosystèmes et de la vulnérabilité, c’est-à-dire les Hommes Blancs Cis-genre.
Tellement simple et limpide qu’on voudrait y adhérer sans frein, y croire : on a trouvé les coupables, on a trouvé les sauveurs. Le programme est tout tracé ! Mais n’y-a-t-il pas là une forme de culturalisme identitaire et essentialisant tout à fait problématique ?
N’y-a-t-il pas le risque d’opposer à une version officielle de l’histoire, au roman national idéologique célébrant le Progrès et les grands hommes, une autre version, qui ne mettrait l’accent que sur les dimensions univoques d’oppression, d’impérialisme, d’exploitation, de crimes, allant de pair avec la négligence des « minorités » invisibles ? L’histoire n’est-elle pas tissée de contradictions, d’antagonismes, d’ambiguïtés, de surdétermination, de zones d’ombre et de complexité ?
Vouloir dénoncer, à juste titre, les responsabilités hégémoniques et ubiquitaires de l’impérialisme, du colonialisme, du capitalisme, ne revient-il pas à entériner une forme d’occidentalo-centrisme et à négliger d’autres mouvements historiques concomitants, à la fois du côté des dominants mais aussi des dominés ? Ne convient-il pas de restaurer des histoires alternatives, contradictoires, restaurant une dimension active chez les « subalternes », mettant l’accent sur la participation des marges, et venant infléchir ce qui, dans les discours officiels, tend à les enclore dans une forme de passivité et de soumission ? Révoltes, insurrections, autodétermination, dévoiements, luttes émancipatrices, mais aussi complicités, enjeux de pouvoirs, domination, oppression ? Ces histoires sont forcément entremêlées, plurielles, elles se construisent ensemble, dialectiquement, et opposer une version à une autre serait inévitablement vain et réducteur.
Par ailleurs, que faut-il penser de l’injonction suivante : mêlez-vous de vos oignons, vous n’avez pas le droit, ni la légitimité pour parler des autres, chacun doit s’occuper des siens ? Or, n’est-ce justement pas la vocation du Politique que de s’extraire de soi, pour essayer de parler au nom de tous, avec toutes les limitations et les réserves concernant cet idéal sans doute inatteignable ?
Une femme blanche ne devrait donc pas s’insurger des pratiques d’excision, de mariage forcé, de soumission des femmes dans d’autres cultures, car cela s’apparenterait à une forme de racisme condescendant ? Qu’elle s’occupe de son cul, elle n’a rien d’autre à dire…

Agrandissement : Illustration 2

En tant qu’homme privilégié, « oppresseur épistémique », je devrais systématiquement la boucler quand je reçois des familles issues de l’immigration, en situation de grande précarité, subissant des maltraitances instituées, sidérées par les traumatismes ? Je devrais respecter le mutisme, l’hébétude, l’incapacité à témoigner, pour ne pas faire violence et imposer ma coupable sollicitude – car, rappelons-le, je suis sans doute responsable de l’oppression que subissent ces personnes racisées ?
Seuls les représentants adoubés, identifiés à du même, à la même condition identitaire, aux mêmes discriminations systématiques, à la même histoire, au même vécu, pourront alors prendre la parole pour désigner les oppresseurs – car ce qui compte avant tout, au-delà des actions concrètes pour soutenir telle ou telle personne en souffrance, c’est de défendre la Cause, quitte à abraser les différences et les singularités, quitte à annuler au passage la réalité concrète et la subjectivité des individus agrégés à une identité collective imposée de l’extérieur.
Essayons tout de même de prendre un peu de recul et d’appréhender ces prises de position sur un mode réflexif…
Rappelons déjà qu’en ethnographie, patriarcat signifie « type d’organisation sociale où l’autorité domestique et l’autorité politique sont exercées par les hommes chefs de famille ». Il s’agit là d’un concept descriptif, sans dimension axiologique. Par ailleurs, les observations historiques et ethnologiques témoignent de la diversité des sociétés patriarcales, avec des spécificités et des différences notables concernant les modalités d’organisation de la prééminence du pater familias. Or, le discours actuel tend à affirmer l’existence d’un Patriarcat unifié et homogène, intrinsèquement affilié à la logique coloniale et capitaliste, niant ainsi les dynamiques socio-historiques ainsi que la distinction des phénomènes de domination en fonction des contextes.

Agrandissement : Illustration 3

A l’instar de Sibylle Gollac et de Céline Bessière, on peut, en première analyse, souligner que le capital a un genre, dans la mesure où les stratégies familiales de reproduction, de contrôle et de distribution du capital aboutissent à la dépossession des femmes et à l’appropriation masculine. Mais cette constatation ne risque-t-elle pas de dissimuler certaines dynamiques propres au capitalisme, en mettant exclusivement l’accent sur les inégalités sexistes, au détriment d’une prise en compte plus générale des processus d’exploitation, d’aliénation, d’extraction de plus-value, s’appuyant de façon opportuniste sur telle ou telle organisation sociale ?
Nonobstant, dans « Féminisme pour les 99% - un manifeste », Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya et Nancy Fraser insistent sur le « rôle indispensable joué par le travail non rémunéré et genré dans la société capitaliste ». Sans véritablement préciser les sources historiques et les évolutions socio-anthropologiques spécifiques, il est ainsi affirmé que « les sociétés capitalistes sont, intrinsèquement, la source d’oppressions de genre ». Ainsi, « le sexisme n’est pas accidentel, il est profondément ancré dans la structure même du capitalisme », qui aurait établi de nouvelles formes historiques de subordination des femmes, « des formes modernes et distinctes de sexisme, sous-tendues par des structures institutionnelles inédites ». De fait, « dans la société capitaliste, l’organisation de la reproduction sociale repose sur le genre : elle s’appuie sur des rôles genrés et entretient les oppressions de genre » en cherchant « à mettre le travail reproductif des femmes au service de la binarité de genre et de l’hétéronormativité ». Dès lors, « la violence de genre loin d’être accidentelle est enracinée dans la structure institutionnelle de la société capitaliste », et cette violence « est permise par un système de pouvoir hiérarchique qui se sert des identités de genre, de race et de classe pour asseoir sa domination ». « Sous le capitalisme, la violence de genre n’est pas une perturbation dans l’ordre des choses, mais une condition systémique (…). Elle est profondément enracinée dans un ordre social qui entrelace la subordination des femmes avec l’organisation genrée du travail et les dynamiques d’accumulation du capital ».
« Alors que le capitalisme réorganisait l’ensemble de la société, il a façonné de nouvelles normes de régulations bourgeoises – parmi lesquelles le binarisme de genre et l’hétéronormativité, approuvée par l’Etat ».
De surcroît, « pour des raisons systémiques, le capitalisme a toujours créé des classes racialisées d’êtres humains, au sein desquelles les personnes et le travail sont dépréciés et sujets à l’expropriation ». En conséquence, « rien de ce qui mérite le nom de « libération des femmes » ne peut s’accomplir dans une société raciste et impérialiste » et il convient de s’appuyer sur une forme « d’universalisme façonné par la multiplicité des luttes venant d’en bas ».
Par ailleurs, il conviendrait également de s’opposer à un « féminisme libéral », compatible avec les inégalités et externalisant les oppressions : « bien qu’il condamne les « discriminations » et prône la « liberté de choix », le féminisme libéral refuse catégoriquement de reconnaitre et de lutter contre les contraintes socioéconomiques qui empêchent pourtant la grande majorité des femmes d’accéder à la liberté et l’autonomie ».
Évidemment, on ne peut que souscrire à ces constats et revendications. Quelques bémols cependant : l’analyse du capitalisme manque singulièrement de perspective historique, négligeant notamment toutes les formes d’oppression et de violence antérieures ayant été « récupérées » dans sa dynamique propre, ainsi que les particularités territoriales, géographiques et culturelles. Ce type de discours en arrive même à faire imaginer que, dans les périodes historiques précapitalistes, il n’y avait pas de différenciation sociale et d’exploitation des catégorisations « identitaires » en termes de « gradients d’humanité ». En outre, cette analyse passe à côté du potentiel mutant et polymorphe du Capital, susceptible de révolutionner en permanence l’organisation des rapports sociaux et de se couler dans différentes superstructures idéologiques afin de perpétuer l’extraction généralisée de plus-value, en valorisant notamment de nouvelles différenciations identitaires. En effet, le Capital s’en fout de votre « identité », de votre genre, de votre orientation sexuelle, de votre origine, à partir du moment où il peut vous extorquer votre force de travail et accaparer vos investissements libidinaux. D’ailleurs, il peut même utiliser directement ces attributs identitaires afin d’optimiser les processus d’aliénation et d’auto-exploitation… Enfin, à la lecture de ce manifeste, on a parfois du mal à percevoir ce qui ferait la spécificité du féminisme par rapport aux luttes anticapitalistes moins « genrées ». Insister sur l’instrumentalisation des femmes dans les métiers du soin, de l’entretien, de la confection, de la reproduction sociale tend à invisibiliser l’exploitation masculine dans les métiers de l’industrie, de l’extraction, de la construction, de la livraison, de la protection, de la guerre, etc. Faut-il donc ériger des hiérarchies d’oppression, ou les appréhender ensemble, au-delà des différenciations sexistes exploitées par le Capital ? Outre ces profils différenciés en termes d’activité dans l’économie capitaliste, la spécificité de l’assujettissement féminin serait en rapport avec les capacités reproductives et la non reconnaissance, ou la non valorisation financière, de ce travail spécifique. D’une part on devrait plutôt revendiquer que certaines pratiques d’intérêt public - comme l’éducation, le soin, etc. - soient effectivement extraites de la logique de financiarisation capitaliste - avec en contrepartie une rémunération systématique et socialisée, l’ouverture de droits spécifiques - notamment en termes de retraite - et une reconnaissance collective à la mesure de l’importance primordiale de ces « tâches ». D’autre part, faudrait-il « libérer » les femmes de leur pouvoir de donner la vie et de garantir sa perpétuation pour les émanciper socialement ? La maternité est-elle inévitablement une aliénation, une instrumentalisation du corps féminin par le système capitaliste ?
Les femmes sont-elles, spontanément, voire « naturellement », plus exposées à la violence capitaliste, et/ou plus réfractaires et résistantes aux logiques d’exploitation ? Sont-elles intrinsèquement plus susceptibles de s’engager dans les luttes anticapitalistes ou écologistes ? Qui plus est si racisées ou appartenant à des minorités de genre ?
A l’évidence, il faudra approfondir ces questions ultérieurement…
Mais pour le moment, restons sur ces prises de positions militantes qui tendent à relier consubstantiellement le patriarcat, le colonialisme, et le capitalisme, non sans poser certaines questions épistémologiques voire éthiques... Ainsi, selon Françoise Vergès (« Un féminisme décolonial »), « le complexe racisme/sexisme/ethicisme imprègne toutes les relations de domination », dans un contexte de capitalisme post-colonial.
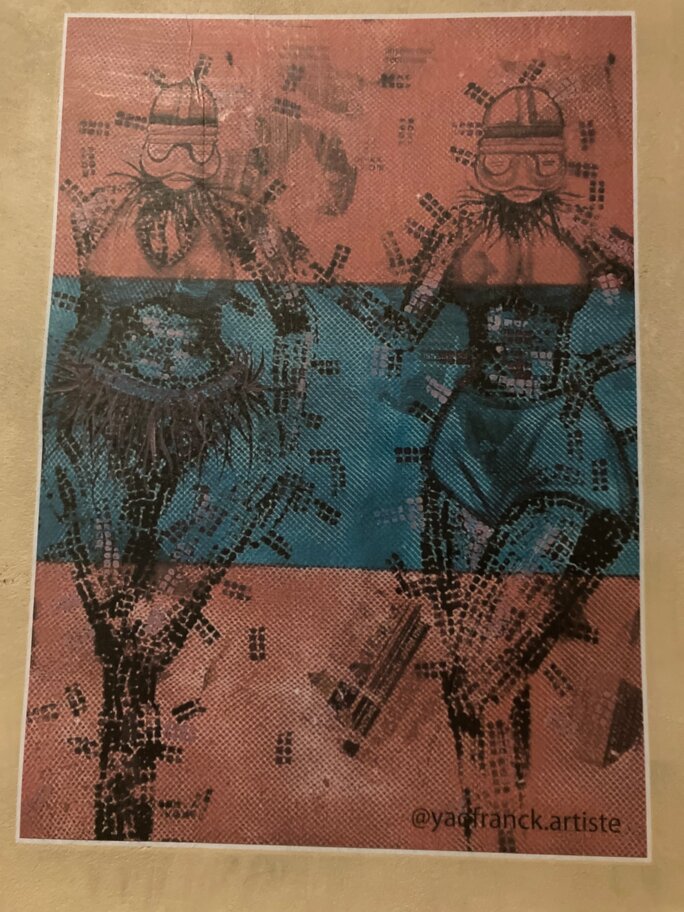
Agrandissement : Illustration 4
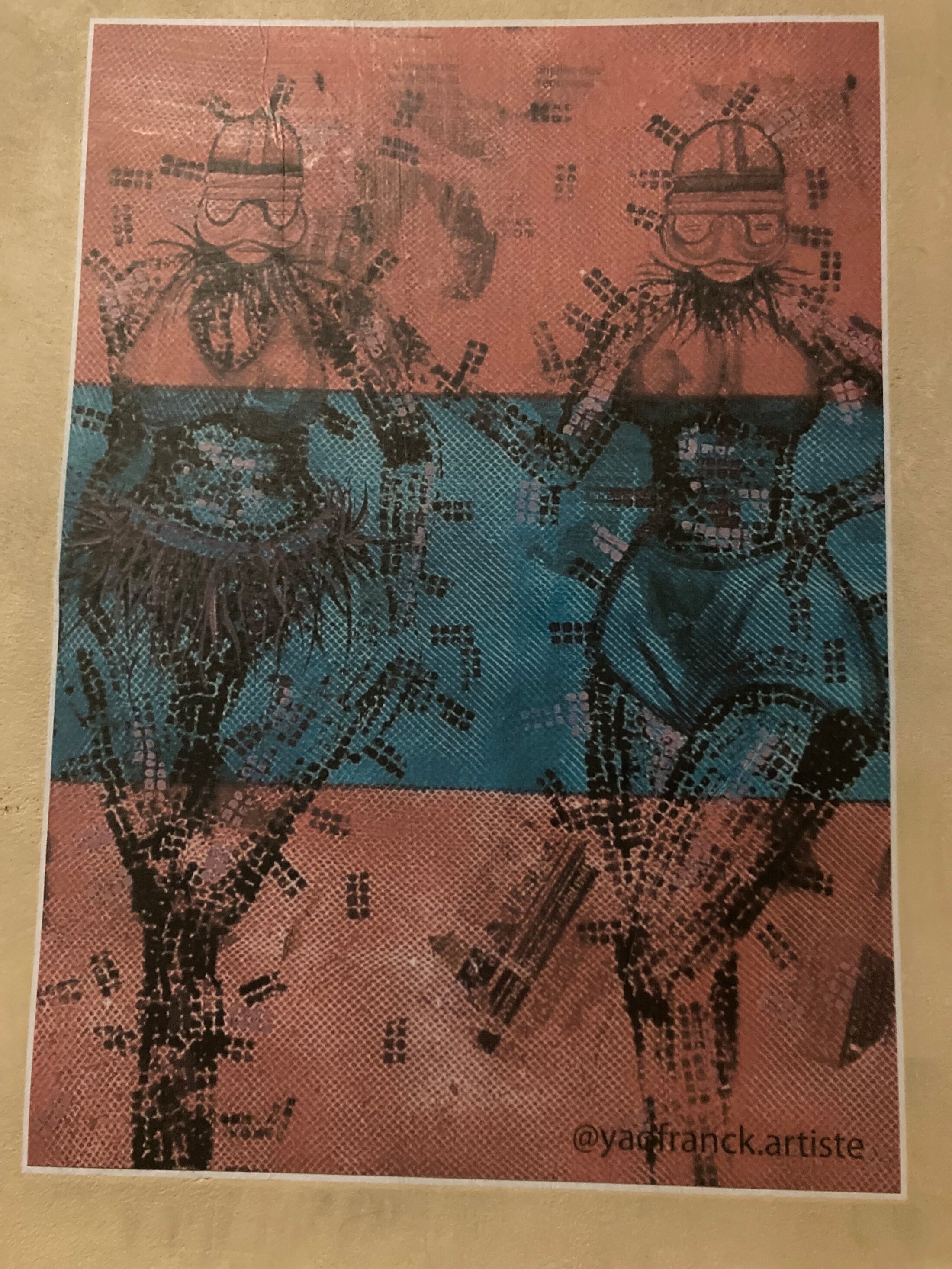
A l’évidence, certaines de ces analyses intersectionnelles s’avèrent tout à fait pertinentes et légitimes. Cependant, le manque de perspective historique, anthropologique, sociale, de prise en compte de la complexité des situations concrètes, tend à transformer le discours sur le mode d’une idéologie militante assez réductrice. Par exemple, « si le féminisme reste fondé sur la division entre femmes et hommes (une division qui précède l’esclavage), mais qu’il n’analyse pas comment esclavage, colonialisme et impérialisme agissent sur cette division – ni comment l’Europe impose sa conception de la division femmes/ hommes aux peuples qu’elle colonise ou comment ceux-ci créent d’autres divisions-, alors ce féminisme est raciste », point barre.... Reprenant Elsa Dorlin, Françoise Vergès considère de façon univoque que l’esclavage colonial constitue la « matrice de la race » et « relie l’histoire de l’accumulation des richesses, de l’économie plantationnaire et du viol (fondement d’une politique de la reproduction dans la colonie) à l’histoire de la destruction systématique des liens sociaux et familiaux et au nœud race/classe/genre/sexualité ». Dès lors, il y aurait un « tabou structurel », ou un antagonisme systémique, à ce que « les Blancs s’allient avec les Noir.e.s en raison de la division de l’espèce humaine entre celles et ceux qui sont des sujets et celles et ceux qui sont des objets ».
"Ralph Ellisson, dans un ouvrage célèbre, avait qualifié le Noir américain d’ « homme invisible ». Mais maintenant qu’il est devenu visible ? Cette nouvelle visibilité soudaine et grandissante qui le cache, en quelque sorte, en tant qu’individu ? Un étrange retour au point de départ. Le Noir américain était réduit à la couleur de sa peau parce qu’il était inexistant, et le voilà à présent réduit encore plus à sa couleur de peau parce qu’il se met à exister trop puissamment en tant que Noir" (Romain Gary, "Chien Blanc")
Effectivement, l’ampleur et l’organisation spécifique du colonialisme esclavagiste ont constitué une matrice socio-anthropologique tout à fait déterminante dans la structuration de l’imaginaire occidental. Cependant, en lisant ce genre d’affirmation, on a l’impression que la domination coloniale a émergé ex nihilo, sans antécédents ni précurseurs, et qu’elle a institué pour la première fois dans l’histoire des gradients d’humanité et des clivages entre différentes catégories d’êtres. C’est déjà oublier la traite transsaharienne, l’organisation du servage féodal, le système indien des castes, les « barbares » de l’antiquité. Dans l’Iliade, les femmes capturées lors des razzias font intégralement partie du butin, et la colère d’Achille se déploie parce qu’Agamemnon lui fait l’affront de réclamer sa captive, Briséis, en compensation de la perte de son esclave Chryséis, comme une vulgaire marchandise interchangeable. Les systèmes religieux ont également fait preuve d’un raffinement théologique inégalable pour définir des clivages entre les élus et les païens, justifiant tous les abus et instrumentalisation des infidèles, l'inquisition – ainsi que le rabaissement du féminin…Rappelons que la traite des esclaves s’est initialement étendue en Afrique pour aller « chercher » des populations non islamisées et donc marchandisables. Par ailleurs, est-il possible d'occulter la mémoire persistante des génocides (arménien, Tutsis), la terreur des khmers rouges, du régime stalinien et l'entreprise nazie d'extermination systématique ?...
A mon sens les notions de « racisés », de « blanchité », perdent toute dimension heuristique si elles sont appréhendés comme des catégories figées, qui viennent totalement annihiler la possibilité même de parcours singuliers et subjectivants, ou la prise en compte des enjeux concrets et incarnés. Là, c’est une assignation définitive qui semble alors se déployer, indépendamment des contextes, des actes, des particularités. Pourtant, Françoise Vergès peut aussi reconnaître que « les analyses les plus éclairantes et productives ont d’ailleurs été celles qui ont tiré le plus grand nombre de fils pour mettre ne lumière les réseaux d’oppression concerts et subjectifs qui tissent la toile de l’exploitation et des discriminations ». Et par ailleurs, elle s’insurge face à l’essentialisation du féminin : « l’argument essentialiste d’une nature féminine qui serait plus à même de respecter la vie et de désirer une société juste et égalitaire ne tient pas, les femmes ne constituent pas ni spontanément ni en elles-mêmes une catégorie politique ». Mais pourquoi alors réaffirmer d’autres identités closes, totalement déterminées et paraissant assez inamovibles ?
On peut certes dénoncer que « les droits des femmes sont devenus une arme idéologique au service du néolibéralisme », mais pourrait-on aussi penser qu’un certain identitarisme racialisé constitue également une dérive susceptible d’être récupéré et instrumentalisé politiquement, sans forcément s’inscrire comme émancipateur ? La prise en compte des facteurs d’oppression susceptibles de favoriser l’émergence des violences, notamment sexistes, doit-elle amener à relativiser ces dernières lorsqu’elles sont le fait de personnes « racisées » ? Ainsi, François Vergès en arrive-t-elle à interroger « la condamnation moraliste de la domination masculine dans les communautés noires par le féminisme civilisationnel » ; du fait de la perpétuation de la violence coloniale, il ne faudrait donc plus condamner la maltraitance de certaines femmes, car celle-ci serait déterminée par le racisme systémique ? On doit certes s’indigner d’une certaine « impunité » et du laxisme des institutions judiciaires concernant certains agresseurs sexuels privilégiés. Cependant, les coercitions, les agressions, les viols, les féminicides doivent-ils devenir excusables quand ils émanent d’hommes « racisés », quand bien même on pourrait certes y trouver certaines circonstances favorisantes ?...
"Les militants veulent annexer les criminels et capitaliser leurs actes dans des buts politiques, comme les anarchistes du XIXème siècle voyaient dans tout crime une manifestation de rébellion sociale. Tout gangstérisme est baptisé « terrorisme ». Chaque Noir qui viole une Blanche se venge idéologiquement"
"On ne peut tout de même pas toujours tout rejeter sur la société. Il y a des moments où vous êtes un salaud pour votre propre compte"
(Romain Gary, "Chien Blanc")
Faut-il mettre en concurrence la légitimité des causes, hiérarchiser les traumatismes et les abus, quitte à en dénier certains ? Au nom des luttes stratégiques, faut-il entretenir des clivages essentialisés entre dominants / dominées, sans prendre en compte les multiples occurrences de la violence et des discriminations ?
Nous reviendrons plus longuement sur cette problématique « identitaire », ainsi que sur les tendances à catégoriser et à essentialiser. En attendant, à titre personnel, je préfère en rester sur ce « slogan » : « la justice pour les femmes signifie la justice pour tous », en abordant concrètement les situations vécues.
A l’instar de bell hooks, se décrivant comme socialiste et féministe révolutionnaire, ne convient-il pas d’aborder l’oppression à travers la déconstruction de contextes socio-historiques particuliers, complexes, hétérogènes, plutôt que de dénoncer l’existence d’un système monolithique de domination ?
Comme le souligne Estelle Ferrarese, « avant ‘l’intersectionnalité’ de Kimberlé Crenshaw (1989), avant ‘les systèmes d’oppression imbriqués’ et ‘la matrice de la domination’ de Patricia Hill Collins (1990), bell hooks a parlé d’interconnectivité des oppressions de sexe, de race et de classe (inter-relatedness of sex, race and class oppression) (1984). Dès "Ain’t I a Woman", son premier livre (1981), elle déploie une conception des rapports entre genre, race et classe qui ne suppose pas des catégories préexistantes qui s’influenceraient par la suite mutuellement, mais qui interroge les processus de leur co-construction ». Dès lors, il convient de comprendre que les « victimes » sont parfois complices de leurs oppressions, ou responsables de celle des autres. Et, en conséquence, au-delà des effets structurels et socio-politiques, la réintroduction des affects, des ressentis psychiques et de l’éthique parait indispensable. De fait, « le sexisme, comme le racisme, résultent d’intentions et de stratégies malveillantes ; ils sont d’abord une faute morale ».
Dans son texte « Sororité : la solidarité politique entre les femmes », bell hooks revendique ainsi une solidarité qui ne naitrait pas uniquement de la prise de conscience d’une assignation commune, ou d’une communauté d’intérêt a priori. Au contraire, l’impératif serait davantage du côté d’une transformation à opérer, d’un dépassement de l’expérience collective de souffrance partagée. La lutte et l’engagement politique devraient donc prendre la place d’une condition victimaire en tant que vecteur de subjectivation et d’émancipation. Ce qui suppose de faire face aux conflits, aux antagonismes, aux divergences. Il faut évidemment s’opposer aux dominations instituées, mais aussi mener un combat contre soi et ses propres évidences : c’est seulement en affrontant « les ennemis intérieurs », les colonisations oppressives intériorisées, qu’il devient possible de libérer les relations de leurs caractères oppressifs...
De surcroit, ces engagements ne peuvent se déployer sans une certaine « éthique de l’amour », en tant que pratique de la liberté et souci de l’oppression qui affecte d’autres êtres que nous-mêmes. Ce que nous approfondirons ultérieurement…

Agrandissement : Illustration 5

Analysons à présent le discours de Paul B. Preciado (« Je suis un monstre qui vous parle » ), tenu devant une assemblée de psychanalystes de l’Ecole de la Cause Freudienne – vis-à-vis desquels il serait tout à fait improbable de ne pas être « subversif »…
Marquons tout d’abord nos points d’accord sur certaines positions, comme par exemple le fait de ne pas prendre pour acquis l’existence naturelle de la masculinité et de la féminité, l’ « abandon de la féminité » comme « stratégie fondamentale du féminisme », la déconstruction de la « parodie de la différence sexuelle » et le besoin de trouver des perspectives émancipatrices face à cette taxonomie mutilante.
En effet, « derrière les masques de la féminité et de la masculinité dominantes, derrière l’hétérosexualité normative, se cachent en fait de multiples formes de résistance et de déviance ». Il suffit pour s’en convaincre d’appréhender les constructions culturelles et historiques du genre – même si tous ces gradients non binaires vis-à-vis de la « sexuation » ne constituent pas forcement une subversion, et peuvent être tout à fait intégrés dans un ordre social les ayant institués.
A l’instar de Preciado, revendiquons le fait de ne pas savoir ce qu’est un homme et une femme, un homosexuel et un hétérosexuel, extrayons-nous des grilles, afin de pouvoir expérimenter, percevoir, ressentir, autrement, en dehors des normes de la différence sexuelle hétéronormative.
Cependant, faut-il nécessairement « faire une transition » afin de « comprendre que les codes culturels de la masculinité et la féminité sont anecdotiques comparés à l’infinie variation des modalités de l’existence » ?
Certes, « le régime de la différence sexuelle (…) n’est ni une nature ni un ordre symbolique, mais une épistémologie politique du corps et, comme tel, il est historique et changeant ». Cependant, faut-il penser que la Psychanalyse serait par essence complice de cette « épistémologie de la différence sexuelle hétéronormative », qu’elle fonctionnerait de façon univoque « comme une technologie de gestion de l’appareil psychique « enfermé » dans l’épistémologie patriarcale et coloniale de la différence sexuelle », en rendant notamment « la victime responsable du viol et en transformant en loi psychique les rituels sociaux de normalisation du genre » ? Il faudra évidemment revenir sur ces enjeux, avec l’idée que ce n’est surement pas à coup de caricatures et d’assertions à l’emporte-pièce, sans nuance ni complexité, qu’on pourra faire avancer le débat…
Pour Preciado, « cette épistémologie (qui se cristallise dans la seconde moitié du XIXème siècle), loin d’être la représentation d’une réalité, est une machine performative qui produit et légitime un ordre politique et économique spécifiques : le patriarcat hétéro-colonial ».
Ainsi, la différenciation sexuelle hétéronormative se serait cristallisée très récemment dans le monde occidental, en rapport avec l’émergence du capitalisme colonial…Cela demanderait sans doute des approfondissements anthropologiques et historiques un peu plus développés…. Mais Preciado nous affirme, sans ambages, que « les historiens de la science et de la société de la Renaissance s’accordent aujourd’hui pour admettre qu’au Moyen Âge et probablement jusqu’au XVIIème siècle, une épistémologie « mono-sexuelle » dominait en Occident, où seul le corps masculin et la subjectivité masculine étaient reconnus comme anatomiquement parfaits » - Aphrodite et Hélène de Troie peuvent aller se rhabiller...Il me semble que c’est sans doute aller un peu vite en besogne, et que ce schéma associant de façon consubstantielle capitalisme / colonialisme / patriarcat / différenciation sexuelle / racisme me parait un peu simpliste, pour ne pas dire très idéologique – même si, dans le fond, j’aimerais profondément pouvoir y adhérer, car il suffirait alors de renverser l’ordre capitalisto-impérialiste pour détricoter dans le même mouvement la domination masculine et la xénophobie…Selon Preciado, il a fallu trois siècles de « changements économiques, politiques et technologiques » pour conduire « au régime de la différence sexuelle » - l’histoire antérieure, les différences culturelles, géographiques, l’hétérogène, sont ainsi ravalées d’un revers de la main…
Dans ce même élan, Rachele Borghi nous propose de son côté un résumé tout à fait saisissant de l’histoire occidentale moderne, qui vous épargnera d’avoir à lire les travaux approfondis des historiens, captifs de leurs cages épistémiques : « le mélange des ingrédients de la modernité – capitalisme, colonialisme, savoir, rapports de domination – a permis de préparer un gâteau appelé civilisation, le tout cuit dans le four de la colonialité. Le liant a été le racisme » …Diantre, avant l’impérialisme de l’homme blanc, le monde n’était visiblement qu’un paradis, sans exploitation, sans esclavage, sans sexisme, sans gradients d’humanité…Et puis, au passage, il faut bien escamoter les mouvements révolutionnaires, les luttes pour l’émancipation, les Lumières, la liberté d’expression, l’interdiction par la loi du racisme et des discriminations, la pensée critique, etc. « La colonialité a produit les savoirs, les pouvoirs et les existences », circulez, tout est dit ! Ainsi, la violence coloniale est une dimension intrinsèque de la modernité émancipatrice, qui n’est autre qu’« une saumure versée dans un bocal (le système-monde), fermé par un couvercle (la violence et la répression) dans lequel nous sommes tous.tes (les cornichons) entièrement immergé.es. Ce liquide de conservation permet de maintenir les cornichons en l’état, avec les privilèges et les oppressions qu’ils portent avec eux ». Plus besoin de se pencher sur les situations concrètes, de s'indigner concernant l'abandon des schizophrènes à la rue, la maltraitance dans l'organisation capitaliste du travail, la tyrannie exercée par le régime des Talibans, l'exploitation "esclavagiste" des travailleurs au Qatar, l'oppression des Ouïgours ou des Rohingyas...Pour évaluer le degré de domination répressive, il suffit désormais de mesurer le taux de blanchité, plus ou moins pondéré par le genre et l'orientation sexuelle....Un petit tour de passe-passe et la réalité se voit donc déshistoricisée, dépolitisée, en faveur d'une grille interprétative univoque, qui a l'avantage de ne pas aborder les enjeux spécifiques et complexes de l'aliénation - et qui permet donc de les occulter....
Dès lors, pour en revenir au plaidoyer de Preciado, dans notre modernité, les femmes ne sont plus que des objets dont les hommes doivent être « accompagnés pour exercer une fonction reproductive et hétéro-consensuelle ». Autant dire que l’amour, le désir hétérosexuel, l’épanouissement dans la vie de couple et familial ne peuvent donc être que des discours factices, normés, imposés collectivement pour garantir l’assujettissement à l’ordre dominant. En somme, si vous éprouvez ce genre de ressentis, c’est que vous êtes terriblement aliénés à l’hégémonie du patriarcat hétéro-colonial – si en plus vous êtes un peu psychanalyste sur les bords, c’est que vous êtes un véritable gardien de l’ordre.
De fait, comment comprendre que les femmes, fatalement « assujetties, violées, assassinées, doivent aimer et consacrer leurs vies à leurs oppresseurs, les hommes hétérosexuels » ? Alors même qu’« il n’y a pas d’organes sexuels mais des enclaves coloniales de pouvoir » ? Faire l’amour hétérosexuellement, qui plus est avec le désir d’un « rapport fécondant », est donc une reproduction, une condensation dans l’intimité, de la structure patriarco-colonial….De fait, voilà ce qu’affirme Preciado : « je ne crois pas que l’hétérosexualité soit une pratique sexuelle ou une identité sexuelle, mais, comme Monique Wittig, un régime politique qui réduit la totalité du corps humain vivant et son énergie psychique à son potentiel reproducteur, une position de pouvoir discursive et institutionnelle ». Ainsi, « l’institutionnalisation normalisée de la famille hétérosexuelle » va de pair avec l’extension d’une économie de marché mondialisée et impérialiste, avec une biopolitique de la population nationale, « avec des pratiques de segmentation des classes, de hiérarchisation sexuelle, de ségrégation raciale et de nettoyage ethnique ». Pensez donc à tout ce que vous « valider » en produisant des enfants, ou en « acceptant » votre assignation sexuée…
Voilà d’ailleurs ce que pouvait affirmer Monique Wittig dans « La pensée straight » : « La catégorie de sexe est une catégorie totalitaire qui, pour prouver son existence, a ses inquisitions, ses cours de justice, ses tribunaux, son ensemble de lois, ses terreurs, ses tortures, ses mutilations, ses exécutions, sa police. Elle forme l’esprit tout autant que le corps puisqu’elle contrôle toute la production mentale. Elle possède nos esprits de telle manière que nous ne pouvons pas penser en dehors d’elle. C’est la raison pour laquelle nous devons la détruire et commencer à penser au-delà d’elle si nous voulons commencer à penser vraiment, de la même manière que nous devons détruire les sexes en tant que réalités sociologiques si nous voulons commencer à exister ». Ainsi, la Femme est une pure création du système oppressif de « l’hétérosexualité obligatoire » et l’homosexualité devient un choix politique cherchant à renverser cet ordre. Il faut donc prôner le même, car l'altérité est intrinsèquement complice de la domination et vectrice de discrimination.
« La société hétérosexuelle est fondée sur la nécessité de l’autre-différent à tous les niveaux (…). Or, qu’est-ce que l’autre-différent sinon le dominé ? »
D’après cette épistémologie particulière, il suffirait donc de s’extraire des normes hétéronormatives pour que l’édifice du capitalisme patriarco-colonialiste s’effondre tel un château de carte…Il suffirait, selon Preciado, de passer « de la « différence sexuelle » (une opposition binaire, peu importe qu’elle soit pensée comme dialectique ou comme complémentaire, comme dualité ou comme duel) à un nombre interminable de différences, des corps et des désirs non identifiés et non identifiables » pour court-circuiter le système…Proliférer dans les pratiques et les formes de vie, multiplier les désirs, inventer des « subjectivités dissidentes face à la norme », seraient des conditions nécessaires et suffisantes pour s’extraire de l’aliénation capitaliste….Car, « c’est la violence épistémique du paradigme de la différence sexuelle et du régime patriarco-colonial qui est remise en question par les mouvements féministes, anti-racistes, intersexuels, trans et handi-queer demandant une reconnaissance en tant que corps vivant de plein droit de ceux et celles et cels qui avaient été marqués comme politiquement subalternes ». A nouveau j’aimerais vraiment pouvoir y croire : la transidentité comme facteur de renversement de l’ordre capitaliste ; mais je ne suis malheureusement pas sûr que ce postulat puisse tenir face à une analyse théorique plus approfondie et rigoureuse ou en prenant en compte la réalité des situations concrètes.
D’ailleurs, quand Preciado revendique une « invention d’autres modalités d’existence entre l’organisme et la machine, le vivant et le non-vivant, l’humain et le non-humain », où se situe la frontière avec une forme de transhumanisme néolibérale totalement débridée ?

Agrandissement : Illustration 6

Et puis, rappelons tout de même que Preciado, outre ses « coups médiatiques » retentissants, a pu par exemple participer à un court métrage promotionnel dans le cadre du lancement du Gucci Fest, enseigne capitaliste entretenant manifestement des rapports de domination et d’exploitation, à commencer par les processus de production dans les usines délocalisées...Comme le souligne Miquel Martínez, « l’auteur a-t-il quelque chose à dire sur les relations d’asymétrie, au sens néocolonial, que ce type de géant commercial établit habituellement avec les pays dans lesquels il installe sa production, afin d’obtenir le plus grand profit possible ? ». Dès lors, peut-on imaginer que « quelques minutes de théorie queer dans un court-métrage de Gucci ne puissent servir qu’à nourrir l’hydre capitaliste, facilitant ainsi le dispositif néolibéral, mis en place pour contrôler la vie dans son ensemble, pour apparaître avec un certain visage humain, respectueux de (presque) toute expression dans le domaine de la sexualité et, en définitive, tolérant de la valeur de la diversité ? ». Au-delà de la vitrine rhétorique de la visibilisation ou de la subversion de l’intérieur, n’y-at-il pas là une forme de démonstration de la capacité du capitalisme néolibéral à « récupérer » certaines formes de transgression ?
A travers ce panorama - ou ce catalogue fastidieux…-, certaines questions ont commencé à être effleurées et laissées en suspens. Je souhaiterais dorénavant pouvoir les approfondir, en abordant quelques situations concrètes, avant d’essayer de proposer une réflexion plus théorique, au-delà du féminisme intersectionnel
A suivre donc…
« Le monstre c'est toi
Le monstre c'est moi
(…)
Bien trop souvent c'est celui que tu ne connais pas »
Aldebert



