En dépit d’une propagande triomphaliste concernant la prescription de psychostimulants chez les enfants hyperactifs, il serait pour le moins légitime de prendre en considération les alertes émanant d’instances indépendantes, tout en appréhendant les enjeux idéologiques, socio-politiques et économiques sous-jacents… En janvier 2022, suite à l’élargissement des prescriptions initiales à des spécialistes de ville, la revue indépendante « Prescrire » soulignait déjà la tendance inquiétante à la surmédicalisation des troubles déficitaires de l’attention avec hyperactivité. Or, l’efficacité symptomatique du traitement par psychostimulant « est au mieux modeste chez les enfants et les adolescents, tandis que ses effets indésirables sont parfois graves : troubles neuropsychiques (hallucinations, anxiété, comportements suicidaires) ; troubles du rythmes cardiaque, morts subites, valvulopathies, hypertensions artérielles pulmonaires ; retards de croissance ». En septembre 2024, la revue alertait à nouveau : le méthylphénidate augmente considérablement l'occurrence de troubles cardio-vasculaires et notamment d’hypertension artérielle. Selon une étude réalisée à partir de registres suédois de données de santé, le risque de troubles cardio-vasculaires augmente avec la durée de l’exposition : pour une durée de 3 à 5 ans, la probabilité a été majorée d’environ 30%. Et le risque d’hypertension artérielle parait doublé au-delà de 5 ans d’exposition.
L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) répertorie également les effets indésirables suivants : troubles du sommeil, amaigrissement, risques d’aggravation de pathologies psychiatriques et de passages à l’acte violents ou suicidaires, risques avérés de maladies cardiovasculaires et cérébro-vasculaires, mort subite d’origine cardiaque, infarctus du myocarde aigu, et accident vasculaire cérébral. Des cas d’infarctus du myocarde sous psychostimulant ont effectivement été documentés aux États-Unis…De surcroit, les effets indésirables de long terme sont largement méconnus, a fortiori dans le cas de prescriptions particulièrement longues et de poly-prescriptions de médicaments psychotropes.

Agrandissement : Illustration 1

Cependant, le diagnostic de Trouble Déficit de l'Attention avec Hyperactivité (TDAH) peut véritablement devenir un enjeu stratégique sur un plan individuel, favorisant sa diffusion au-delà de conditions pathologiques avérées : outre les bénéfices en termes de reconnaissance officielle et de droits à des aménagements spécifiques pour les épreuves académiques - notamment l'éventualité d'un tiers temps supplémentaire - les traitements psychostimulants sont aussi exposés à des usages détournés en tant que "dopant" des performances scolaires et sportives. Ainsi, sur les campus américains, les étudiants revendiquent de se faire diagnostiquer pour avoir accès légalement à des traitements stimulants comme l’Adderall - les autres pouvant également se fournir sur un marché illégal de redistribution….Les prescriptions ne cessent donc d'augmenter, notamment via le recours à la télémédecine. Ce traitement amphétaminique, qui n'est pas disponible en France, présente pourtant des effets secondaires graves. Selon une étude publiée dans l'AmericanJournal of Psychiatry, les personnes prenant des doses élevées de ce stimulant courent un risque très significativement accru de développer une décompensation psychotique ou maniaque... Ainsi, les consommateurs d'Adderall sont 2,68 fois plus susceptibles d’être hospitalisés pour une trouble de ce type- et cette probabilité passe à 5,28 fois pour des doses plus élevées (40 milligrammes et plus).
Rappelons par ailleurs que les agonistes dopaminergiques, prescrits dans le cadre de la maladie de Parkinson, présentent des risques iatrogènes de plus en plus documentés : «comportements inadaptés, addiction aux jeux d’argent, achats compulsifs, hypersexualité, troubles du contrôle des impulsions, voire pulsion de cruauté »...Évoquons également les effets parfois mortels de molécules ayant des effets amphétaminiques pour traiter le diabète de type 2 associée à une surcharge pondérale...
Certes, les psychostimulants utilisés en France dans l’hyperactivité ont d’autres modalités d’action, en inhibant la réabsorption de la dopamine, et ne sont pas des agonistes directs…Mais la prudence ne doit-elle pas rester de mise, qui plus est pour des traitements commencés dès l’enfance, sans limitation de durée ? Quels sont les effets à long terme d’une telle prescription chronicisée et initiée en plein phase de développement cérébral ? Quelles répercussions sur le plan physiologique, mais aussi en termes de construction identitaire et de subjectivation ?
Un principe de précaution bien tempéré ne devrait-il pas être de mise, lorsqu’il s’agit d’introduire des psychotropes de façon pérenne en population infantile ? La décroissance médicamenteuse, une posture de sobriété et de parcimonie prescriptive ne s’imposent-elles pas, tant sur le plan clinique qu’éthique ?
Rappelons-nous les scandales sanitaires en rapport avec les effets iatrogènes parfois meurtriers de certains médicaments, ayant pu conduire à des procès retentissants, en France ou ailleurs : Vioxx°, Mediator°, opioïdes, etc. Et la liste est longue, dans l’histoire pharmaceutique, avec des effets d’après-coups et la nécessité d’appréhender des temporalités élargies, comme en témoigne l’affaire du diéthylstilbestrol (DES) : aux États-Unis à partir de 1971, des dizaines de cas de cancers ont été diagnostiqués chez des jeunes femmes, associés à la prescription de cette molécule pendant la grossesse de leurs mères….
En ce qui concerne les psychotropes, rappelons le scandale du Zyprexa, antipsychotique de deuxième génération, pour lequel la stratégie marketing agressive du Laboratoire Lilly avait notamment caché des risques connus et graves sur le plan métabolique et cardio-vasculaire…Évoquons aussi les risques inhérents à la prescription d’antidépresseurs chez les adolescents, avec une augmentation significative des passages à l’acte suicidaire…Or, en 2023, 936 000 jeunes de 12 à 25 ans, dont 62% de filles, auraient « bénéficié » d’une prescription d’au moins un psychotrope, soit une hausse de 18% par rapport à 2019. Le mal-être des jeunes conduit de plus en plus à une surenchère en termes de recours à des traitements psychotropes, sans aucune précaution. De surcroit, cette irrigation médicamenteuse tend à colmater les facteurs collectifs impliqués dans la souffrance infantile et adolescente…
En tout cas, les drames humains liés à la iatrogénie de certains médicaments constituent aussi des scandales de santé publique, mettant en cause des acteurs puissants, économique et politique, tels que les firmes pharmaceutiques, les agences du médicament, mais aussi certains intérêts « scientifiques », associatifs, etc. Au-delà des molécules ayant été incriminés directement en termes de morbi-moralité de leurs victimes, il existe aussi une iatrogénie médicamenteuse plus ordinaire, insidieuse, invisibilisée. Dès lors, toute prescription devrait être dirigée par un souci spécifique, en évaluant rigoureusement la balance bénéfices / risques, et en restant attentif à ne pas nuire.
Or, pour en revenir à la prescription de psychostimulants chez les enfants diagnostiqués TDAH, l’utilité attendue de la médication est tout à fait contestable sur la durée. De fait, les effets portent surtout sur une normalisation comportementale à court-terme, certes indéniable, alors même que, selon plusieurs études américaines, le traitement par psychostimulants ne présente aucun bénéfice à long terme concernant les risques d’échec scolaire, de délinquance et de toxicomanie associés au TDAH. Outre-Atlantique, de larges méta-analyses[1] démontrent depuis déjà plusieurs années que les effets sur la scolarisation sont au mieux très modestes, voire inexistants en termes de performances scolaires, de délinquance, au-delà des symptômes purement comportementaux. A long terme, les enfants diagnostiqués comme souffrant de TDAH réussissent moins bien à l’école, et les psychostimulants n’améliorent pas leurs trajectoires scolaires…

Agrandissement : Illustration 2

Ainsi, les traitements psychostimulants n’auraient pas d’incidence significative à longue échéance sur la qualité de vie. Dès lors, il s’agit véritablement d’une médication normalisatrice, visant à réduire l’impact de symptômes mal tolérés par l’environnement, sans bénéfices réels sur le devenir de l’enfant…D’autres études[2] repèrent même une dégradation du bien-être sous traitement, avec une absence d’amélioration du parcours scolaire ou des risques de décrochage prématuré, voire une dégradation du plaisir à vivre…
Certes, les évaluations à court terme, purement symptomatiques, confirment un impact positif concernant la réalisation de tâches répétitives, sans intérêt intrinsèque – avec cependant des effets d’accoutumance et d’essoufflement. Mais, il n’y a pas d’amélioration significative et persistante des capacités d’apprentissage complexes, ou de la motivation et du plaisir à mobiliser sa pensée…
Je recevais récemment un adolescent, qui refusait régulièrement de prendre son traitement, prescrit par un éminent spécialiste ; certes, celui-ci réduisait incontestablement ses débordements comportementaux mais, en contrepartie, ce jeune ressentait de la morosité, de la monotonie, voire une forme d’anesthésie affective. Plutôt s’agiter que d’être ainsi abrasé, revendiquait-il.
Et que penser de cet autre qui, en douce, jetait tous ses cachetons aux toilettes, alors même que ces parents se félicitaient des effets tout à fait remarquables du traitement. De fait, par son opposition, il avait manifestement contribué à s’affirmer sur le plan subjectif….
De surcroit, certaines études, déjà anciennes, concluent à une nette supériorité des interventions psychothérapeutiques par rapport à l’administration de psychostimulants, par exemple :
- Conners C. K., Epstein J. N., March J. S., Angold A., Wells K. C., Klaric J., et al. (2001). Multimodal treatment of ADHD in the MTA : An alternative outcome analysis. [Traitement multimodal du TDAH dans le MTA : Analyse d’un résultat alternatif.] J. Am. Acad. Child. Adolesc. Psychiatr. 40 : 159-67, ou encore
- Döpfner M., Lehmkuhl G. (2002). Evidenzbasierte Therapie von Kindern und Jugendlichen mit Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). [Thérapie basée sur les preuves du TDAH chez les enfants et les adolescents.] Prax. Kinderpsychol. inderpsychiat. 51 : 419-40.
Un article récent de février 2024[3] paru dans la revue médicale de référence The Lancet rappelle qu’un comité d’experts de l’OMS a refusé d’accorder au méthylphénidate le statut de médicament essentiel, du fait de manque de preuves d’efficacité concluantes, d’un risque élevé de biais ou de données incertaines dans une proportion importante d’études, et d’effets indésirables préoccupants…. « D’autres études ont montré que lorsqu’il existe des différences de résultats à long terme, les enfants sous stimulants (comme le méthylphénidate) ont souvent des résultats pires que ceux qui n’en prennent pas, indépendamment de la gravité initiale, avec des problèmes physiques (par exemple, la pression artérielle), psychiatriques (par exemple, les troubles de l’humeur) et académiques plus fréquents ».
Au fond, le modèle purement biomédical du TDAH est de plus en plus décrié, du fait notamment de l’inconstance des résultats provenant des études génétiques. Ainsi, l’étude sur le génome citée par la HAS dans ces dernières recommandations (Demontis – 2019) ne rapporte qu’une héritabilité de 21 %, selon la méthode du « Single Nucleotide Polymorphism ».
Dès lors, l’influence du déterminisme génétique est maintenant considérée comme mineure par rapport à celle de l’environnement. Les dysrégulations neurobiologiques sont sans doute complexes, surdéterminées, et très influencées par des facteurs exogènes. Par exemple, de nombreuses études soulignent la vulnérabilité des mécanismes attentionnels chez les enfants issus de milieux défavorisés. Or, selon François Gonon, « ces différences peuvent correspondre à une adaptation cérébrale compensant une autre difficulté ou même un processus de développement différent du normal, désavantageux en situation scolaire mais pas forcément dans d’autres conditions ».
Nonobstant, les recommandations actuelles évacuent toute autre approche, contribuant notamment à négliger les effets d’environnement, et la complexité des déterminismes en jeu.
Les études épidémiologiques ont mis en évidence des facteurs de risque multiples et hétérogènes, associant des éléments constitutionnels et des interactions environnementales précoces : héritabilité d’une vulnérabilité génétique (polygénique et avec une faible pénétrance), retard de croissance intra-utérin, facteurs obstétricaux (hypoxie périnatale), tabagisme gestationnel, carences affectives, difficultés relationnelles familiales, précarité sociale… Les études de liaison retrouvent des marqueurs significatifs dans la petite enfance (faible poids de naissance, retard du développement psycho-moteur…) corrélés avec l’apparition ultérieure d’un TDAH. On observe ainsi une intrication étroite entre de nombreux facteurs de risque conjugués, certains inhérents à l’enfant (génétiques, neurobiologiques) d’autres liés à l’environnement…et potentiellement sensibles à des interventions prophylactiques, comme par exemple des politiques de réduction des inégalités et de la précarité...
Comme le relais pourtant « Le Monde », citant Mme Nathalie Franc, pédopsychiatre au CHU de Montpellier : « Le TDAH est un trouble médical, comme l’hypertension, et il n’y a pas de place pour le bla-bla » … Point final ! Exemple intéressant : rappelons tout de même les polémiques médicales en rapport avec le recours de plus en plus sytématique aux traitement antihypertensifs, alors même que, sur un plan de santé publique, l'hypertension est liée à un certain mode de vie et de consommation...Les médicaments sont-ils là pour traiter les externalités négatives du capitalisme néolibéral et permettre au système de ne pas s'infléchir ?....
Dès lors, même si on adhérait aveuglément à ce réductionnisme assez pathétique, cela ne devrait pas systématiser le recours à la prescription en population infantile.
En effet, il conviendrait de privilégier des approches préventives, prenant en compte les « écosystèmes attentionnels », les facteurs de risque, les conditions d’exposition qui contribuent à détériorer l’attention.
Or, les recommandations préconisent au contraire de médicaliser à outrance des problématiques relationnelles, affectives, sociales, etc. ; voire même l’immaturité infantile relative. En effet, une vaste étude menée par le GIS Epi-Phare (ANSM-Cnam) évaluant l’effet de l’âge relatif sur l’initiation d’un traitement par méthylphénidate vient de mettre en évidence que, parmi les enfants d’un même niveau scolaire, les natifs de décembre ont 55% de risque supplémentaire de débuter une médication. Il existe donc un biais de diagnostic à l’encontre des enfants les plus jeunes… Chez les enfants d'un même niveau de scolarité, l’initiation de méthylphénidate augmentait régulièrement et fortement selon le mois de naissance. Comparés aux enfants nés en janvier, les natifs de février ont 7% de risque supplémentaire de se voir prescrire du méthylphénidate, ceux d’avril 9%, ceux de juillet 29%, ceux d’octobre 46% et ceux de décembre 55%.
Dans cette opération de médicalisation, tous les enjeux relationnels, éducatifs, sociaux, l’influence des « perturbateurs développementaux », les conditions d’environnement, les conséquences concrètes de certaines orientations politiques sur les dynamiques familiales et sur l’investissement du lien aux enfants, le délitement des institutions collectives d’accueil infantile, la précarité des conditions d’existence, etc., se trouvent totalement occultés.

Agrandissement : Illustration 3
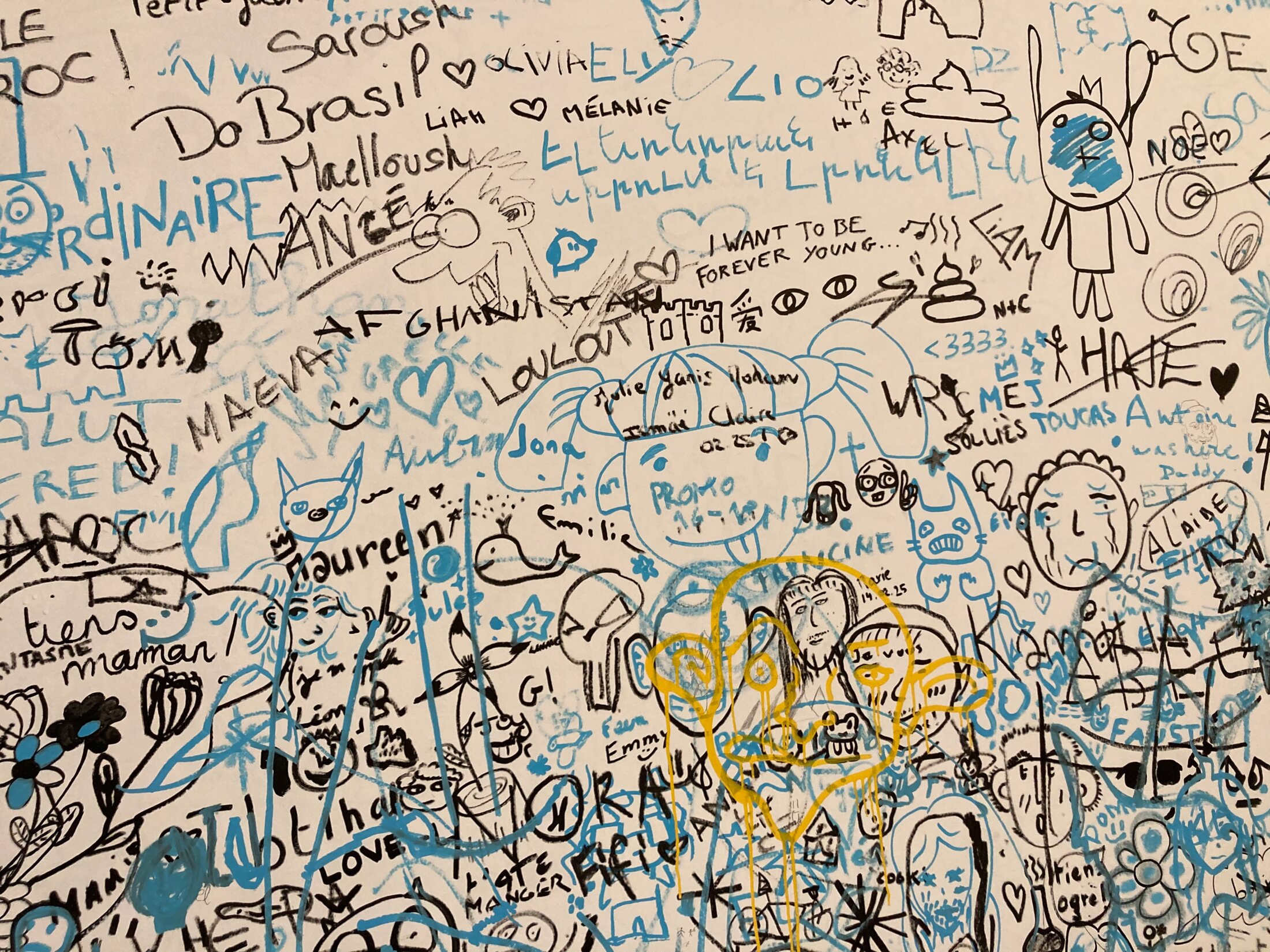
Or, les preuves de l’importance causale des facteurs psychosociaux à l’origine de la survenue du TDAH abondent. Par exemple, une étude de 2004[4] avait montré que le risque de troubles de déficit d’attention chez les enfants en âge scolaire augmente de 10 % par heure quotidienne de télévision regardée avant l’âge de trois ans…. Différentes études longitudinales et épidémiologiques[5] ont également démontré que le stress psychosocial augmentait significativement le risque de développer ultérieurement un trouble attentionnel. Des enfants ayant subis des mauvais traitements ou des abus peuvent présenter une agitation, une instabilité psychomotrice, une hypervigilance, une distractibilité et une excitabilité que n’importe quel spécialiste des TND (Troubles du Neuro-Développement) catégorisera immédiatement comme TDAH typique, sans autre forme de procès ou d’exploration.
Au-delà de l’invisibilisation des facteurs d’environnement, ce traitement massif à destination des enfants peut devenir un instrument stratégique pour certaines catégories sociales privilégiées, leur permettant par exemple d’exercer une ingérence scolaire ou d’exiger un traitement privilégié, tout en constituant aussi un outil de contrôle social de populations plus marginalisées.
Ainsi, au Brésil, le TDAH est devenu la principale raison pour laquelle des enfants sont envoyés vers des centres de référence spécialisés, ce qui en fait par ailleurs une des justifications les plus courantes de l’échec scolaire. Les taux de prescription peuvent dépasser les 25% dans certains états défavorisés…Les comportements des élèves qui ne correspondent pas au modèle scolaire dominant sont donc interprétés de façon univoque comme des troubles médicaux, devant être traités par des psychotropes, plutôt que comme des réactions complexes et intriqués, notamment à des dynamiques socio-relationnelles et politiques… Dès lors, les enfants ne sont plus considérés comme des êtres situés, pris dans une histoire, des conditions de vie, etc. Ils sont appréhendés comme des programmes cérébraux dysfonctionnels, devant être corrigés.
Dans certains États du Sud des États-Unis, le taux de diagnostic de TDAH, et donc de prescription de psychostimulant, approche les 30 %. Yves Citton dénonce à ce propos une forme d’ « extractivisme forcené et suicidaire ». En effet, le système éducatif et scolaire à destination des populations précaires est totalement défaillant. Les familles ne sont pas disponibles pour les enfants, du fait de l’accumulation d’activités professionnelles éparses. « Alors, pour que les enfants restent assis, on leur prescrit de la Ritaline »…

Agrandissement : Illustration 4

Dès lors, les répercussions sur les modalités interactionnelles parents/enfant et sur les processus de subjectivation infantile paraissent tout à fait problématiques : l’enfant apparait effectivement comme un être totalement passivé, devant être régulé, normalisé, dont le comportement n’aurait pas de sens ni d’intention…mais ne serait que la résultante de son trouble neuronal. Toute velléité de protestation, d’affirmation de mise en conflit se voit aussitôt écrasée, silenciée. Les parents se dédouanent alors de toute implication relationnelle et affective, imputant exclusivement à des défaillances neuro-génétiques les difficultés interactionnelles, avec l’aval de la Science…
Or, la labilité attentionnelle, l’impulsivité, l’agitation peuvent aussi être considérés comme des réactions face à des expériences traumatiques et carentielles précoces. En l’occurrence, certaines conditions de socialisation ou de défaut d’étayage pourraient favoriser l’excitabilité et le recours à la décharge motrice plutôt que les représentations et les fonctions réflexives…D’ailleurs, les profils des enfants ayant subi des traumas complexes précoces peuvent singulièrement ressembler à celui de ceux diagnostiqués TDAH, avec notamment des traits dépressifs, des signes d’anxiété sociale, une faible estime de soi, etc. Un enfant abusé peut aussi manifester une instabilité psychomotrice, une excitation comportementale mal contenue, une tendance à la dispersion, une hypervigilance périphérique, une grande distractibilité, une hyperréactivité et une sensibilité exacerbée, témoignant de la suractivation des systèmes neurovégétatifs d’alerte, au détriment des fonctions d’attention profonde. Telle une proie sur le qui-vive, devant guetter tous les stimuli, à l’affût – ce qui n’aide pas à déployer une forme d’insouciance et de sécurité interne nécessaire à l’investissement des représentations internes.
Les conditions précoces d’environnement exercent un impact décisif sur le développement des fonctions exécutives et attentionnelles. Au-delà des milieux très carencés en termes d’expériences interactives, des excès de stimulation intrusives peuvent également compromettre la régulation cognitive et comportementale. Mais plutôt que d’intervenir de façon préventive sur des conditions sociales complexes, on préfère désormais imputer aux enfants un défaut intrinsèque : cela vient d’eux, de façon essentialisée. Ils sont comme cela par nature, c’est leur identité. Et il faut bien corriger leur constitution viciée. Comme en témoigne cette sentence définitive empreinte de dénégation : « Contrairement à ce qu’on entend, le méthylphénidate n’est pas là pour soulager les parents. Le TDAH, c’est d’abord le problème de l’enfant. »
Toute expression comportementale « anormale » doit donc être médicalisée, avec des enjeux éthiques et civilisationnels tout à fait préoccupants. De fait, cette inflation de pathologisation semble s’apparier à des intérêts politiques et financiers (notamment pharmaceutiques), ainsi qu’à un désir social de diagnostic ou de reconnaissance de handicap, comme s’il y avait là une attente collective, voire une forme de fantasme, à pouvoir inscrire toute déviance de conduite dans une catégorie nosographique évacuant de facto la question complexe de la responsabilité, au niveau individuel et collectif.
De façon sous-jacente, on observe une logique néolibérale classique : création d’une problématique sociale du fait de stratégies politiques délibérées de précarisation => naturalisation / médicalisation / dépolitisation => accentuation des orientations à l’origine du problème, avec aggravation secondaire => dénonciation de l’incompétence des institutions en responsabilité, en rapport avec un empêchement de fonctionner rendu structurel = > démantèlement et ouverture de marchés lucratifs de prise en charge….

Agrandissement : Illustration 5

Ainsi, ce trouble est sans doute une construction épistémique très en phase avec certaines évolutions contemporaines- alors même qu’il est prétendu anhistorique… De fait, il s’agit d’évacuer les responsabilités collectives, sur le plan institutionnel et politique, pour pointer des déficiences individuelles innées. Dès lors, il n’y a plus d’autres marges d’action que la prescription corrective de traitements à vie. En arrière-plan, il s’agit de favoriser une privatisation des interventions, l’émergence d’un marché déréglementé très lucratif, ainsi qu’un démantèlement des institutions publiques de soin. Dès 2025, Étienne Pot, délégué interministériel aux TND, promet un cahier des charges permettant aux Agences Régionales de Santé de labelliser les centres spécialisés existants, avec des budgets consacrés. Ou comment détruire le soin au nom d’une idéologie décomplexée….
Or, contrairement à ces assertions idéologiques, l'hyperactivité n'est pas un trouble naturel, mais bien une construction socio-historique, dont on peut alors appréhender la généalogie.
A suivre...
[1] MTA pour National Institute of Mental Health Multimodal Treatment of ADHD : grande étude américaine randomisée effectuée en 1992 sur 579 enfants pendant 14 mois
[2] (« Do stimulant medications improve educational and behavioral outcomes for children with ADHA ? » National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts, juin 2013
[3] Storebø OJ, Ribeiro JP, Lunde C, Gluud C. WHO Essential Medicines List and methylphenidate for ADHD in children and adolescents. Lancet Psychiatry. 2024 Feb;11(2):93. doi: 10.1016/S2215-0366(23)00395-4. PMID: 38245023
[4] Christakis D. A., Zimmermann F. G., Digiuseppe D. L., McCarthy C. A. (2004). Early television exposure and subsequent attentional problems in children. Peadiatrics 113 : 708-13
[5] Hjern A., Weitoft G. R., Lindblad F. (2010). Social adversity predicts ADHD-medication in school-children : A national cohort study. Acta. Paediatr. 99 : 920-4



