Comme on l’a déjà souligné, la problématique du diagnostic devient de plus en plus un enjeu identitaire et communautaire, avec une revendication extensive à l’autodiagnostic, ou le recours exclusif à des procédures évaluatives très contestables quant à leur fiabilité. En conséquence, il devient absolument nécessaire de déployer une analyse anthropologique et politique de ce maniement contemporain du "diagnostic", de cette recherche de catégorisation nosographique, des dérives du concept de "neurodiversité", et des représentations collectives véhiculées par le signifiant "autisme".
De fait, les enjeux autour du « spectre autistique » sont particulièrement révélateurs de ces tendances contemporaines. Ainsi, au-delà des controverses scientifiques sur l'étiologie et les modalités thérapeutiques, il parait pertinent de se pencher sur le (mes)usage social de ce diagnostic, et notamment d’analyser son impressionnante extension sur le plan épidémiologique.
Que se joue-t-il lorsqu’ Hannah Gadsby clame « je suis autiste » ? Et bien, en termes de représentation collective, « l’Autisme » s’incarne alors dans la personne qui l’affirme et apparait donc, dans le cas présent, comme une simple forme de fonctionnement cognitif alternatif et singulier, dont il convient de revendiquer la pertinence et la fierté. A l’instant de cette énonciation performative, toutes les autres formes d’autismes sont momentanément scotomisées – même si ce n’est pas l’intention effective de l’humoriste – et un signifié dominant, monolithique, vient s’inscrire dans les représentations de son audience, sans doute profondément : « Je représente l’Autisme, l’Autisme, c’est cela, c’est moi ».
D’une part, Hannah Gadsby semble se référer à une réalité qui va de soi, incontestable ; « j’ai été diagnostiquée ».
D’autre part, cette catégorisation viendrait expliquer a posteriori certains éléments de son parcours personnel, de ses expériences infantiles et scolaires, ses incompréhensions, ses difficultés sociales, etc. Le diagnostic donne donc une clé indéniable, et univoque…
De surcroit, cet étiquetage confère à l’évidence un sentiment d’appartenance à une communauté, qui plus est discriminée. Dès lors, il s’agit effectivement de lutter contre l’autismophobie, le capacitisme, le validisme, et toute forme d’intolérance à l’égard de l’altérité ou de la différence – noble et indiscutable combat auquel nous souscrivons sans aucune réserve. Et cette revendication s’accompagne aussi d’une certaine fierté, alors que tend à se produire au niveau social une inversion collective du stigmate : nous valons mieux que la norme.
En témoigne d’ailleurs ce mouvement qui consiste à inclure de force nombre de personnalités illustres dans le champ de l’autisme –sans que la question de la scientificité ou du consentement paraisse problématique…
Outre les plus célèbres, Einstein, Glen Gould, Mozart, Bill Gates, etc., certains « recrutés » sont particulièrement savoureux…Voici donc un florilège de glorieux nominés, glané sur les sites spécialisés :
- Vladimir Poutine aurait par exemple été "diagnostiqué" par les “experts” du gouvernement américain…Le type n’est effectivement pas très expressif, ni jovial, ni empathique. Mais, à ce titre-là, on pourrait trouver de nombreux prétendants parmi les personnalités autoritaires et les despotes sanguinaires…
- Woody Allen…non, ce n’est pas une blague ; celui qui a construit toute sa carrière en exposant sous toutes les coutures ses névroses, ses complexes, ses séances de psychanalyse, serait en réalité un autiste méconnu….
- Bob Dylan… Déjà, celui-ci ne réagit pas officiellement à sa nomination au prix Nobel de littérature, et en plus, « lors de ses concerts, il déroulera ses textes sans un regard pour ses musiciens, pour le public, comme s’il était seul dans son studio. Dès le début de sa prestation, il est seul avec lui-même. S’il transmet de l’émotion, du plaisir, rien n’aura été préparé dans ce sens. Aucune transition entre chaque chanson, pas de petits mots d’introduction ou d’explication de texte, de contextualisation. Non, il enfile les textes comme si la soirée ne constituait qu’une seule et même œuvre». Assurément, Dylan n’est donc pas un artiste contestataire, subversif et non conformiste, mais un autiste …Bizarre, ni Miles Davis ni Thelonious Monk n’ont été sélectionnés…Serait-ce parce qu’ils sont afro-américains et que la requalification d’autisme concerne essentiellement des membres des classes privilégiées en quête de préjudices ?...
- Lionel Messi…Oui, le génial détenteur de six ballons d’or est effectivement introverti depuis son enfance. Dès lors, pas besoin d’en chercher davantage : ce n’est pas son travail acharné qui l’a mené là, mais sa neurodivergence….
- Léonard de Vinci : de son côté, le célèbre artiste inventeur se voit attribué le double combo autisme / hyperactivité. Il fallait bien ça, une bonne couche de neuroatypie, pour expliquer son génie touche-à-tout et sa tendance à l’inachèvement. Quant à Freud, et son « souvenir d’enfance de Leonard de Vinci », il peut aller se rhabiller – surtout s’il s’agit de relier le « souvenir relatif à la mère» avec le sourire de La Joconde…Vade retro, c’est dans les gènes et les neurones vous dit-on !
Attention, les sites qui égrènent ces incroyables inventaires en pleine expansion émettent également quelques réserves : parmi les élus, il y a ceux qui ont été officiellement diagnostiqués, et qui sont donc « validés » avec l’aval de la Science ; et il y a ceux qui sont supposés l’être, par déduction implicite…
Voici cependant ce que peut dénoncer un blog consacré à l’autisme : « Points communs entre ces personnages célèbres ; ils se répartissent en différentes catégories : les stars de la geekosphère (génies de l’informatique ou des jeux vidéos), les grands scientifiques qui ont conduit à des découvertes majeures en mathématiques et en physique, les artistes incompris et les figures controversées, souvent politiques mais pas que (on peut citer Mark Zuckerberg et Steve Jobs). Cette classification permet d’identifier le motif principal de la propagation de ces rumeurs : valoriser l’autisme en usant de stratagèmes grossiers et de sophismes à paillettes »
En tout cas, on perçoit là la constitution d’un véritable front communautaire, revendiqué comme tel, visant à affirmer une certaine définition de l’autisme : celle d’une minorité opprimée du fait de son fonctionnement neuronal divergent, et subissant une discrimination systématique de la part de la majorité neuro-normée. Il y aurait donc, par essence, une « subjectivité autiste », qui amènerait à une certaine vision atypique du monde : « Oui nous n’interprétons pas de la même façon le monde qui nous entoure et les injustices constatées ou subies nous révoltent » -alors que visiblement, les « allistes », eux, accepteraient sans sourciller l’ordre injuste du monde…
En tout état de cause, toute souffrance ne pourrait être qu’inhérente à un contexte d’oppression et de domination : « A chaque fois qu’on cite en exemple des personnes autistes dites « sévères » qui s’auto-mutilent, on ne peut décontextualiser cette violence de la violence capacitiste qu’elles subissent. Et cette violence dans un contexte psychiatrique ou éducatif doit être remise en perspective avec le point de vue neurotypique et son pouvoir ».
Il faut évidemment reconnaître le fait que certains établissements tout-puissants ont pu exercer une forme de maltraitance à l’égard du public accueilli, lequel se voyait sommé, de façon plus ou moins explicite, de fermer sa gueule. Et ce risque de dérive reste tout à fait présent, et doit nous inciter à la plus grande vigilance – d’autant plus lorsque les moyens mis à disposition se trouvent tellement réduits et démantelés que tous les acteurs subissent finalement une forme de maltraitance instituée, susceptible de favoriser les mauvais traitements et les négligences. Cependant, évitons les amalgames : sous-entendre que la souffrance des autistes ne serait que le fait des abus de pouvoirs des équipes éducatives et/ou psychiatriques constitue juste une contre-vérité inacceptable, ainsi qu’un déni affligeant de la détresse et du désarroi. Quand on veut tuer son chien, on l’accuse de la rage…
Certains, à l’instar de Janette Purkis, vont jusqu’à considérer que l’autisme constitue avant tout forme culturelle, voire une langue, marquées par un dénigrement et une stigmatisation systémiques : « l’autisme, considéré comme une culture, ouvre de nombreuses portes à la compréhension de l’expérience autistique – et à propos d’être autiste dans le monde alliste prédominant où nous vivons ». Et les membres de cette identité culturelle auraient comme vocation spontanée de constituer un entre-soi, pour échapper aux discriminations, aux agressions et aux tentatives de normalisation ou d’acculturation : « être entourés de membres de notre « tribu » nous permet de parler librement et d’être nous-mêmes, de communiquer avec les coutumes et la langue qui nous viennent naturellement ».
« Les personnes autistes sentent même qu’ils doivent se masquer et apprendre les coutumes de la majorité et ne doivent pas embrasser leur propre culture ». A quand un Franz Fanon autiste pour écrire un « Peau neuroatypique, masque alliste » ?
Tout de même, il faut des habiletés sociales et métacognitives extrêmement développées, une théorie de l’esprit bien établie, et d’incroyables capacités d’ajustement relationnel pour faire comme si l’on était neurotypique, pour donner le change dans un souci d’adaptation à la « neuro-norme », tout en dissimulant la réalité de son fonctionnement autistique et de sa neurodivergence…
Ainsi, la seule possibilité d’être vraiment soi, de s’autoriser à être « atypique » serait d’être entouré des siens.
Le repli entre « neurodivergents » est donc clairement revendiqué, comme une réponse nécessaire à l’oppression systématique, comme en témoigne Julie Dachez, maître de conférences en sujet et société inclusive à l’INSHEA, et diagnostiquée autiste à l’âge de 27 ans : « pas étonnant que l'on finisse par se replier sur notre communauté si les seul.e.s qui nous comprennent sont celles et ceux qui vivent les mêmes choses que nous. Taxer de communautaristes des personnes qui n'ont finalement pas d'autre choix que de se retrouver entre elles pour pouvoir se sentir acceptées est un peu facile ». C'est donc cela le modèle de société inclusive que l'on nous rabâche sans cesse, un recroquevillement sur l'entre-soi, une forme de résignation et d'enclosure....
Le refus de l’altérité, de l’altération par l’autre, des pratiques altératrices, de la réciprocité, du Commun, est d'ailleurs revendiqué comme légitime et nécessaire, puisqu’il serait imposé : « on ne peut pas faire autrement ». Or, un des principes de base du soin institutionnel –ou de toute politique émancipatrice - consiste justement à reconnaître, accepter, faire avec cette part d’altérité inhérente tant dans le lien avec les autres qu’avec soi…Encore faut-il se départir des clivages, des catégorisations, des préjugés normatifs, des « classements » ….
Comme les zapatistes au Mexique, il s'agit de revendiquer "un monde fait de nombreux mondes".
Nonobstant, pour Hugo Horiot, écrivain, acteur, militant de la cause autiste, « l’autisme est l’intelligence de demain », ainsi que tous les profils neuro-atypiques, c’est-à-dire « les variantes neurologiques du genre humain qui s’inscrivent dans une minorité cognitive, et qui représentent 10% de la population. Cela comprend le spectre de l’autisme bien sûr, mais aussi les THQI (Très Haut Quotient Intellectuel), les TDAH (Trouble du Déficit de l’Attention/Hyperactivité), les dyslexiques (altération spécifique et significative de la lecture), les dyspraxiques ». Étonnamment, certains troubles génétiques induisant des profils neurodéveloppementaux particuliers ne font pas partis de ce club sélectif, comme par exemple le syndrome de Down (Trisomie 21). Par ailleurs, la schizophrénie, qui est pourtant appréhendée comme un trouble génético-neuronal par certains porte-paroles des neurosciences et de la psychiatrie biologique, est également exclue de cette neuroatypie anoblie. Vous avez dit capacitisme et validisme ?...
De fait, pour Hugo Horiot, il faut surtout exploiter et intégrer ces intelligences particulières du fait de leur efficacité, de leurs compétences spécifiques et de leur rendement, notamment dans une démarche d’accélération numérique et de dématérialisation du capitalisme…
Au fond, on assiste là à l’affirmation, cautionnée par la Science, d’un discours performatif, de type culturaliste et identitaire, qui tend à s’approprier une définition restreinte du spectre autistique en tant que simple neuro-atypicité. Dans cette conception, l’autisme n’est plus un trouble, mais une condition et seules les comorbidités, inhérentes aux neuro-normes d’une société oppressive, seraient éventuellement à appréhender comme un signe de souffrance psychique.
En témoigne par exemple le manifeste du CLE autisme, avec lequel nous partageons de nombreuses convergences – mais aussi de sérieuses réserves…
Le collectif pointe donc la situation d’oppression des personnes neuroatypiques, qui se trouvent « dénigrées, rejetées et combattues par certains groupes d’influence ayant longtemps eu le monopole de la communication sur le thème de l’autisme ». Dès lors, l’entre-soi et la non-mixité sont assez clairement revendiqués comme allant de soi dans le cadre de la défense des droits et des luttes contre l’exclusion. « Ensemble, nous pouvons permettre à d’autres autistes, psychiatrisé.e.s ou institutionnalisé.e.s, de s’exprimer à leur tour » - l’idée étant manifestement que l’institution constitue intrinsèquement une forme de muselage… De fait, « l’institutionnalisation est une ségrégation spatiale et sociale organisée par la société », « une discrimination structurelle ». « Ce système institutionnel repose sur une conception de l’autonomie qui est celui d’une norme valide, masculine et de classe supérieure » (sic). Dès lors, « nous réclamons la fin des établissements spécialisés conçus pour les autistes et les handicaps cognitifs, de l’école à la vie d’adulte, en passant par le travail ».
Petite parenthèse : ces revendications de désinstitutionnalisation sont tout à fait en phase avec le programme néolibéral de démantèlement des Communs et des services publics, allant de pair avec une privatisation individualisée ou communautarisée des ressources – ce qui favorise par ailleurs des stratégies de lobbying et d’accaparement des fonds publics par certains groupes d’intérêt, au détriment de la collectivité.
Une pétition en ligne dénonce ainsi le « démantèlement du secteur médico-social, organisé depuis plusieurs années par les gouvernements successifs, avec une accélération particulière sous la présidence Macron » et une « mise au ban des pratiques basées sur le soin relationnel et de la psychothérapie institutionnelle ».
« Après avoir organisé la pénurie, le gouvernement, à la suite de ceux qui l’ont précédé, met en place des plates-formes d’orientation et de coordination (PCO), instrumentalise les neurosciences, dévoie les paradigmes scientifiques par une injonction à diagnostiquer des troubles neuro développementaux (TND) à la hauteur démesurée de 60% ».
Il y a donc une véritable convergence entre cette politique de New Public Management, certaines dérives idéologiques et instrumentalisations de la Science, et les revendications de certains mouvements militants, avec en ligne de mire la disparition pure et simple du Soin et des institutions thérapeutiques, en faveur de prestations à la personne. De fait, il n’y a plus de souffrance, il n’y a que des discriminations et des besoins.
Ainsi, pour le CLE, « il n’y a pas d’autistes sévères, c’est à dire enfermés dans une catégorie déshumanisante et déficitaire. Il y a des personnes autistes ayant des besoins d’accompagnement conséquents et complexes ».
Zut, je suis donc victime d’hallucinations sévères, ou alors tout simplement aveugle – ainsi que toutes les équipe qui s’engagent corps et âme dans le soin institutionnel. Ces enfants sans langage, rongés d’angoisse, en quête permanente de réassurance et de contenance, présentant des crises clastiques terribles dites de « temper tantrum », ne souffrent pas intérieurement, mais sont simplement victimes des soins que nous leur prodiguons…En voulant les aider, nous les ostracisons, car nous ne comprenons pas leur atypicité, et ils réagissent donc à notre violence « neuro-normée ». Mais oui, c’est évident. Abandonnons-les, laissons-les vivre, eux et leurs familles, avec quelques prestations qu’ils utiliseront comme bon leur semble – sans aucune pression ni injonction, ni intérêts de certains prestataires en arrière-plan, cela va de soi…
« La neurodiversité est un état de fait, elle ne se discute pas (…). Nous ne luttons donc pas pour la neurodiversité, mais pour l’égalité et le respect de ces différences neurologiques ».
« Tout le monde est neurodivers.e, mais tout le monde n’est pas neurodivergent.e. En effet, les personnes autistes et ayant un handicap cognitif ont un handicap construit par une (neuro)norme imposée à tous et toutes, elles divergent de celle-ci et par conséquent elles subissent des injustices, des obstacles et des discriminations structurelles qui ne sont en aucun cas des événements individuels et le fruit du hasard. Ces dynamiques sociales autour de la neurodiversité sont similaires à celles existant autour de la diversité des genres, des cultures et des ethnies. Ces dynamiques incluent des rapports de pouvoir et d’inégalité sociale ».
« Au même titre que d’autres groupes sociaux minoritaires et/ou marginalisés, les personnes autistes subissent une oppression systémique de la part des personnes neurotypiques, qui décident pour elles sans elles ».
« Si notre combat a sa place au côté des mouvements féministes, LGBTIQ+, racisé.e.s , alors il ne peut être qu’intersectionnel, c’est à dire prendre en compte toutes les logiques de domination et d’oppressions que peuvent subir les personnes de nos conditions neurologiques ».
Je ne peux que souscrire à une appréhension élargie et contextuelle du « Handicap ». En effet, au-delà des enjeux personnels, il convient toujours d’appréhender les déterminismes interpersonnels, culturels, sociaux, environnementaux, politiques ; les maltraitances et les discriminations, de toute nature. Cependant, à force de vouloir trop « intersectionnaliser », ne prend-on pas le risque de ne plus savoir de quoi il est véritablement question ? De noyer la réalité concrète du mal-être singulier dans les eaux glacées des généralisations simplificatrices et hautaines ?
Certes, nous soutenons sans ambages toutes les velléités d’émancipation, et la déconstruction des normes oppressives. Cependant, on ne peut qu’être interpelé par cette affirmation latente d’un nouveau cadre normatif extrêmement intransigeant, et très essentialiste, aussi stratégique soit-il. Par ailleurs, d’un point de vue épistémologique, mettre sur le même plan un « statut neurologique » discriminé, le racisme, le patriarcat, la transphobie, etc., cela ne va pas de soi – à moins effectivement de considérer toutes ces « conditions subalternes » comme étant des entités « naturalisées », innées, inaltérables, closes, et subissant une oppression systémique de par leur substance « bio-neuronale ».
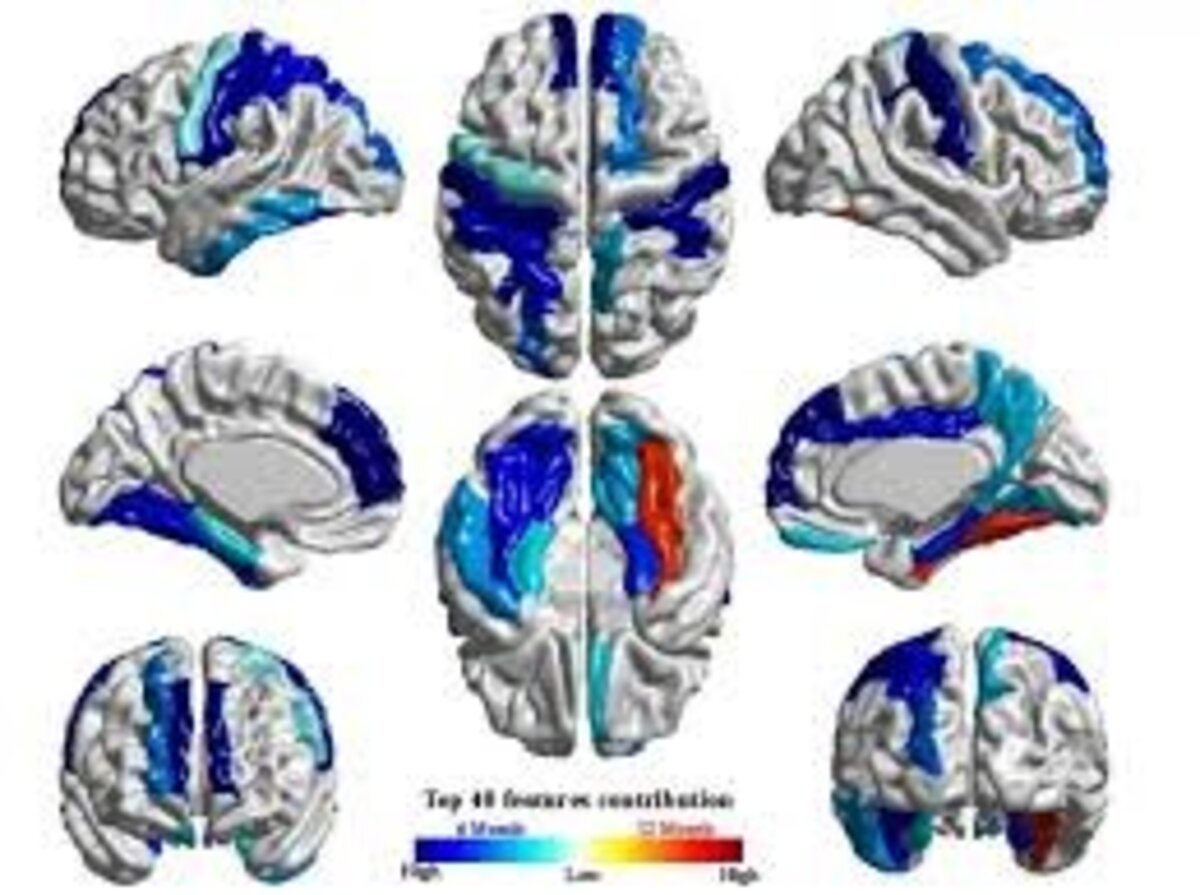
En tout cas, il me semblait important de citer de longs extraits de ce texte, de façon à saisir non seulement la logique sous-jacente, mais aussi la tonalité du discours. Effectivement, il s’agit ici d’asséner, d’affirmer, sur un mode très péremptoire, autoritaire, définitif. Manifestement, la dimension militante exclut toute nuance, toute ouverture, tout doute, et ne laisse aucune place au dialogue. Dès lors, tous ceux qui ne rentrent pas de force dans ces schémas, les marginaux, les oubliés, les impurs, les non-assignés, les invisibles, les sans-paroles, les différents, etc., et bien ils n’existent tout simplement pas.
De surcroit, tout ce qui pourrait faire émerger l’autre en soi, l’inaliénable singularité, le déploiement de la subjectivité, les divisions, les conflits et les ambivalences, doit donc être éliminé et décrédibilisé.
Ainsi, « la psychanalyse ayant une place importante dans le système médico-social français, elle doit être combattue pour son validisme et sa psychophobie (sic !), sa promotion de l’institutionnalisation et son approche ne permettant pas de comprendre l’autisme ».
La psychanalyse validiste et psychophobe ?!! Ouvrons là une parenthèse indispensable.
On peut certes avoir de nombreux griefs à l’égard de certaines théories, pratiques et institutions psychanalytiques ; mais, de là à énoncer des contre-vérités aussi affligeantes pour jeter le bébé et l’eau du bain…Car la dimension subversive de la psychanalyse a justement consisté à abraser les frontières entre le « normal » et le « pathologique », à considérer que le fonctionnement psychique est inévitablement tissé d’hétérogénéité, de clivages, de zones de fonctionnement hybrides et entremêlées…Tous, autant que nous sommes, nous sommes un entrelacement, une superposition entre des niveaux très archaïques et des « couches » plus réflexives et intégrées ; nous sommes un patchwork de défenses, de complexes, de fantasmes et de potentialités (psychotiques, autistiques, limites, névrotiques, etc.), susceptibles d’émerger au premier plan en fonction de tel ou tel contexte. Au fond de nous, il y a toujours de l’ambivalence, des déchirements, des germes de « folie » …Nous sommes pénétrés de trous, d’esseulement, de symbiose, mais aussi d’altérité, de tiers, de collectif, d’identifications multiples et contradictoires, de bisexualité, de fluidité, de plasticité, de polymorphisme ; en nous se jouent des scènes dramatiques et s’affrontent d’étranges personnages, en lien avec toutes les groupalités internes qui se sont construites au fil de nos histoires et de nos rencontres. La psychanalyse a fondamentalement déconstruit les normes, les différences, les catégorisations – même si certaines de ses tendances conservatrices officielles ont toujours besoin de restaurer un certain « ordre ». Et toute pratique psychanalytique vise essentiellement à soutenir la subjectivation, la singularité, à s’approprier son propre parcours identificatoire et ses propres perspectives désirantes, sur un mode émancipatoire et désaliénant, sans aucun a priori normatif – mais en reconnaissant cependant nos inévitables limites, restrictions de jouissance, en intégrant la butée du réel, des autres, du social…Dès lors, la psychanalyse constitue véritablement un « plaidoyer pour une certaine anormalité » (Joyce Mc Dougall) : il ne s’agit donc surtout pas de s’adapter, pour devenir un normopathe ; bien au contraire, la finalité serait de rester connecté à notre sève, à nos élans créateurs, à nos fêlures et à nos manques, à notre infantile et à nos impulsions profondes. Ce qui suppose aussi de reconnaître, a minima, nos amarres, nos déterminismes, nos filiations croisées, nos héritages, pour s’en libérer, autant que faire se peut.
En tout cas, une des finalités du travail analytique consiste à déconstruire les prothèses identitaires, à fissurer les faux-selfs, à se décaler des assignations et des appartenances sclérosantes. Et, pour cela, il convient parfois d’accueillir la « vitalité destructrice » (Winnicott), de laisser se déployer la « pulsion anarchiste » (N. Zaltzman), capable de fournir l’énergie nécessaire à la lutte et aux ouvertures du devenir.
Au final, ce qui est revendiqué par ces militants de la « cause autiste » constitue évidemment -à l’insu même des « libérateurs » - de nouvelles formes institutionnelles, pouvant soutenir – ou non – des potentialités d’émancipation – ou d’aliénation…Ainsi, le fantasme de la désinstitutionnalisation risque d’amener à une scotomisation de ces émergences institutionnelles plus ou moins inédites, privatisées, ubérisées et plateformisées – et toute institution aveugle à elle-même est sans doute à risque de basculer dans une fermeture aliénante et hétéronome, du fait de sa conviction d’être dans le Vrai, le Bien, et l’autosuffisance omnipotente. Comme on l’a déjà souligné, il faut d’ailleurs être conscient des confluences entre ces mouvements associatifs militants, la gouvernance managériale et les politiques néolibérales - par exemple, en voulant détruire toutes les institutions publiques, en faveur de financements directs à destination des personnes, désormais libres de faire appel à des prestataires privés, lucratifs, etc. Dès lors, il faut espérer que ce militantisme, porté par des idéaux légitimes, ne devienne pas le dindon de la farce en donnant une caution « libératrice » à un mouvement de démantèlement de tous nos acquis, tant sur le plan des pratiques institutionnelles, que sur celui de nos idéaux communs d’émancipation….
Afin de déconstruire certaines évidences, il conviendra de revenir, dans un prochain billet, sur les enjeux spécifiques concernant l’extension massive du diagnostic d’autisme. A suivre….



