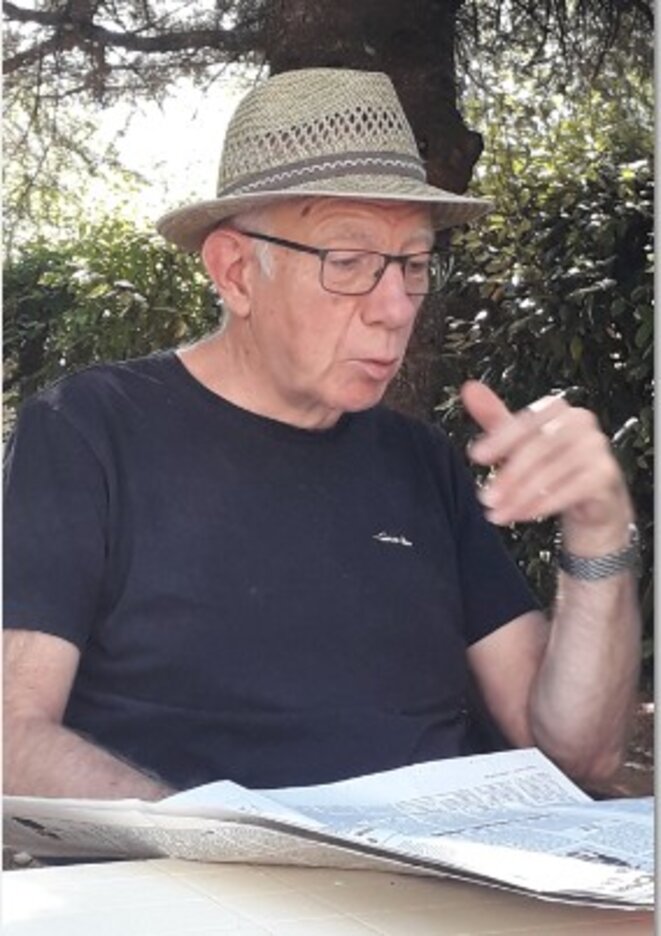Mais n'oublions pas la Retraite comme le montant de pension que va percevoir la personne retraitée. Il est essentiel que cette somme assure une belle et heureuse retraite. Malheureusement, les personnes qui ont galéré du temps de leur vie dite active se retrouvent toujours en précarité financière à l'heure de la retraite. C'est une injustice que la marche du capitalisme et des réformes néolibérales successives aggravent, la toute dernière augmentant de 2 ans l'âge légal de départ. On ne peut faire abstraction de cette injustice quand on veut philosopher sur le temps libéré qu'offre la retraite : « jouir » de sa retraite, c'est aussi disposer de conditions favorables pour en profiter.
Se retirer, s'isoler, renoncer : étymologiquement, c'est grosso-modo les options qui se présentent pour une personne qui arrive à l'âge de la retraite.
Se retirer (de la compétition économique) : la très grande majorité y aspire et l'entrevoit avec plaisir (ou du moins avec soulagement), mais certaines personnes sont contraintes de poursuivre une activité (parfois jusqu'à 65, 66 ou 67 ans et pas spécialement par plaisir) ou alors de passer beaucoup de temps à demander des aides de toutes sortes, ce qui demande de l'énergie et du stress.
S'isoler : ça peut être un choix. Pour des croyants, le mot Retraite désigne une période de calme et un lieu pour se recueillir. Pour d'autres, c'est quitter son lieu de vie pour rejoindre une destination meilleure (mais cela est toujours question de moyens). Besoin de calme à la campagne, la mer, parfois à l'étranger. Envie de rompre avec le passé. A mon avis, cette rupture peut conduire à beaucoup de déceptions, notamment parce qu'il est difficile de reconstruire du lien social, car nous sommes des animaux sociaux : cette option individualiste peut séduire une partie de la population, mais attention à ne pas devenir comme des légumes.
Renoncer : ça peut être par simple souci physiologique. Quoi qu'on prétendre le contraire en proclamant qu'on est « toujours jeune », l'âge est là. On peut certes espérer encore des années en bonne santé. Renoncer n'est pas renoncer à tout, c'est prendre conscience de nos limites et concevoir une vie différente avec des saveurs nouvelles, notamment le plaisir de ralentir, de contempler le monde différemment et donc de s'émerveiller.
Au fait, la retraite ne signifie par la fin du travail, mais la cessation du travail-emploi, de l'activité rémunérée, c'est-à-dire du travail comme marchandise, le plus souvent sous forme de subordination à un employeur, public ou privé.
C'est ce lien de subordination qui disparaît, la société fournissant un revenu. Ce lien de subordination est producteur d'aliénation chez les travailleurs (cf Marx). On n'ira pas prétendre que les retraités ne subissent pas d'autres formes d'aliénation (le consumérisme par exemple). Mais c'est une épine de moins dans le pied.
Qu'on ne dise donc pas que le travail cesse avec la retraite : c'est le travail-emploi, ce qui n'est pas la même chose. Ainsi, on peut être à la retraite et produire pour soi et pour autrui. Il n'est que de voir le nombre de retraité-e-s qui s'engagent dans la vie des communes, des associations : cet engagement est même essentiel.
On remarquera qu'à la retraite, le droit de grève ne peut plus formellement s'exercer. Plus de patron, plus de pouvoir de pression sur le patron.
Si on considère autrement la grève - vers la grève générale, la révolution sociale, l'expropriation de la classe capitaliste et l'autogestion généralisée -, la donne change. D'accord, nous sommes très loin de cet objectif. Mais avec l'impasse et la nocivité du capitalisme – l'exploitation des humains et de la nature, les guerres, le dérèglement climatique - il mérite qu'on continue de l'envisager et simplement d'étudier les formes que cela pourra prendre. De ce point de vue, la segmentation de la population entre actifs et inactifs s'estompe.
Déjà, pour les personnes à la retraite, refuser le statut « segment de marché » de « consommateur choyé », car disposant d'un « pouvoir d'achat ». Nous ne sommes pas que ça.