Le TGV était en retard, le grand amphithéâtre de l’IEP d’Aix-en-Provence trop petit pour contenir tous ceux qui étaient venus écouter Edwy Plenel (quatre cents personnes), l’estrade d’une hauteur un peu épiscopale, le groupe de lecteurs provençaux de Médiapart qui avait organisé cette conférence pas très nombreux, mais là où l’exigence démocratique est forte les circonstances passent rapidement au deuxième plan.

Ce qui frappe immédiatement chez Edwy Plenel, c’est sa force de conviction. Cet homme, connu et reconnu pour les responsabilités qu’il a assumées comme pour les engagements où il n’a pas hésité à braver les pouvoirs en place, s’adresse à tous comme s’il tenait avant tout à s’adresser à chacun, avec cette chaleur et cette simplicité qu’on réserve aux rencontres importantes.
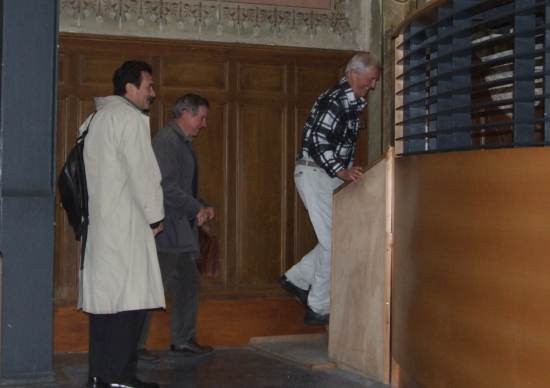
Conférence, oui, mais on sent tout de suite un appel au dialogue, un appel au débat. Et pour qu’il y ait débat, il faut accepter quelques règles communes. Les fondamentaux, dit Edwy Plenel.
Ces fondamentaux, il est d’autant plus nécessaire de les rappeler que le pouvoir actuel, transgresse des règles élémentaires de la démocratie, pour faire ses propres règles à géométrie variable, selon son bon plaisir.
Ces fondamentaux ont pour colonne vertébrale la vérité factuelle, poursuit Edwy Plenel. Il ne peut pas y avoir de débat si on ne peut pas s’entendre sur ce que représente un fait avéré, vérifié, vérifiable, contextualisé, hiérarchisé. L’exigence démocratique a peu à peu, au cours du XIXème siècle, conquis la liberté d’expression et d’opinion, qui est l’affaire de tout le monde. Mais, immédiatement après, se pose la question de la vérité, car un peuple, tout en disposant du droit de vote et de la liberté d’opinion, peut se tromper, être trompé. Et là, c’est l’affaire des journalistes que de produire des vérités factuelles, ce bien commun qui fonde l’espace public. L’établissement des faits et des preuves ainsi que la pratique du débat ont permis l’essor du journalisme et l’écriture d’une histoire qui ne soit pas que légendaire comme c’était le cas à l’époque des monarchies absolues. Des vérités, même dérangeantes pour les pouvoirs en place, pouvaient émerger.
Or, n’assiste-t-on pas, de ce point de vue, à un dramatique retour en arrière, à un dangereux abandon de cette règle sans laquelle la démocratie ne serait plus qu’un faux-semblant ?
Edwy Plenel cite comme exemple de cette régression « le mensonge d’Etat » qui a permis aux Etats-Unis de Georges Bush « l’invasion d’un pays qui ne leur avait pas déclaré la guerre. » Chacun se souvient de l’amalgame fallacieux entre Al Qaida et le pouvoir Irakien de Saddam Hussein, des fausses preuves de détention par ce régime d’armes de destruction massive : à partir de l’image à juste titre dégradée du régime Irakien, le pouvoir américain s’est autorisé au mensonge pour justifier la guerre. Et ce mensonge d’Etat a été relayé par les plus grands journaux américains. Une décision qui engage durablement l’équilibre du monde peut donc s’appuyer sur un mensonge relayé par ceux-là même qui ont mission d’informer, de contrôler et de faire apparaître la vérité, ceux dont la crédibilité repose justement sur ce pacte de vérité.
Comment ne pas voir dans cet abandon d’exigence de la presse une des raisons de la désaffection qui la frappe ? La presse « qui fait rêver » existe et se porte bien. Celle qui est censée informer subit de plein fouet la méfiance des lecteurs.
Edwy Plenel rappelle que nous sommes tous faillibles. Nous attendons tous des informations qui d’abord nous confortent dans nos opinions, nous subissons tous une déception lorsque les faits viennent contredire les idées que nous nous sommes construites. L’enjeu de vérité est un combat à mener y compris contre notre propre tendance à défendre nos opinions contre les faits dérangeants.
Alors, il faut toujours tirer l’exigence vers le haut, parce que le risque lié à l’abandon des fondamentaux, c’est la dépolitisation, c'est-à-dire le combat de chacun contre tous, la crispation sur l’intérêt personnel, l’abandon de l’intérêt commun. L’Etat qui ne fait que défendre des intérêts particuliers, est l’instrument d’instances sans aucune légitimité démocratiques (les banques, les assurances, les groupes industriels, les cabinets d’experts, etc…), et la presse soumise devient la caisse de résonance de ces groupes de pouvoir.
Tirer vers le haut, parce que le monde journalistique subit les mêmes pressions que la société toute entière. Il est au centre d’un écosystème qui tend soit vers plus d’exigence démocratique, soit vers l’abdication devant les puissances d’argent. Edwy Plenel présente Médiapart « comme un laboratoire où l’on s’efforce de prendre cette réalité à bras le corps », où l’on s’efforce de remettre en place ces fondamentaux, par l’exemple d’un journalisme d’investigation associé aux ressources participatives de la révolution numérique.

Dès que l’on donne la parole à la salle, la précision de la réponse d’Edwy Plénel montre immédiatement toute l’attention qu’il porte à la question. Là encore, il s’appuie sur des faits et le dialogue apparaît comme un élément fondamental. Toutes les questions sont reçues comme de vraies questions. Le public s’est intéressé, par exemple, au financement de Médiapart ou à Twitter, mais n’a pas pu, faute de temps, déployer tout son questionnement. Celui-ci n’aurait pas manqué de refléter la diversité de la composition de l’assemblée : étudiants de l’IEP, étudiants journalistes, membres d’associations comme Attac ou la Ligue des Droits de l’Homme, personnes venues individuellement de tous les alentours…
Le succès de cette soirée manifeste que beaucoup de citoyens se soucient d’être informés véridiquement, qu’ils attendent des journalistes l’exercice de leur métier de « watch dogs » (chiens de garde), donnant l’alarme démocratique.
Le groupe local de lecteurs de Médiapart



