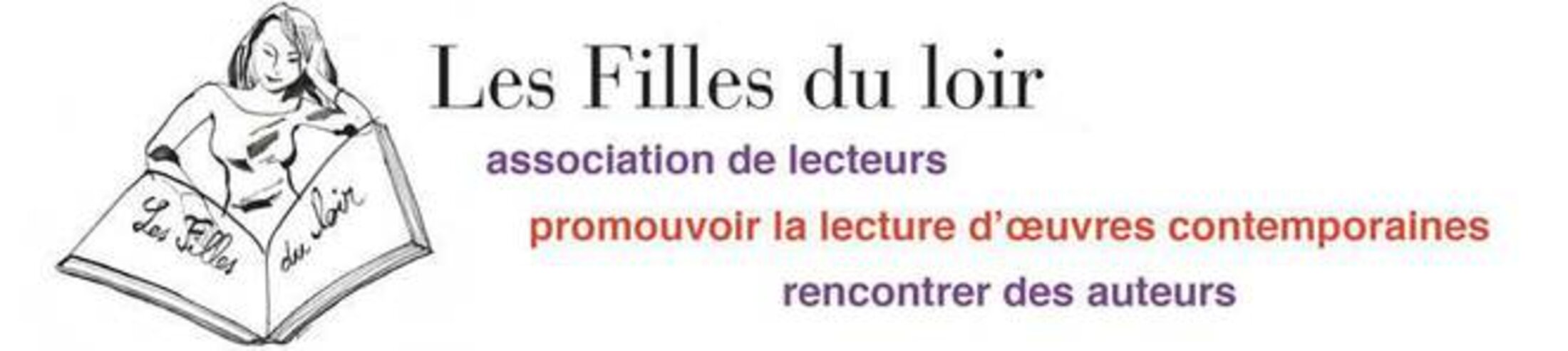Le 6 février 2020
Librairie L'ImagiGraph, 84 rue Oberkampf 75011 Paris à 19 heures
Entrée libre

Agrandissement : Illustration 1

La nature, vaste, à l’échelle du continent dit américain : au cœur du roman d’Eric Plamondon, il y a la Gaspésie, péninsule de forêt et d’eau, terre de migrations à l’est du Québec. « Gespeg, ce qui dans leur langue veut dire la fin des terres », ainsi l’ont nommée les Mi’gmaq, arrêtés dans leur voyage par l’Atlantique. Se plonger dans la lecture de Taqawan, c’est respirer le parfum boisé, piquant de givre et de gel, de cette région du monde dont l’auteur, par courts chapitres, retrace l’histoire jusqu’au plus reculé des temps : « Au fond d’une baie qui ne s’appelle pas encore la baie des Chaleurs, le frottement de la croûte terrestre et les éruptions de lave dessinent une géographie que fouleront bien plus tard les êtres humains. En fait, sur l’échelle du temps, l’arrivée des hominidés en Gaspésie, entre dix et vingt mille ans de ça, est vraiment insignifiante. » Territoire abondant, foisonnant de gibier à la belle saison, dur et coupant l’hiver, où sont installés depuis des siècles ceux que les colons européens appelleront les Sauvages puis les Indiens. Nature nourricière qui donne ou ne donne plus, et il faut faire des réserves de viande sechée pour que le clan survive, mais à laquelle les Mi’gmaq rendent tout. Eric Plamondon restitue en quelques phrases très visuelles, le tableau de cette nature mère vue par ceux qui l’habitent sans la détruire, ne s’en considérant pas les maîtres : « Les feuilles sont rouges dans les arbres. Les feuilles sont jaunes et orange. Les feuillent tombent. Le sol est couvert de limbes et de nervures qui craquent sous le pied. La forêt s’éclaircit. Le ciel apparaît entre les ramures. Les gélinottes se cachent au creux des épinettes. Le poil des lièvres tourne au blanc. La chasse est mauvaise cet automne. Les piégeurs manquent de veine. » Mais dans les rivières claires et froides, il y a peut-être encore des saumons : animal qui guérit la faim, animal mythique remontant le cours d’eau natal pour s’y reproduire.
Sur ce territoire habité depuis des siècles par les Mi’gmaq ont débarqué d’Europe un certain John Cabot, puis le célèbre Jacques Cartier. Dans le roman où l’action se situe en 1981, la brutalité des hommes remonte à sa source, ce viol originel de la terre Gespeg : son invasion par les colons européens. Crimes de l’histoire des civilisations dont l’une établit méthodiquement le plan d’extermination de l’autre : « Dans l’Ouest, l’homme blanc a réussi à éliminer les Indiens en éliminant les bisons. Dans l’Est, il y avait les saumons. On les a pêchés à coup de barrages, de nasses et de filets jusqu’à l’épuisement des stocks. Les Indiens aussi sont épuisés. » Destruction des natifs et confinement des survivants dans des réserves. Terre exploitée par l’agriculture et l’avidité, et non plus respectée par les chasseurs-cueilleurs. Mémoire effacée du savoir-faire indien par la prétendue supériorité des hommes venus d’Europe qui croient avoir tout inventé, et dont l’écho se glisse dans la conscience d’Yves Leclerc, l’un des personnages principaux, qui se souvient de son grand-père : « L’érablière était la fierté de sa vie. Il aimait être dans le bois, et par certains traits, on aurait pu croire qu’un peu de sang indien coulait dans ses veines. Mais ça, à son époque, c’était de l’ordre du tabou. Tellement tabou que le grand-père d’Yves Leclerc n’a jamais su que ce sont les Indiens qui ont découvert comment fabriquer le sirop d’érable, sismòqonabu en mi’gmaq. Aujourd’hui, pour son petit-fils, cette ignorance donne au sirop un petit goût d’injustice. »
Dès les premières pages de Taqawan, l’auteur nous plonge dans la violence policière d’une confiscation des filets de pêches des Mi’gmaq de la réserve de Restigouche. Les flics se déchaînent contre les hommes qui tentent de sauver leurs filets et ne se soumettent pas : « Alors les forces de l’ordre redoublent de coups, s’enragent et deviennent vicieuses. Quand les chiens sont lâchés, quand on donne le feu vert à des sbires armés en leur expliquant qu’ils ont tous les droits face à des individus désobéissants, condamnables, délinquants, quand on fait entrer ces idées dans la tête de quelqu’un, on doit toujours s’attendre au pire. L’humanité se retire peu à peu. » Le pire, ce sera comme souvent une femme qui l’éprouvera, la jeune Océane, l’adolescente rebelle qui vit avec sa famille dans la réserve.
Contrastant avec la violence policière et politique des bandes, avec celles des hommes d’affaires ligués par la voracité, les personnages qui veulent résister vivent à leur manière un isolement. Seul est Yves Leclerc, agent de la faune démissionnaire, partisan de l’indépendance du Québec. Seul aussi l’indien William dont on ne sait ce qui l’a poussé à s’installer hors de la réserve. Seule Océane au corps meurtri. Eric Plamondon livre de beaux portraits de ces solitudes en forêt, qui se croisent et s’associent pour lutter contre l’infâme. La terre de la Gaspésie est leur alliée, qui sait s’ouvrir aussi, avalant dans ses eaux comme dans la chair de son sol les ordures humaines, viles incarnations du mal.
« Terre natale
C’est un drôle de concept, la terre natale. Ce sont de drôles de concepts, le territoire, la culture, la langue, la famille. Comment ça fonctionne dans la tête des humains ? Ils sont les enfants de leurs parents. Ils naissent au sein d’une communauté à un moment précis quelque part. Mais d’où vient cette incroyable force collective qui mène le monde depuis toujours : défendre son territoire, son identité, sa langue ? D’où vient cette nécessité comme innée, depuis le fond des âges, qui veut que l’espèce humaine se batte et s’entretue au nom d’un lieu, d’une famille, d’une différence irréductible ? Pourquoi mourir pour tout ça ? »
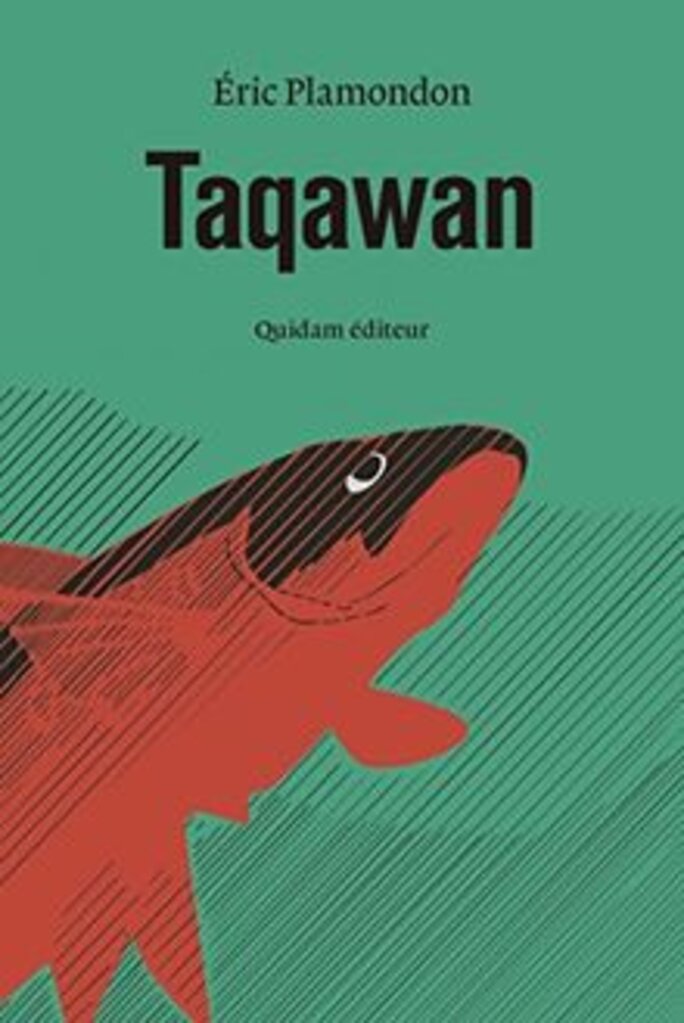
Eric Plamondon
Taqawan
Quidam éditeur
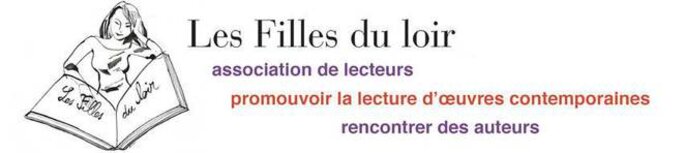
Agrandissement : Illustration 3