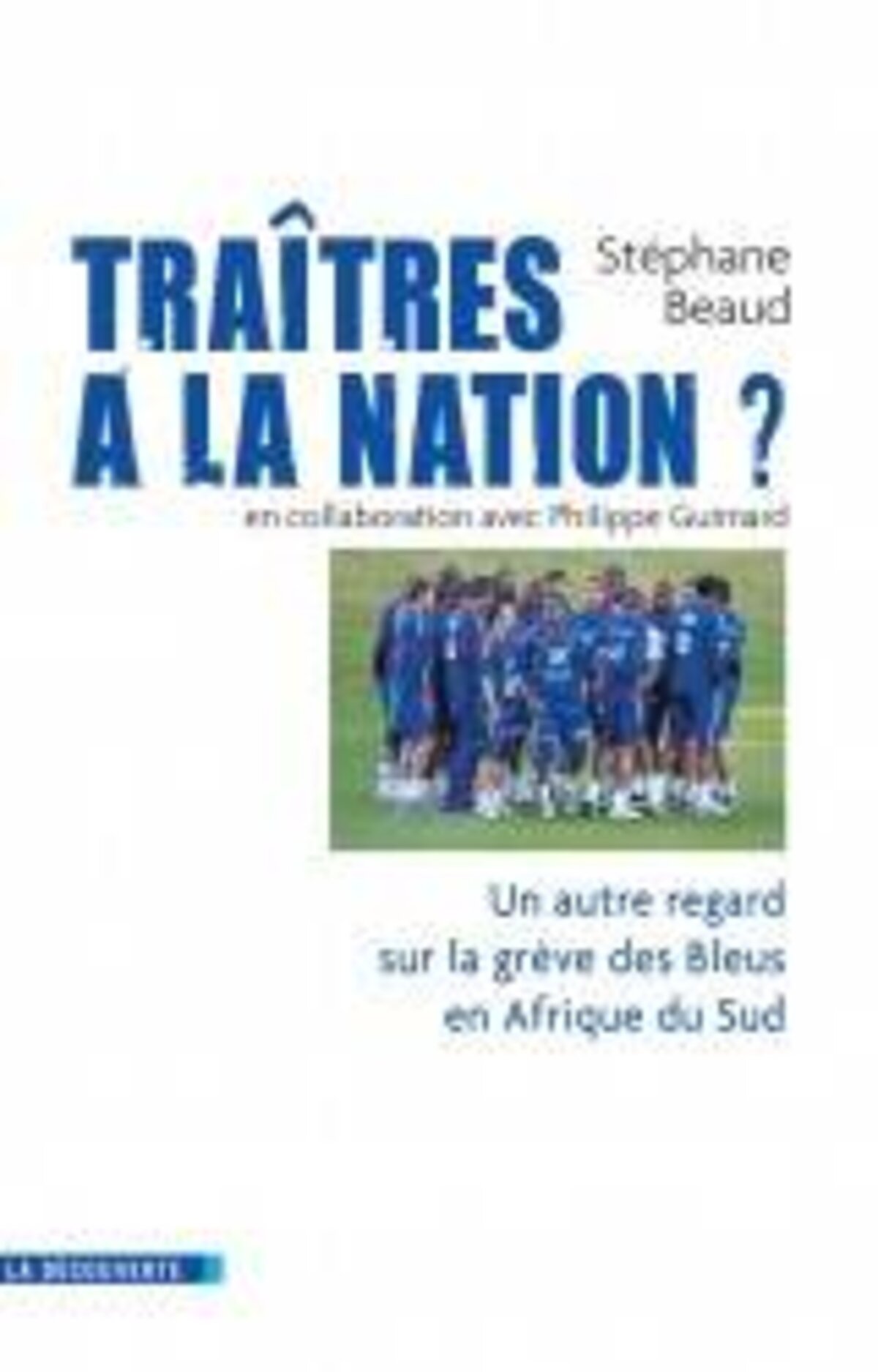
Souvenez- vous. Nous sommes pendant le Mondial 2010 de foot. L'équipe de France fait un mauvais tournoi et la presse est montée contre elle. Or, voilà que L'Équipe titre sur l'insulte que, dans le vestiaire, aurait lancée Anelka à l'encontre de l'entraîneur: «Va te faire enculer, sale fils de pute!» Anelka est rapidement exclu. L'équipe des Bleus fait bloc autour de lui et annonce dans une lettre signée part tous une grève pour le lendemain. Réprobation générale, y compris au plus haut niveau de l'État. Les joueurs sont jugés traîtres à la nation. La Fédération intervient dans la confusion et finalement l'équipe, éliminée à la régulière, quitte le Mondial.
La stigmatisation sera forte. Elle aura pour cible des joueurs surpayés (ils prestent hors de France dans les clubs les plus nantis) et qui, pour la plupart, proviennent des quartiers immigrés des banlieues. Partant de quoi, toute une atmosphère anti-jeunes des cités entoure cette condamnation. Et il est bien qu'un sociologue, Stéphane Beaud, qui s'est toujours soucié du football mais aussi du monde immigré, se saisisse de l'événement dans un ouvrage qu'il intitule Traîtres à la nation?, où il s'interroge sur l'état du football français tout en prenant au sérieux la grève des Bleus.
Passionnant, son livre est une enquête qui, pour n'être pas «de terrain», n'en est pas moins méthodique et fouillée. Une question la mène: comment est-on passé en France de l'équipe triomphale de 1998 à l'équipe en déroute de 2010, sachant que le recrutement social n'a pas tellement changé de l'une à l'autre? Il y a certainement qu'au plan général le football a beaucoup évolué et pas dans le meilleur sens. Aujourd'hui, les plus doués sont pris très jeunes en main, deviennent des stars rapidement, jouent dans des équipes étrangères où les enjeux financiers et de prestige sont énormes. Cela donne des champions moralement fragiles et qui ont du mal à s'intégrer à une équipe nationale qui se doit d'être soudée. Il y a aussi que les rapports entre joueurs et médias ont perdu le caractère de confiance qu'ils connaissaient. Les joueurs craignent les notes que leur donnent les journalistes; ces derniers redoutent de ne pas obtenir des joueurs les déclarations souhaitées. À ce propos, Beaud note que, dans l'affaire de l'insulte d'Anelka, la question n'est pas tant de savoir quel joueur a trahi ses copains mais de relever que L'Équipe n'a pas respecté la règle du silence qui protège traditionnellement les conversations des vestiaires sportifs. Aussi faut-il entendre la grève des joueurs en protestation collective contre le comportement de la presse et de l'omnipotente Équipe.
Mais le plus intéressant dans l'ouvrage est la recherche d'une explication de la grève dans la composition sociale de l'équipe de 2010 en regard de celle de 1998. En résumant fort l'analyse de Beaud, on dira que les équipiers de 1998 tiraient avantage de trois facteurs: ils étaient la première génération issue des excellents centres de formation français; s'ils provenaient des couches populaires, ils avaient connu chacun un encadrement familial favorable et structurant; enfin ils appartenaient à une équipe qui avaient des leaders naturels, des «tauliers», grands joueurs ou joueurs reconnus pour leur intelligence. Or, l'équipe de 2010 n'avait pas de ces tauliers mais, en revanche, un noyau issu de ce que l'on peut appeler la nouvelle banlieue, et spécialement «les Antillais» (Gallas, Henry, Anelka, Abidal), qui, jouant dans des clubs prestigieux, estimaient indigne d'eux l'entraînement étriqué auquel les soumettait Domenech. De surcroît, trois de ces Antillais provenaient d'une banlieue parisienne en tension, site d'un brassage multiculturel expliquant leur conversion à l'islam. C'est dire que, tout en faisant de grandes carrières people, ces joueurs portaient avec eux un esprit d'opposition et de révolte qui les transformait en noyau assez soudé au sein de l'équipe et les portait facilement à des gestes d'opposition et de refus.
Dans la seconde partie du volume, Stéphane Beaud systématise l'analyse ébauchée dans la première et traite de ce qu'il appelle «l'arrière-plan socio-historique de la grève», où il revient à l'opposition entre joueurs de 1998 et joueurs de 2010. Il voit dans les premiers les «héritiers du monde ouvrier de la France des Trente Glorieuses». Il perçoit dans les seconds une majorité d'enfants des zones urbaines sensibles mêlés à quelques joueurs de statut social moins fragile, le tout produisant un groupe très clivé. Tout cela à l'intérieur d'une analyse si fine que l'on s'y perd par moments.
Rarement on avait parlé du foot avec autant de discernement en même temps qu'avec autant de bienveillance et notamment envers ceux qui trouvent dans le sport des possibilités de se sortir de milieux précarisés. Inspirée de la sociologie critique, la méthode d'analyse est pour beaucoup dans cette clairvoyance généreuse. Si vous aimez le football et que vous ne l'aimiez pas de façon mystifiée, lisez cet ouvrage. Si vous ne l'aimez pas, lisez-le également. C'est très éclairant.
Stéphane Beaud, Traîtres à la nation ? Un autre regard sur la grève des Bleus en Afrique du Sud, en collaboration avec Philippe Guimard, Paris, La Découverte, « Cahiers libres », 2011. 18 €.



