
Agrandissement : Illustration 1

Pierre Bayard fut, adolescent, éperdument épris de Geneviève Dixmer, l’héroïne du Chevalier de Maison Rouge, au fil des adaptations que donnait en 1963 du roman de Dumas la télévision française. Un roman de cape et d’épée qui fut regardé pendant quelques semaines par des millions de spectateurs conquis et maints jeunes gens d’alors succombèrent au charme lumineux d'Anne Doat qui incarnait l’héroïne.
Devenu adulte et spécialiste de littérature, Pierre Bayard a continué à ne pas accepter la mort de Geneviève Dixmer. Or, dans son métier au cours des ans, le même Bayard s’est forgé tout un arsenal d’instruments de « traitement de textes » et d’infiltration de ces textes. C’est dire qu’on n’est pas vraiment surpris de le voir aujourd’hui faire le projet d’entrer en personne dans le roman de Dumas pour y rejoindre celle dont il n’a pas cessé de déplorer la mort. Le voilà donc qui, dans Aurais-je sauvé Geneviève Dixmer ?, prend la place de Maurice Lindey et tente une expérience inédite d’introduction de sa propre personne dans la fiction. Il est vrai qu’il y eut en 1997 une tentative du même genre venant de Woody Allen : dans The Kugelmass Episode, un professeur aidé d’un magicien, réussissait à entrer dans Madame Bovary, se retrouvait à Yonville et en venait à faire l’amour avec Emma à la stupéfaction de ses étudiants du XXe siècle qui le voyaient ainsi rivaliser avec Rodolphe et avec Léon. Mais là, tout était parodie.
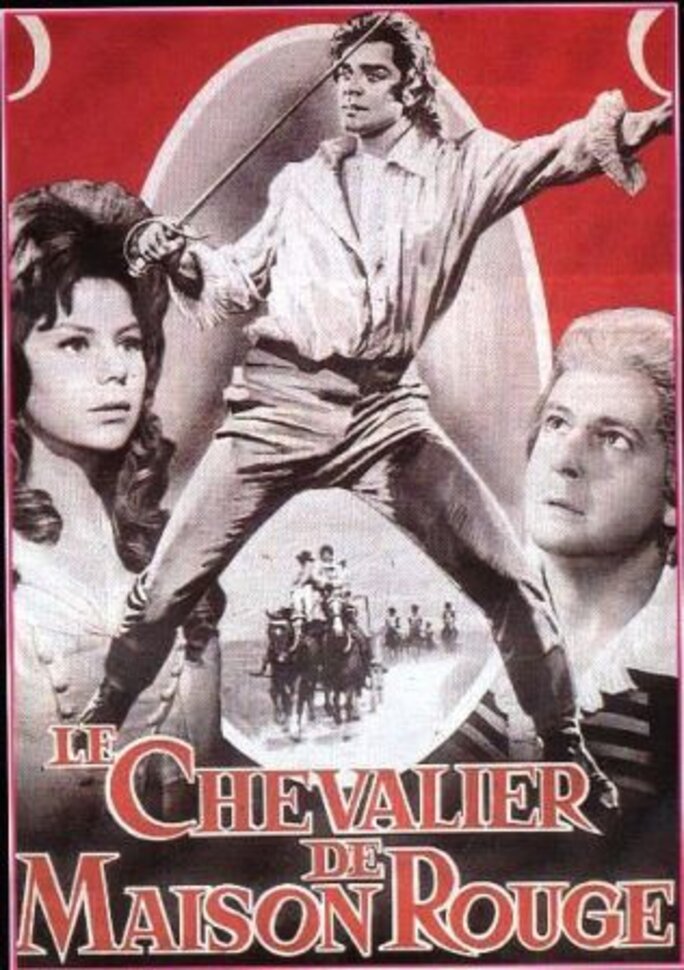
L’entrée de Bayard dans le roman de Dumas relève d’une expérimentation plus sérieuse et plus contrôlée. C’est que le critique entend prolonger l’expérience qu’il a menée en 2013 dans Aurais-je été résistant ou bourreau ? et où il se demandait selon quelles règles morales il aurait agi face à l’occupant durant la dernière guerre. Avec Maison Rouge, la question n’est guère moins lourde (aurais-je été un bon révolutionnaire ?) mais elle est posée en termes plus serrés à l’intérieur d’une seule et même histoire au scénario passablement complexe et surtout à propos d’un épisode historique bien plus éloigné de nous, la Révolution. L’intrigue dumasienne est d’ailleurs conçue de telle façon que le héros mais aussi son amante et son ami Lorin sont pris à répétition dans des conflits de principes, à commencer, pour le « citoyen Pierre », par se trouver écartelé entre le service de la Révolution auquel il s’est mis sans réserve et sa passion pour une royaliste qui avec son mari Ditmer a ourdi un complot visant à sauver la Reine Marie-Antoinette emprisonnée au Temple.
En fait, totalement captivé par son amour, le héros qu’est devenu Pierre Bayard se retrouve manipulé par les comploteurs royalistes qui instrumentalisent sa bonne réputation de révolutionnaire (il est un des chefs de la Garde nationale) pour obtenir tantôt des informations et tantôt des passe-droit rapprochant la Reine du moment de son évasion. Donc le citoyen Pierre trahit et trahira. Le lecteur de Bayard peut d’ailleurs se demander pourquoi il n’en fait pas plus pour se sortir avec la belle Geneviève du réseau malfaisant de la bande des tanneurs. Mais le roman de Dumas réclame d’être suivi à la lettre et voilà donc le citoyen Pierre déchiré plus que jamais entre devoir et désir ; le voilà de même contraint d’affronter des conflits de principes ou de conséquences des principes ou bien encore, selon les terminologies évoquées, des conflits de loyautés qui se dissolvent finalement en conflits de situations. C’est le Bayard critique qui se charge ainsi de l’analyse, ce qu’il fait avec un goût certain pour ce genre d’éthique dialectisée qui nous fait remonter à Kant et à Benjamin Constant.
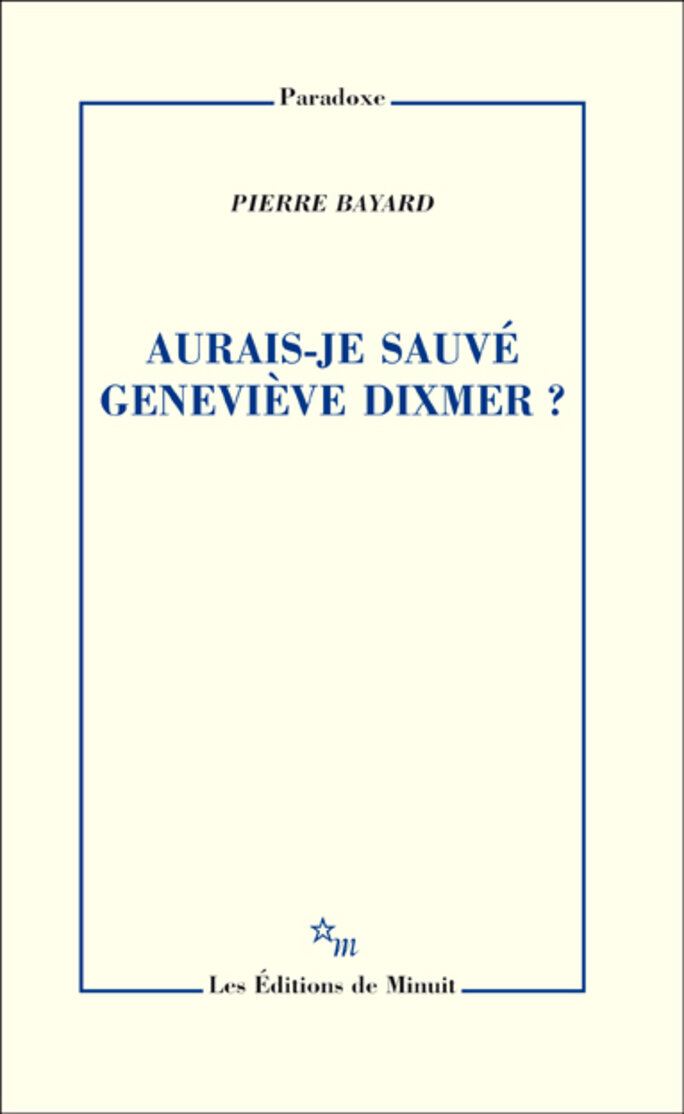
Agrandissement : Illustration 3
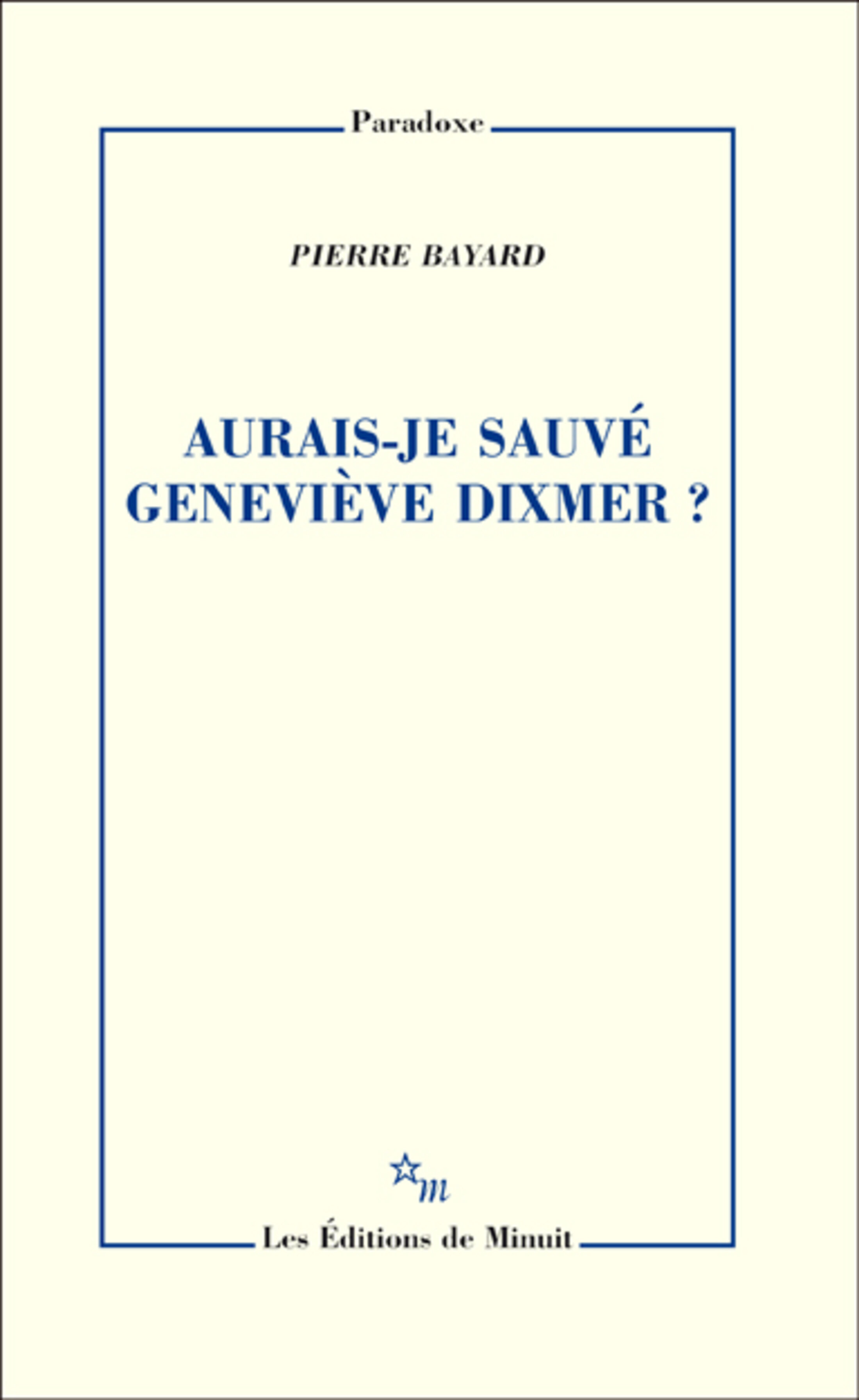
Toute une série de dilemmes moraux sont ainsi évoqués qui renvoient au caractère désordonné de la période révolutionnaire en même temps qu’à l’embrouillamini narratif du roman de Dumas. De quoi se dégage, dans l’épisode final du procès, la belle figure de Lorin, qui s’est laissé embarquer dans la compagnie de Pierre et Geneviève, avec référence au seul principe que celui qui lui donne « charge d’âme » dans une affaire qui aurait dû par ailleurs lui rester étrangère. Et, avec le joyeux et poétique Lorin, nous atteignons à une limite du débat principiel, là où l’humour créatif semble prendre toute la place. « Faire appel à l’humour, écrit Bayard à propos de Lorin, c’est souligner qu’il y a toujours une dimension absurde dans l’éthique de la création, car le sujet qui s’y engage bouscule tous les codes entre lesquels il est sommé de choisir pour mener une action qui ne peut plus être évaluée selon aucun critère puisque, insensée et unique, elle devient à elle-même sa propre norme. » (p. 44) La trouvaille narrative finale ira quelque peu dans le même sens — créatif et ironique — puisqu’elle laisse entrevoir une révision apportée à l’issue du roman. Sans ici la dévoiler, notons que sa force est de donner sens à la tentative éthico-littéraire menée avec quel brio par un Bayard tout ensemble critique et personnage.
Avec sa nouvelle proposition, l’auteur d’une série d’essais inventifs et réjouissants continue à nous emmener sur les chemins d’une critique possibiliste où, à chaque fois, la distinction entre fiction et réalité subit quelque « outrage ». Ce qui ouvre à la lecture rêveuse, à la lecture indexée sur l’inconscient de belles perspectives à chaque fois.
- Pierre Bayard, Aurais-je sauvé Geneviève Dixmer ? Paris, Minuit, 15 € (10 € 99 en version numérique) — Lire un extrait



