Psychanalyste et clinicien dans un service public de Seine-Saint-Denis, sociologue d’esprit de surcroît, Fehti Benslama vient de donner un petit essai dense consacré à la radicalisation et au jihadisme, essai remarquable et de grande importance en raison des méthodes d’analyse qu’il croise. L’auteur part de deux idées qui peuvent sembler communes mais qu’il pose avec beaucoup de clairvoyance. C’est d’abord que l’espèce humaine est désormais confrontée à une violence planétaire au sens où elle peut frapper n’importe qui, n’importe où et n’importe quand. C’est ensuite que ceux qui exercent cette violence et qui n’ont pas toujours été « commandités » sont animés par une haine à l’état brut, haine qui implique le sacrifice programmé du terroriste dans son acte : le plus souvent, le jihadiste veut finir en martyr promis au royaume des cieux. Voir ses ceintures d’explosifs tellement symboliques. Mieux encore : le même jihadiste, qui a peu à voir avec certains terroristes du passé, tient à ce que son acte soit spectaculaire et retransmis le plus directement possible par les médias. Ce qui inscrit son intervention dans une double et terrible circularité.
Mais qui sont ces jihadistes et autres radicalisés ? Benslama entend ne pas réduire leur réalité au seul fait social d’immigrés voués à la misère des quartiers pauvres. Ceux qui s’engagent et basculent vers le jihad sont en majorité des adolescents (ils ont entre 15 et 25 ans) et peuvent appartenir à toute classe de la société ; ils sont pour la plupart des convertis ; quelques-uns sont des femmes. Cela veut dire que le critère social comme déterminant de leur action ne saurait suffire. Il faut donc en appeler à des tourments psychiques pour comprendre ces terroristes et montrer qu’avec eux entre en jeu une double crise d’identité, qui croise le tourment individuel lié à l’adolescence avec le tort fait à la grande communauté musulmane aujourd’hui et à travers les temps. Et Benslama d’écrire : « à des jeunes qui manquent d’estime d’eux-mêmes, qui ont le sentiment d’être ravalés, de ne rien valoir, “d’être un déchet” comme me l’a dit l’un d’entre eux, on propose non seulement la reconnaissance d’avoir subi un préjudice, mais d’être un élu de Dieu, méconnu de lui-même et des autres. » (p. 55) Où l’on relèvera au passage la mention de ce besoin de reconnaissance que le sociologue allemand Axel Honneth fait équivaloir à la plus grande demande sociale de notre époque.
Mais en contexte religieux musulman, cette aspiration à être reconnu ne peut signifier que retour à la tradition, sortie d’un « monde immonde », triomphe de la mort (l’actuel califat irako-syrien est promesse d’apocalypse). « Il y a lieu de parler aujourd’hui, note Benslama, d’un désespoir musulman. » (p. 63) Partant de quoi, l’auteur soutient l’idée que, pour l’islamisme, toute la question est de faire sortir le politique du religieux ou, plus clairement, que le théologique soit seul à gérer les affaires de la communauté des croyants. Voir l’Iran, l’Afghanistan, Daech...
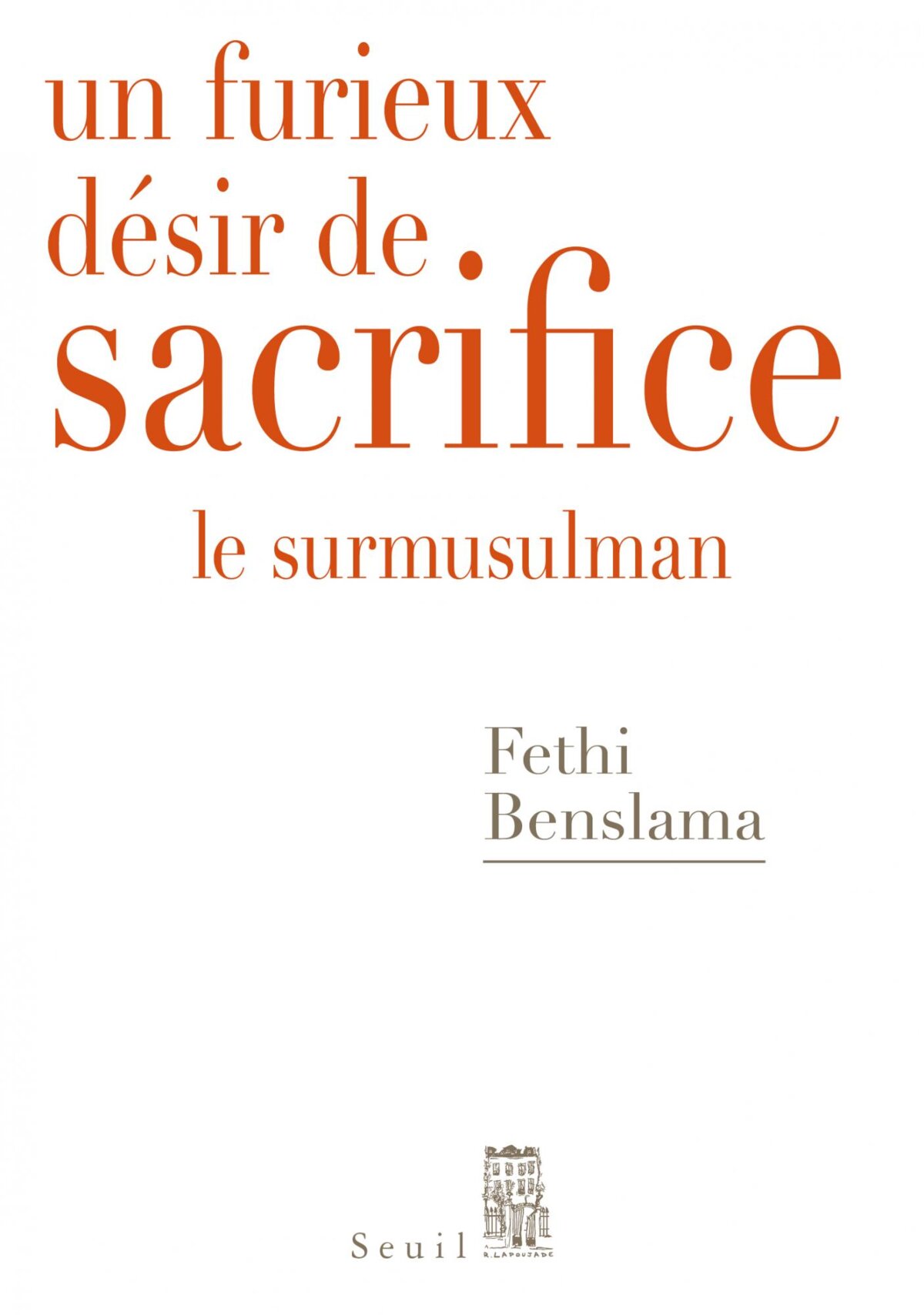
Agrandissement : Illustration 1
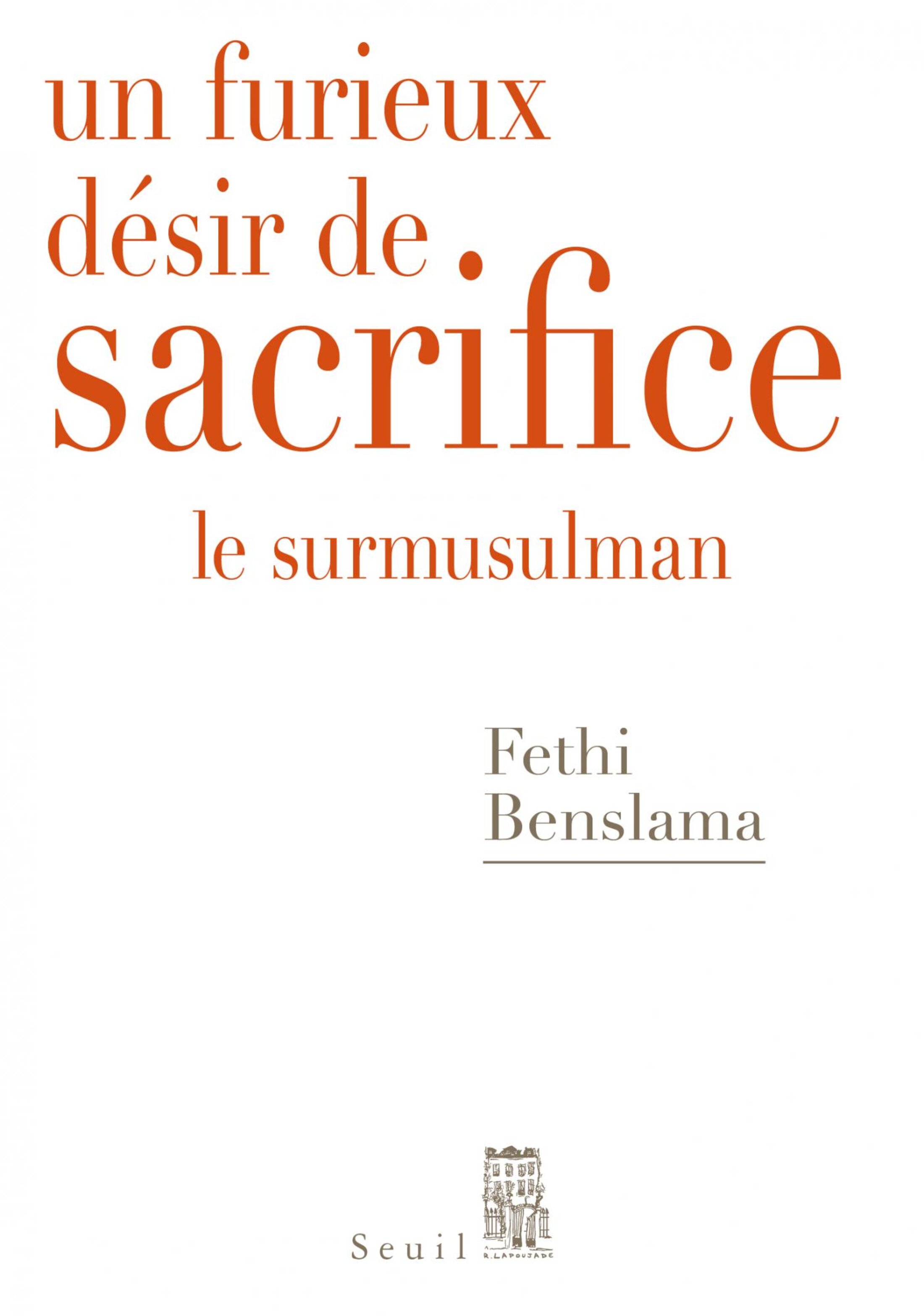
La notion originale qu’introduit ici l’auteur est celle du « surmusulman », où l’on voit le jihadiste s’identifier à un surmoi qui est tout orgueil haineux et total affrontement à la mort dans le combat. Mais cette mégalomanie meurtrière se heurte à un double et réjouissant obstacle. C’est d’abord que les jihadistes et autres radicaux, qu’ils le veuillent ou non, participent de l’affolement technologique des réseaux sociaux et en conséquence des fatwas lancées à tout propos et jusqu’aux plus bouffonnes. Ainsi de celle qui récemment condamnait sans pitié les souris, y compris le Mickey Mouse du satanique Disney. C’est ensuite que la dénonciation du Mal ne peut que se heurter à des problèmes très pratiques de sexualité vécue en société moderne. Qu’une femme musulmane ôte sa burqa lorsqu’elle est au travail peut encore s’admettre dans la logique salafiste mais qu’elle accomplisse ce travail avec un homme comme voisin de bureau, comment l’empêcher et comment empêcher que circulent entre eux des pulsions d’attirance ? Et l’auteur d’évoquer un peu longuement la célèbre « fatwa des tétées » prescrivant à une musulmane en contact avec un collègue de travail de lui donner le sein (jusqu’à 5 fois !) pour qu’il devienne ainsi son enfant, voulant que tout rapport sexuel entre eux prenne valeur d’inceste, c’est-à-dire de crime. Cette fatwa, on s’en doute, déchaîna les rires et jusque dans le monde musulman. Ce qui donne à penser plus sérieusement que le rigorisme islamiste dans ce qu’il a de mortifère périra par une sexualité plus forte que tout, ce qui est plutôt satisfaisant.
Benslama ne termine pas son bel essai sans évoquer le printemps que connut la Tunisie, son pays. Pour lui, même les échecs et les drames qui ont suivi les événements ouvraient de façon bénéfique à une société réfléchie gouvernée par un État national. Et de noter encore à propos du salafisme qui sévit à Tunis comme ailleurs : « dans les variantes fanatiques de ce mouvement, les partisans multiplient les attestations de la présence ancestrale de l’Autre sur leur propre corps, et cherchent à éradiquer tout ce qui peut évoquer la féminité en eux, en se voilant par un virilisme de laideur. » (p. 146) Bref, la femme comme vecteur du Mal et générant une haine à tendance furieuse. C’est précisément par la dénonciation de cette haine que débutait le remarquable essai de Fehti Benslama.
On complètera utilement la lecture de ce dernier par celle d’un travail plus historien de Mathieu Guidère, professeur à l’université de Toulouse, travail portant sur l’islam vu à travers les califats de diverses obédiences qui se sont succédé au cours des siècles. Ainsi la dispersion de ceux-ci entre pays et régions, que l’auteur inventorie avec soin, est particulièrement utile à notre compréhension des événements actuels. Dans ses pages conclusives, Guidère évoque le doute qu’a fait planer le Printemps arabe de 2011 sur l’action jihadiste – impliquant le retrait de beaucoup de ceux qui s’étaient engagés. De là devait presque nécessairement surgir une solution organisationnelle pour le monde musulman dont la formule avait d’ailleurs mûri au long du XXe siècle. Ce fut le califat voulu par al-Bagdhâdi avec sa structure provinciale d’inspiration abasside et sa volonté d’internationalisme. Mais à l’évidence le fonctionnement essentiellement militaire et terroriste de Daech n’ouvre à aucun avenir. Peut-on espérer qu’apparaîtra dans un second temps un panislamisme à fondement idéologique et politique sérieux ? Il y va d’un réveil intellectuel et démocratique tel celui qu’ébauchèrent les printemps arabes.
Fehti Benslama, Un furieux désir de sacrifice. Le Surmusulman, Paris, Seuil, 2016. € 15.
Mathieu Guidère, Le Retour du califat, Paris, « Le Débat », 2016. € 16.



