Il est des romans qui sont de vraies aventures de l’écriture. Fragiles et incertains d’un côté. Résolus et prenant tous les risques de l’autre. Ils tâtonnent, donnent l’impression de ne savoir où aller mais s’avèrent bientôt déterminés dans leur progression. Ainsi du beau récit que vient de donner Caroline Lamarche avec La Chienne de Naha. Le lecteur hésite, tâtonne avec l’auteure, puis s’avise de ce qu’il est emporté par la force et la pureté de l’écriture. Tout agit : phrases brèves, formules subtiles, inflexions tremblées, réflexions tranchantes.
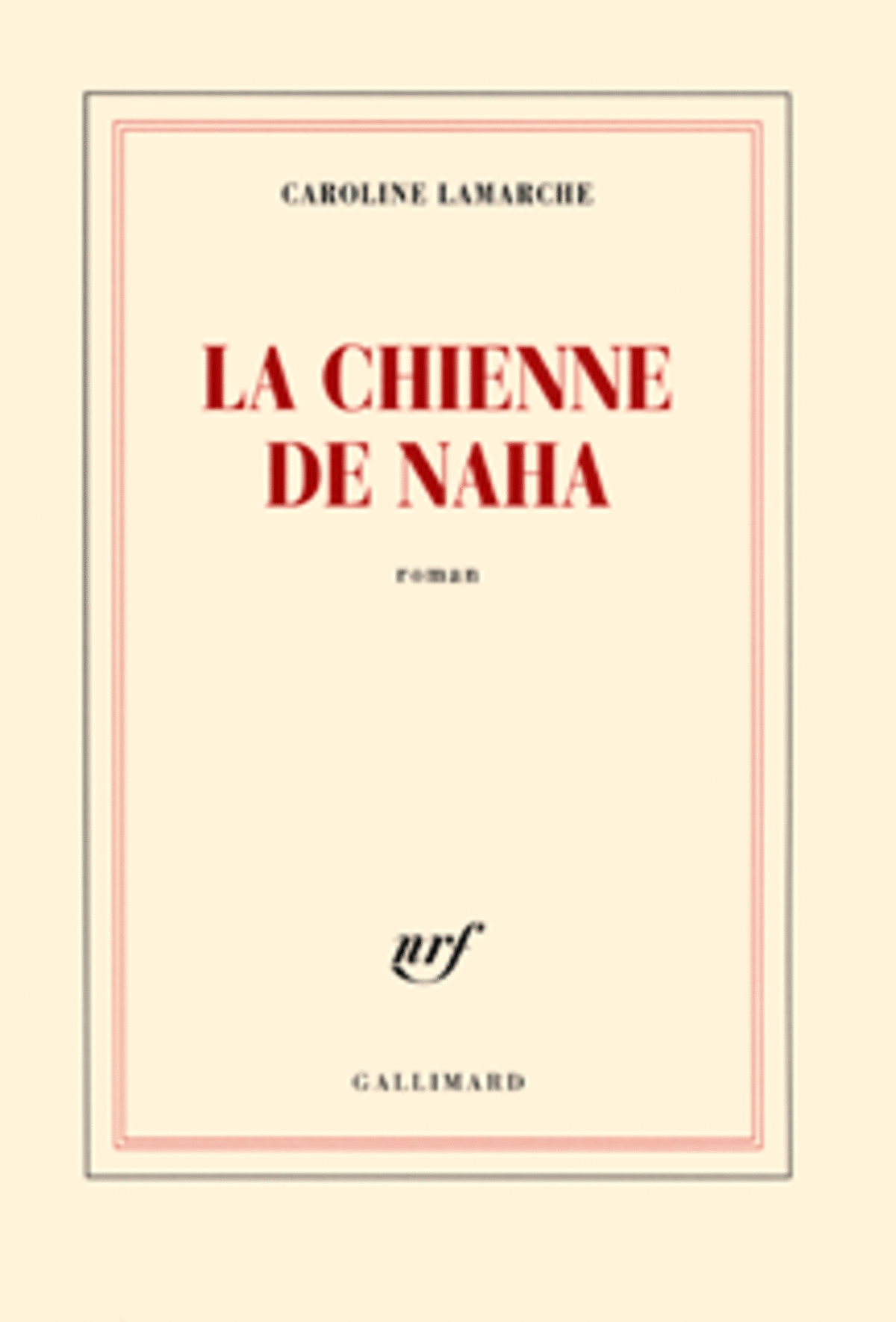
Cette écriture-là est dans le rapport le plus intime avec ce qui la porte et la figure, ce voyage qui emmène la narratrice jusqu’au cœur d’un Mexique secret, scandé par les localités d’Oaxaca, d’Etla et de Copala. Accédant au pays des Triquis, la narratrice nous apparaît de prime abord en ethnologue explorant une contrée rebutante, dont elle ne comprend ni la langue ni les coutumes. Mais ce qu’elle saisit fort et qui convient à son humeur est la présence de la mort à chaque coin de rue, tantôt célébrée (nous sommes à la Toussaint), tantôt active et menaçante (chez les Indiens du lieu, des clans s’entretuent).
Le parcours de la narratrice n’a cependant rien d’erratique. Tout est programmé, et parfois à distance, par la belle Maria. Maria fut la compagne d’enfance de la narratrice, en tant que fille d’une servante qui fut une autre mère pour l’héroïne. Devenue adulte et installée au Mexique, en pays triqui, s’occupant avec son compagnon d’une Casa de fortune où l‘on donne à des jeunes une éducation, Maria a appelé un jour sa « petite sœur » et, après tant d’années, lui a dit : «Vien, viens». Loin de la commune enfance à Montreuil, Maria programme donc l’itinéraire en pays inconnu de sa cadette et c’est un peu comme si elle faisait basculer tout un passé dans le présent. De là, chacune des deux époques joue en miroir de l’autre. Régissant le voyage de la narratrice-héroïne, Maria est pour elle une Ariane que l’on aperçoit avec émoi dans sa jupe fendue par-devant, un grelot tintant entre les jambes.
Quatre femmes donc –deux mères, deux filles– dans le chassé-croisé des souvenirs. Quatre femmes et leurs hommes absents. Quatre femmes diversement vivantes, y compris Luisa la morte, dont l’image hante le texte (l’héroïne n’est pas allée à ses funérailles et s’en veut encore). Quatre femmes et la question sous-jacente: qu’est-ce qu’être femme ? où est la place du féminin ? Consignée en première page du roman, une légende triqui propose une réponse, racontant l’hisoire de l’homme de Naha qui vivait avec une chienne et la surprit un beau jour dépouillée de sa peau et lui préparant des tortillas. Merveille pour lui que cette femme assurant la vie de la maison. Mais, pris de colère, il la coupa un jour en deux. Une moitié versa dans la vallée; l’autre moitié, découpée en morceaux, donna à l’homme ses enfants.
En fin de roman, lorsque le jeune Juanito dira pour la narratrice le conte fondateur, elle se sentira clivée dans l’instant: «Non violemment et d’un coup sec, comme dans le conte, mais lentement, détachant soigneusement les deux parties de mon être. Une moitié tombe en morceaux devant moi, des morceaux lumineux et intenses comme autant de petites veilleuses dans leur prison de verre, tandis que l’autre disparaît dans la nuit» (p. 185). Se retrouve ainsi scindée en deux parts celle qui, dès l’origine, eut droit à deux mères si dissemblables.
Mais femme nocturne ou femme diurne? Brisée par le rejet violent d’un homme aimé dont le souvenir la poursuit, l’héroïne vit donc son expérience triqui dans la mélancolie et le culte des morts. Pour un rien, elle disparaîtrait dans la nuit et partagerait le dialogue ininterrompu de ceux qui résident sous terre et se parlent d’un bout à l’autre du monde. Mais la voilà qui se ressaisit, se rappelant la parole christique: «Laissez les morts enterrer leurs morts». Il faut tenter de vivre ! Lui revient alors une image d’enfance, celle d’un garçon et d’une fille se battant en duel sur un mur. Alors qu’elle chute, «le garçon miraculeusement rattrape la fille par la taille», la tenant serrée contre lui (p. 197).
Image de bravoure pour clore le périple et le livre. Comme une récompense de rêve au terme de ce voyage exploratoire des autres et de soi, au long duquel la narratrice a surmonté avec une rare vaillance (ah ! cette terrible montée à vélo où tout l’abandonne) sa tentation de la nuit funèbre. Ainsi finit de s’écrire le roman si prenant d’une Caroline Lamarche qui nous donna naguère Le Jour du chien ou Karl et Lola et qui, d’une écriture fragile mais décidée, une écriture où les phrases semblent tenir toutes seules, va chercher loin au fond d’elle-même.
Caroline Lamarche, La Chienne de Naha, Paris, Gallimard, 2012. 17, 50 €.



