La mondialisation ne nous atteint guère que par ses pires effets : dérèglement climatique, terrorisme à l’échelle mondiale, désastre humanitaire des migrations, crises financières et sociales. La Terre et, avec elle, l’espèce humaine sont-elles ainsi en train de courir à leur perte ? Comment concilier les forces contradictoires qui agitent le monde ? Et comment gouverner l’univers planétaire qui se dessine sans recourir à la domination d’un seul – un dictateur sans doute ?

Pour esquisser une réponse d’ensemble à ces questions, une juriste de haut vol, Mireille Delmas-Marty, se mue en navigatrice proposant la fable envoûtante de la rose des vents, soit un faisceau de solutions possibles mobilisant les forces imaginantes du droit – en référence à de grandes résolutions internationales, depuis la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) jusqu’à la COP 21 (2015). Deux notions fondatrices inspirent cette fable toute métaphorique et aident son auteure à y voir clair. C’est, d’une part, l’idée basique d’interdépendance des groupes humains à l’échelle du monde mais également de ces mêmes groupes avec l’écosystème terrestre que l’on nomme Anthropocène ; de l’autre et découlant de la précédente, la nécessaire solidarité de l’être humain avec un autrui infini et de cet être avec son site de vie.
Mais revenons à la rose des vents et aux directions qu’elle indique, qui sont quatre de prime abord et huit pour suivre. Et c’est comme un grand jeu gouverné en l’occurrence par un esprit soutenu de recherche d’équilibre. Pour Delmas-Marty, chaque branche de cette rose métaphorique peut figurer l’une des grands principes mobilisateurs de l’action humaine aujourd’hui mais tels que, par couples, ils tendent à s’opposer l’un à l’autre et à verser dans le conflit.
Le duo le plus exemplaire mis ici en exergue est sans doute celui de la Liberté et de la Sécurité. On sait combien les attentats terroristes s’accomplissant aux quatre coins du monde ont suscité une demande toujours accrue de protection de la part des groupes sociaux. Mais il s’ensuit forcément que tout renforcement de la sécurité ne se fait qu’aux dépens de la liberté individuelle ou collective. Comment dès lors trouver la juste mesure et échapper, par exemple, à une démagogie du tout-sécuritaire ? Un équilibre est sans cesse à rétablir et il passe par des conciliations difficiles, souvent orageuses, qu’elles s’inscrivent ou non dans des lois.
L’autre grand axe est celui de la Compétition opposée à la Coopération. Les traités d’échanges commerciaux qui se discutent actuellement entre continents de part et d’autre de l’Atlantique illustrent bien cette contradiction. Sous les dehors d’une collaboration, c’est une compétition acharnée qui se dissimule sans doute mais qui a aussi sa raison d’être. Toujours est-il que, par-delà ce cas particulier, l’ouverture des marchés, consécutive à la fin de la guerre froide, a eu des conséquences désastreuses pour les pays les plus fragiles. De là, d’énormes mouvements migratoires auxquels les pays riches ont grand mal à faire face. « Pour corriger, écrit l’auteure, les excès d’une mondialisation qui, au nom de la liberté d’entreprendre, tend à détruire la sécurité économique et financière, il faudrait équilibrer l’esprit de compétition et l’esprit de collaboration en appliquant le devoir de solidarité » (p. 91). Malheureusement, note-t-elle aussitôt, la solidarité ne fait pas encore partie des droits civils et politiques si bien que, comme on l’a vu, l’accueil fait à des sans-papiers est susceptible de transformer une volonté légitime de solidarité en délit de droit commun.
Vient en troisième position le couple Innovation-Conservation. D’un côté, le progrès scientifique et technologique, de l’autre, le devoir de préserver l’habitat terrestre mais aussi la santé. C’est la ligne du temps qui est ici primordiale. L’auteure évoque à ce propos et de façon plus que nuancée le principe de précaution-anticipation. Il est ici question de deux appréciations bien distinctes et qui concernent les évaluations à caractère juridique. « Il faut en effet déterminer un seuil, relève la juriste, qui tienne compte à la fois de la marge scientifique de vraisemblance et de la marge sociale de tolérance. » (p. 98). En fait, dans le cas par exemple de l’autonomie des robots, on atteint rapidement une limite où les distinctions se brouillent au risque également partagé de paralyser l’innovation et de mettre en danger la conservation.
Enfin l’opposition ultime est celle de l’Exclusion et de l’Intégration. L’actualité presse ici les politiques et les juristes de trouver sans retard des solutions efficaces. On songe à l’Allemagne de Merkel engagée dans un élan généreux et qui se voit forcée de corriger le premier mouvement sous la pression d’un parti populiste. L’auteure met ici en avant un « universel pluraliste » dont les réalisations pratiques sont, pour elle, toutes culturelles, soit l’échange dialogué, la traduction et la transformation réciproque telle que l’a définie le grand écrivain martiniquais Édouard Glissant et qu’il nomme créolisation.
Férue de solidarité, et l’on ne peut qu’applaudir, Mireille Delmas-Marty a appliqué ce principe majeur à la stylistique même de son beau livre. C’est d’abord sa Ronde des vents qui a le grand mérite d’introduire des souffles contradictoires dans un mouvement unique et circulaire (voir figure page 107). Mais c’est aussi que, de section en section de son ouvrage, l’auteure lie avec beaucoup d’art tout développement qu’elle propose à celui qui lui succède. Tout est décidément solidaire dans son analyse et elle le fait paraître au plus près de sa pensée et de son discours, tous deux d’une rare qualité. Ce qui nous vaut pour les temps actuels un véritable manuel de vie en société. À lire donc sans retard.
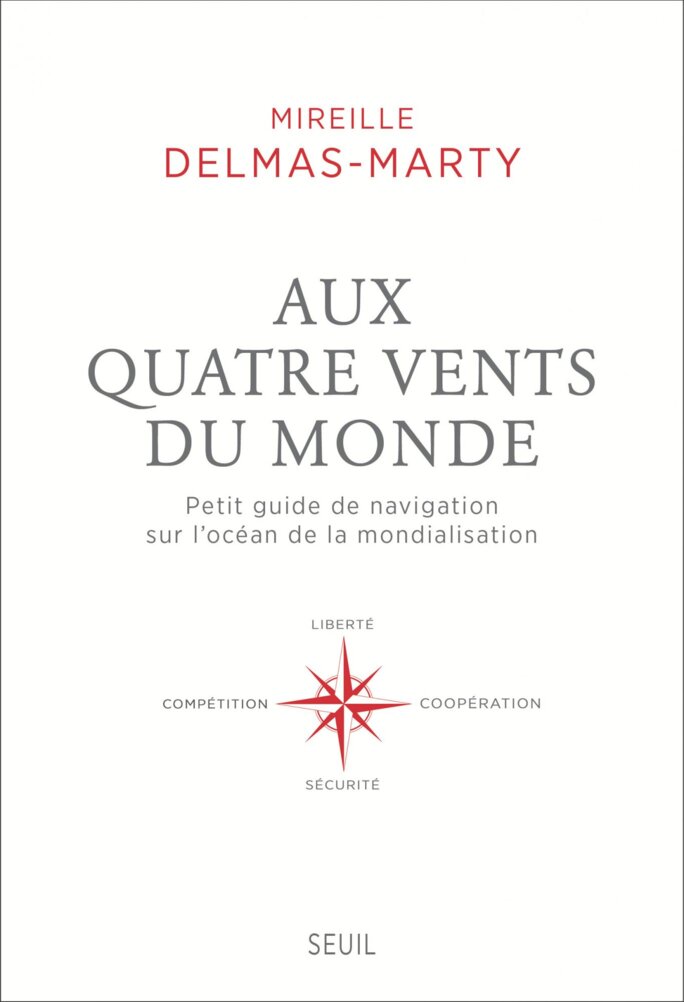
Agrandissement : Illustration 2
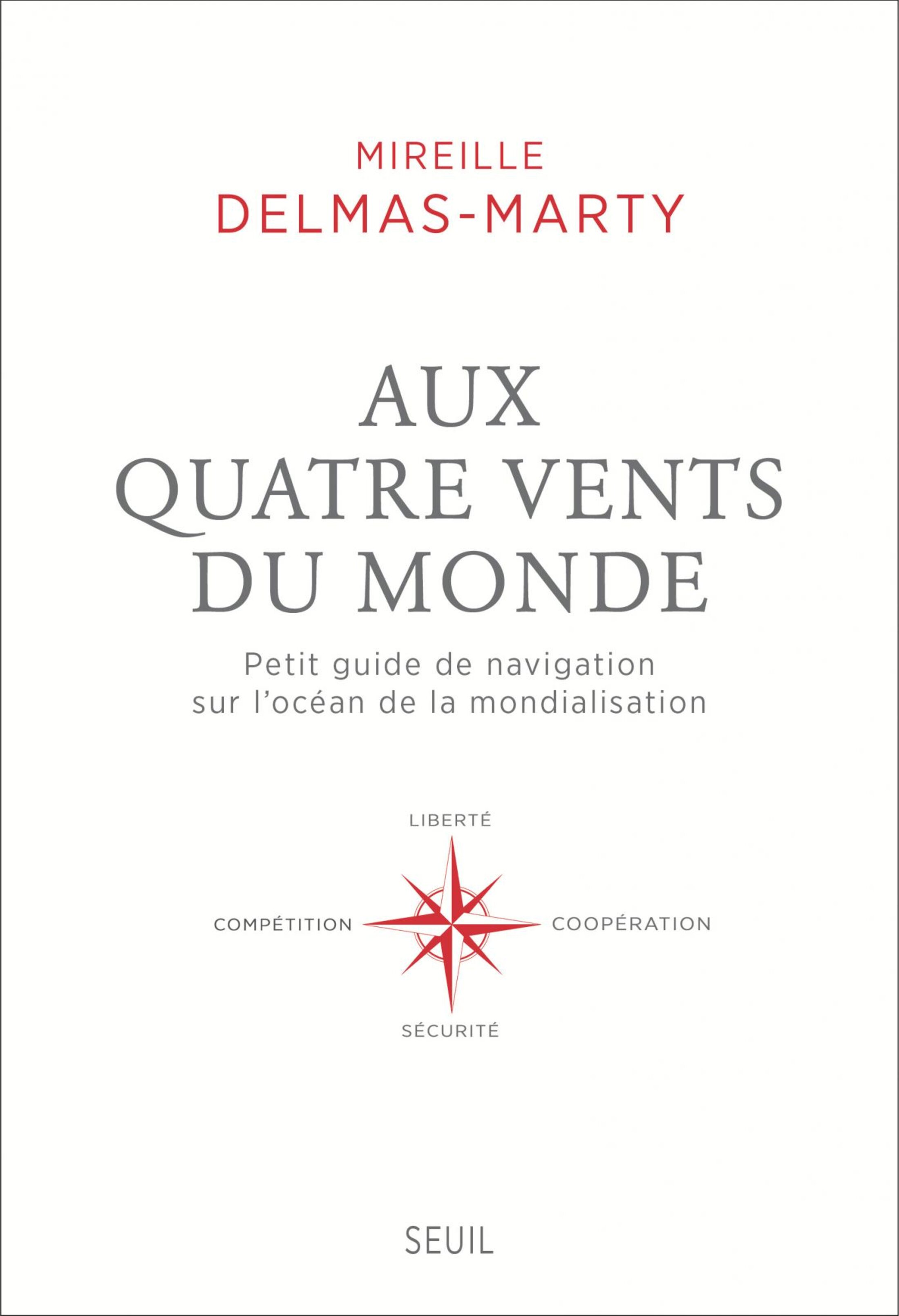
Mireille Delmas-Marty, Aux quatre vents du monde. Petit manuel de navigation sur l’océan de la mondialisation, Paris, Seuil, 2016. € 17.



