Oui, voici un Kafka que n'eût pas renié Pierre Bourdieu et qui séduit par sa radicalité même. Il est l'œuvre de Pascale Casanova, critique et professeure, qui donna en 1999 une République des lettres étonnante,où elle décrivait l'existence d'une littérature mondiale avec sa temporalité propre et ses luttes de domination de grande violence. Dès cet ouvrage, elle relevait le cas singulier de Franz Kafka devenu vers le milieu du XXe siècle un champion de notre modernité au prix d'une complète occultation de ses caractéristiques culturelles et nationales comme de son combat politique.
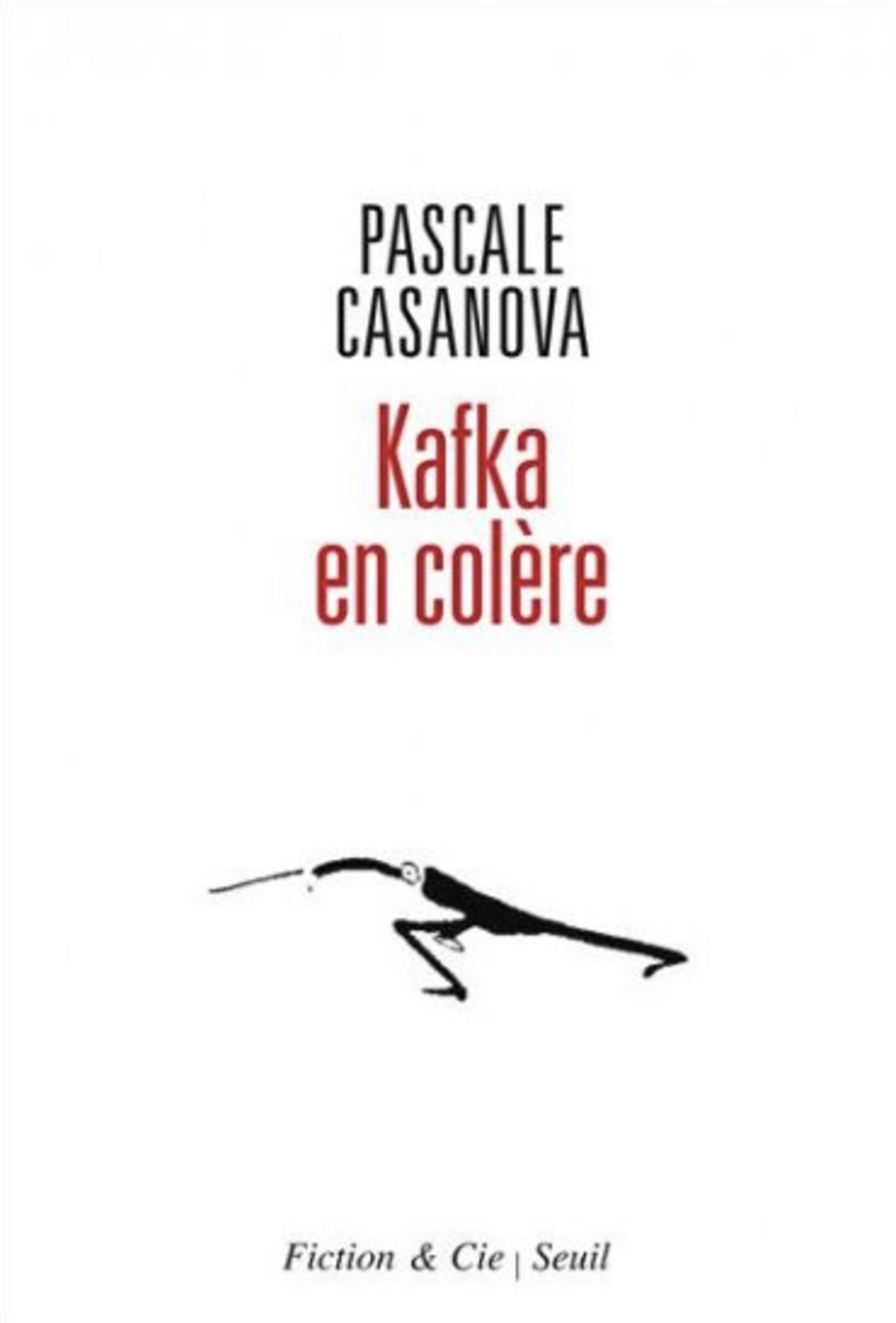
Aujourd'hui Casanova rouvre le dossier Kafka et le soumet à une analyse méthodique, qui va exemplairement dans le sens d'une histoire sociale de la littérature. Ce qui se traduira par l'examen méthodique de quatre objets étroitement corrélés: le champ littéraire pragois au début du XXe siècle et ses conflits internes; l'habitus de l'écrivain en fondement d'un positionnement politique; la dénonciation par le même des formes littéraires dominantes et l'adoption de nouvelles procédures d'expression; Le Procès et Dans la Colonie pénitentiaire comme démontages, depuis une position de combat, des variétés de la domination symbolique et de leurs effets dévastateurs. Un trajet impeccablement méthodique, qui va donc du «champ des possibles» idéologiques et littéraires pour aboutir à la création et à ce qui fait sens en celle-ci.
De ce parcours exigeant ressort la figure en tout point vivante d'un Franz Kafka animé par une pulsion colérique qui est refus de la situation qu'il subissait en tant qu'intellectuel juif. Il y va chez l'écrivain d'une prise de conscience violemment critique de ce que, à Prague comme à Vienne à l'époque, les gens de son espèce ne trouvaient leur place qu'en cédant à une assimilation à la culture allemande. Pourtant, à travers le sionisme, qui venait d'apparaître, une issue autre se dessinait aux yeux de certains bourgeois libéraux tels que ce Max Brod, qui fut le grand ami de Kafka. Mais, pour ce dernier, qui voit à ce moment-là des centaines de milliers de Juifs de l'Est européen immigrer vers les États-Unis et aller s'y prolétariser, le sionisme est une solution fallacieuse parce que typiquement «occidentale».
C'est ici que se produit une rupture décisive dans la conscience de Kafka. Elle correspond au temps le plus fort de la «démonstration» menée par Casanova –une démonstration parfois trop uniment «démonstrative». En 1911, Franz assiste au café Savoy de Prague à des représentations données par une compagnie théâtrale de Juifs polonais. D'emblée il se lie avec le directeur de la troupe, Löwy, qui lui fait découvrir une culture populaire intense et qui n'a rien de fabriqué, celle des shtetls de Pologne, de Galicie et d'ailleurs. Aux yeux de Kafka, malgré la langue étrange dans laquelle elle s'exprime, malgré la trivialité de ses thèmes, cette culture, cette yiddishkeit va devenir quelque chose de fort et de vrai, exprimant l'existence souvent misérable du petit peuple juif d'Europe de l'Est. Elle proposait d'ailleurs des formes d'expression, telles que conte ou fable animalière, dont l'écrivain de Prague allait s'inspirer. Dans cette ligne, Casanova pointe chez l'écrivain des convictions socialistes et les reconnaît même dans ses écrits «professionnels» lorsqu'il plaide par exemple pour l'extension du droit des ouvriers à l'assurance.
Cette radicalité d'une position va se manifester dans quelques grands textes de l'écrivain tels que les analyse la quatrième partie du volume. Casanova s'y oppose aux interprétations classiques qui versent dans le piège d'une confusion entre le narrateur des récits et l'auteur lui-même. Pour elle, celui qui occupe dans ces récits le point de vue central est la plupart du temps un «narrateur-menteur» qui avalise sans le dire une légitimité scandaleuse. Ainsi, dans La Colonie pénitentiaire, «il semble que l'on ne puisse comprendre la puissance de dénonciation froide du récit que si l'on fait l'hypothèse que le voyageur [par les yeux duquel le lecteur perçoit les choses] est en réalité un parfait représentant des intellectuels occidentaux, lâches et soumis à l'ordre social et à sa violence» (p. 277).
S'il faut donc cesser de rabattre les narrateurs sur l'auteur des textes, cela n'empêche en rien, note encore Casanova, que Kafka mette en scène son propre groupe d'appartenance tel que ce groupe était selon lui mystifié et que, victime d'une violence symbolique, il s'incorporait la loi du bourreau. Pour rappel, dans son Franz Kafka. Éléments pour une théorie de la création littéraire (La Découverte, 2010), Bernard Lahire, qui saisissait l'œuvre de Kafka sous un angle bien différent, faisait, lui aussi, une large place à ce qu'il nommait «la contribution du dominé à sa condition».
Pour Casanova enfin, la «colère» de Kafka en tant que réponse à une domination socio-historique inscrite et précise, n'handicape nullement la portée universelle d'une œuvre. Tout au contraire, l'écrivain pragois est d'autant plus grand et plus passionnant que sa dénonciation ne se perd pas dans la généralité vague du fonctionnement absurde d'une répression.
Pascale Casanova, Kafka en colère, Paris, Seuil, « Fiction et Cie », octobre 2011. 25 €.



