De nombreux volumes ont été consacrés à la personnalité scientifique de Bourdieu, faisant de celui-ci le plus grand sociologue apparu depuis Émile Durkheim et Max Weber. Quelques-uns de ces ouvrages étaient remarquables. Celui que vient de publier au Seuil Jean-Louis Fabiani les surpasse tous à nos yeux. C’est d’abord que ce Pierre Bourdieu, qui rassemble une énorme quantité de données et d’aperçus, se réclame d’une écriture non seulement élégante mais dotée d’une rare vivacité, où une verve très affective se marie volontiers à un brin d’insolence. C’est ensuite que Fabiani laisse voir qu’il n’est pas un strict disciple du maître même s’il le respecte grandement : ayant souvent enseigné aux Etats-Unis et nourri de sociologie US, Fabiani s’entend, lorsqu’il le faut, à mettre à distance la sociologie tellement française de Bourdieu. C’est enfin que le critique condense à même le sous-titre de son livre l’œuvre d’une vie dans un oxymore à la fois judicieux et malicieux, parlant d’un « structuralisme héroïque ».
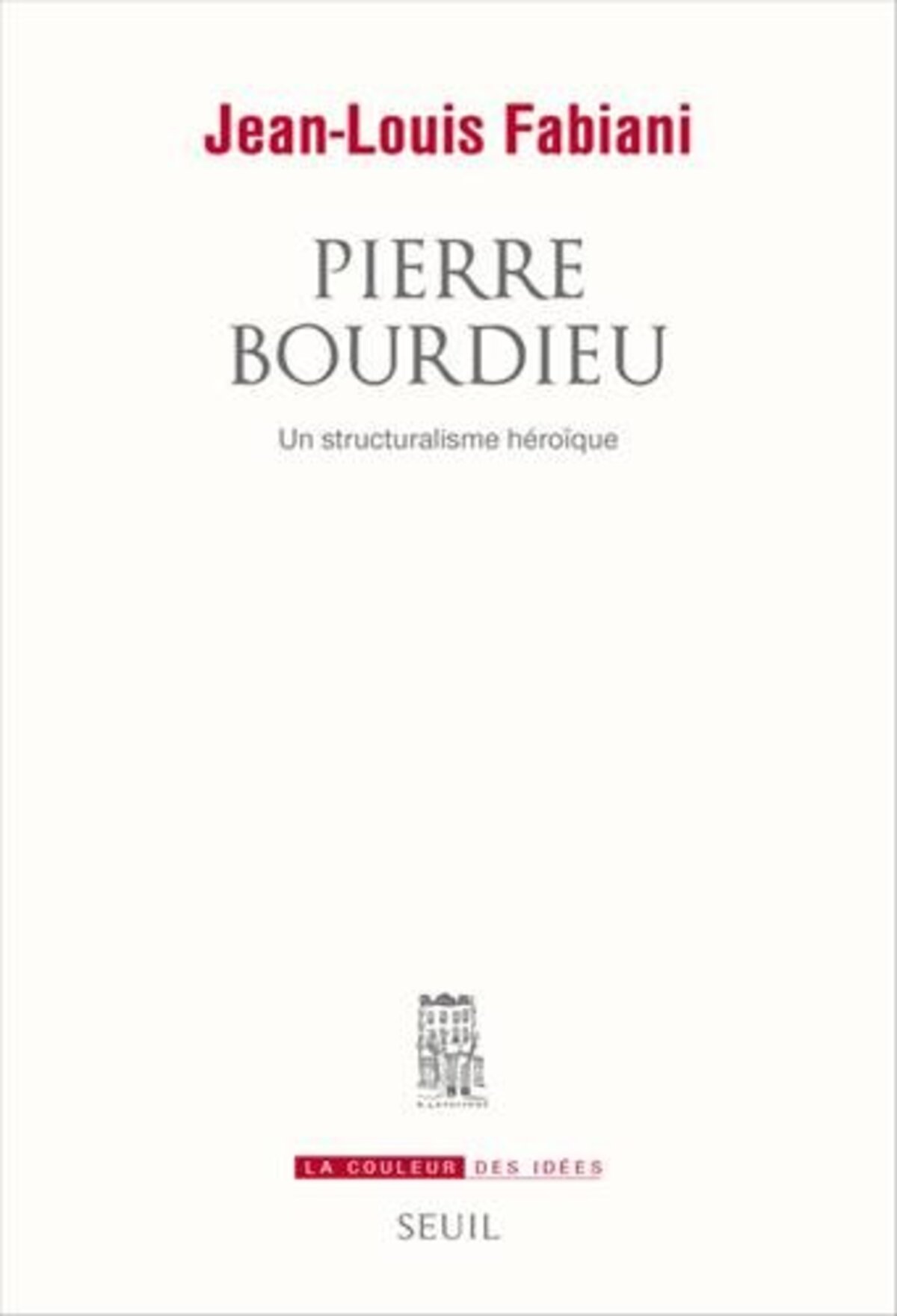
Pour le structuralisme, on voit bien : loin d’être affiliée à Saussure ou à Lévi-Strauss, toute la théorie bourdieusienne se pense dès l’origine comme structure construite autour de quelques grands notions polaires telles que champ, habitus, capital ou effet symbolique.
L’héroïsme, lui, surprend davantage et pourtant avec Fabiani on se sent tout prêt à reconnaître que Pierre Bourdieu s’est pensé en champion de l’œuvre qu’il a édifiée. Ainsi, au long de son parcours, Bourdieu apparaît d’emblée en conquérant, qui, désertant sa formation philosophique d’origine, s’engagea hardiment et à la faveur de son service militaire algérien dans une discipline qui existait mal ou peu – la sociologie – et la transforma en véritable science. Il fut ainsi d’emblée un fondateur d’école très exigeant quant aux principes et à la méthode. Par ailleurs, le même Bourdieu, ce provincial que son maître Canguilhem voyait revenir enseigner dans une faculté de sa région d’origine, allait franchir à grandes chevauchées les étapes d’une carrière qui se dispensa hardiment de la thèse de doctorat malgré les conseils de cet autre protecteur que fut Raymond Aron et se retrouva directeur d’études à l’EHESS, puis titulaire de chaire au Collège de France. Conquérant encore mais bien autrement que ce Bourdieu qui, ardent défenseur de l’autonomie de la science comme d’une stricte méthodologie statistique, s’engage en 1995 en faveur de grévistes auxquels il offre le secours de ses connaissances.
Mais, pour Fabiani, s’il est un ultime rôle héroïque adopté par le grand sociologue, c’est lorsque Bourdieu choisit de se consacrer aux littérateurs et peintres qui, en fin de XIXe siècle, parient sur une autonomie radicale de l’art et se voient, tel Flaubert, Baudelaire ou Manet, en fondateurs d’hérésies qui sont autant de révolutions symboliques que l’on accomplit à peu près seul dans son coin. Ainsi le Manet de Bourdieu, comme l’a montré Pascale Casanova, peut se lire en autobiographie dans laquelle le sociologue se magnifie héroïquement – et d’autant mieux que, là où Manet bénéficia de la dotation initiale de son milieu bourgeois, Bourdieu, « fils du peuple », ne put jamais compter que sur lui-même.
Mais revenons en arrière et aux premiers chapitres du livre, où Jean-Louis Fabiani se livre à un examen critique des concepts qui furent les piliers de la construction bourdieusienne, couronnant l’ensemble par un hommage à la prodigieuse inventivité méthodologique du sociologue. Et de commencer par faire apparaître que la notion de champ, qui s’est si largement répandue dans le public, est la plus incertaine de celles que la théorie a mises en œuvre. Car on peut hésiter : ce champ comme espace d’autonomie assorti de luttes internes correspond-il à un modèle qui s’est reproduit au long de l’histoire ou est-il étroitement lié pour la culture française à cette fin du XIXe siècle qui fait de l’art pour l’art un mot d’ordre inédit ? Le débat demeure autour de cette question troublante. En revanche, l’habitus comme forme incorporée d’une histoire en chaque individu ou encore comme passé habitant le présent et déterminant les actes posés par chacun apparaît comme l’axe irrécusable de toute la structure. Si l’on passe enfin au capital dans la variété de ses formes, du plus économique au plus culturel, le critique voit bien que le « capital symbolique » est celui qui réussit à coiffer tous les autres, à la façon dont il transforme les biens de toute espèce en pouvoir, en distinction ou en prestige, et produit du fait même des effets fréquemment déniés mais considérables.
La collaboration de ces trois concepts ne s’est jamais aussi bien donnée à voir que dans ce volume extraordinaire qu’est La Distinction, où le recours à l’analyse géométrique des données statistiques produit des tableaux mal déchiffrables mais puissamment évocateurs. Or, à travers l’importante figuration graphique et photographique qu’elle déploie autour des sujets traités, La Distinction comme représentation de la France culturelle la plus diverse, en appelle à une collaboration soutenue du lecteur, ce qui rend l’ouvrage passionnant. Avec, en contrepartie, un déficit théorique que Fabiani épingle en passant et selon lequel, dans l’ouvrage, « La théorie de la domination ou celle de la légitimation n’ont jamais fait l’objet ni d’un exposé en forme ni d’une tentative de corroboration empirique.» (p. 156)
Autre grief que l’on a parfois fait à La Distinction et qui revient ici : Bourdieu décrit un état dépassé des pratiques et comportements culturels – une sorte de France des années 50. Et c’est un peu comme si son analyse souffrait de cette hysteresis dont il aimait à parler à propos d’agents sociaux dont l’habitus n’est plus à jour. Hysteresis encore mais bien autrement lorsque, en 1995, Bourdieu prend le parti d’un vaste mouvement de grève et descend à cette occasion dans l’arène. Et Fabiani d’observer que le Bourdieu qui harangue ainsi la foule soutient à cette occasion non pas la classe ouvrière comme on pourrait le croire mais des fonctionnaires, cheminots ou postiers. C’est en défenseur des services publics qu’il intervient là, lui qui fait partie de ces mêmes services et, mieux encore, qui, républicain par toutes ses fibres, partagé entre le grand savant et l’instituteur du peuple qu’il est tour à tour, a étroitement adhéré à l’éducation à la française, continuant ainsi un Émile Durkheim. De là, ses déceptions quant à l’enseignement de masse ou encore à celui du Collège de France, ces lieux où l’enseignant ne sait plus trop à qui il s’adresse. Occasion pour lui, tenant de l’État-providence, de stigmatiser les méfaits du néolibéralisme en matière de culture.
À ce propos, on s’est demandé si le sociologue était proche du marxisme. Certes, Bourdieu a lu et bien lu Marx mais il marqua tôt sa rupture avec tout ce qui s’en inspirait trop directement, depuis l’althussérisme jusqu’à cette révolution manquée que fut pour lui Mai 68. Et cependant Pierre Bourdieu avait une conscience vive de ce qu’il allait appeler « la misère du monde ». Dans le livre ainsi intitulé, il lança avec ses collaborateurs une enquête sur tous ceux qui souffraient dans la France de la fin du XXe siècle. Enquête énorme et insoucieuse de méthode ou de statistique. Donnant la parole à beaucoup de ceux qui ne l’ont pas, elle eut un grand retentissement. À cet ouvrage, on associera une autre forme de dénonciation traduite dans cette Domination masculine (1998) où le sociologue démonte les effets d’un ancestral abus de pouvoir qui ne connaît de trêve que là où, dans un couple, le don de soi réciproque interrompt les règles de compétition du jeu social. Et ici Bourdieu s’avoue las d’un habitus viril qu’il entend mettre à distance au nom d’une forme neuve de fraternité humaine. Héros cette fois encore et héros d’un « genre » ultime.
Jean-Louis Fabiani, Pierre Bourdieu. Un structuralisme héroïque, Paris, Seuil, « La couleur des idées », 2016, € 21. En librairie dès le 7 avril prochain.



