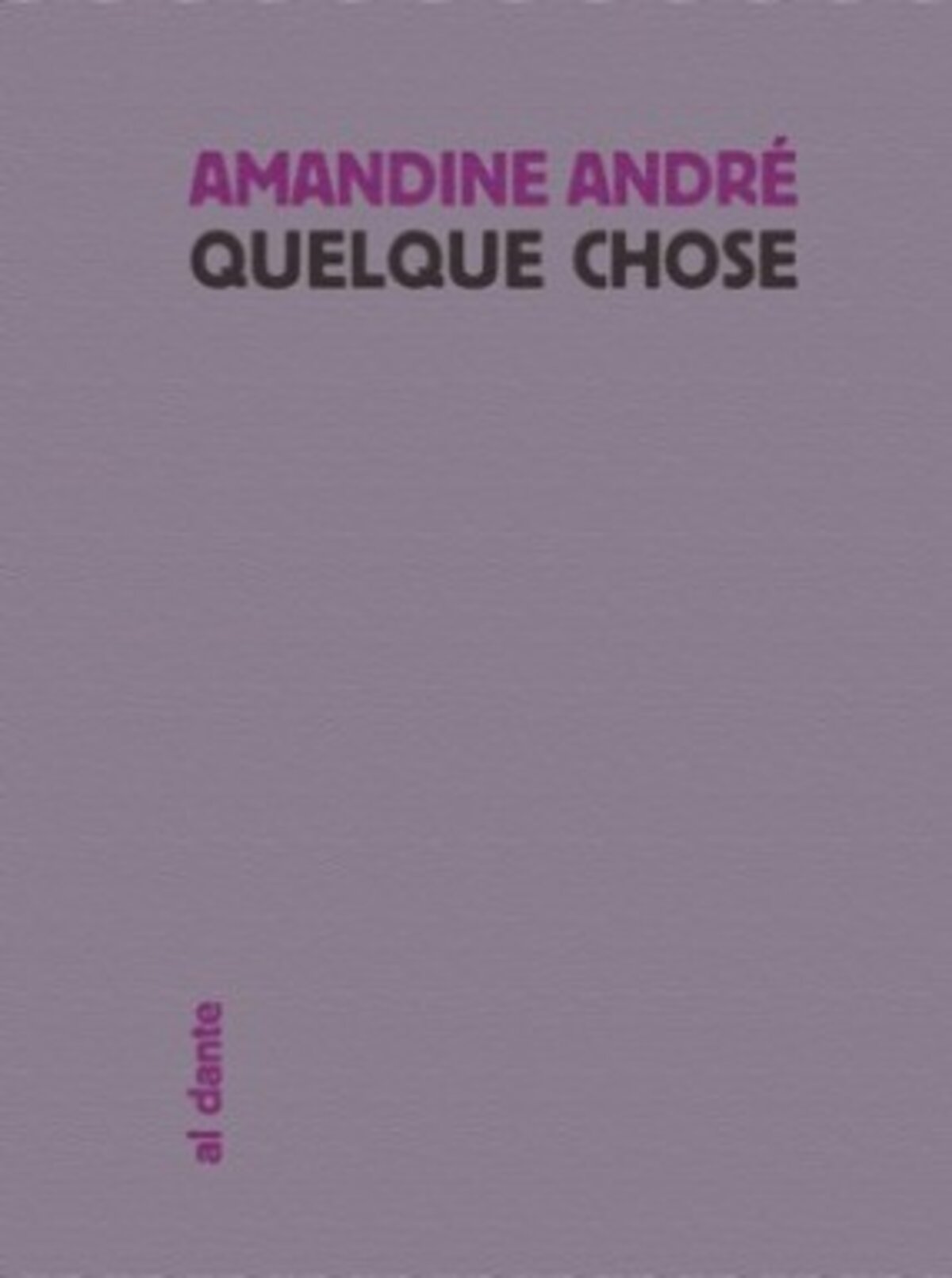
Quelque chose, d’Amandine André, est une histoire de corps, ou plutôt de corps et d’écriture. Ce livre ne parle pas du corps, à propos du corps, mais est un livre dans lequel ce qui arrive aux corps leur advient dans et par l’écriture. Ecrire le corps – et non en parler, écrire sur le corps – produit cette écriture au plus près de ce qui dans le corps échappe au corps et relève des devenirs qui l’affectent. Ainsi, cette écriture n’est pas celle d’un récit mais est poétique, poésie.
Il y aurait deux manières dont un livre peut se rapporter au corps. Une qui consiste à parler du corps, à écrire à propos du corps, à le prendre comme objet selon un point de vue surplombant faisant du corps une matière descriptible, énonçable, jugeable – point de vue du corps organique, actif, manipulable, qui est aussi le point de vue moral, celui du pouvoir. Une autre manière consiste à écrire avec le corps, à même le corps, selon des dynamismes, des souffles qui arrivent au corps mais qui ne sont pas du corps – une écriture comme une danse, puisque les mouvements des danseurs sont moins ceux du corps que ce qui arrive au corps sans être pourtant corporel. C’est cette seconde manière qui est celle d’Amandine André, celle d’une poésie et non du récit, d’une écriture qui est expérimentation d’un sensible non organique, une écriture qui est indissociable de l’altérité du corps – le corps comme altérité –, qui en suit les intensités, la plasticité étrange, les forces qui contraignent à l’invention d’une langue.
Quelque chose advient aux corps – donc à la langue –, aux deux corps dont il est question dans Quelque chose. Ces corps ne sont jamais précisés, identifiés : de qui sont-ils le corps, qui sont-ils ? L’indétermination présente dès le titre traverse l’ensemble du texte dont elle est la logique. Ce « quelque chose » n’est pas rien, mais à la différence de ce qui existe, « quelque chose » n’est pas défini – un existant à peine existant, insistant dans son indétermination : « Il y a quelque chose dans ton corps dans ton corps quelque chose il y a quelque chose dans ton corps que mon corps que ton corps et mon corps quelque chose ». Cette indétermination se retrouve à tous les niveaux du texte, qu’il s’agisse des corps dont on ne connaît précisément ni l’identité ni le sexe, ou qu’il s’agisse de ce qui arrive – rien n’est explicité, expliqué, reconnaissable. Le style lui-même se passe de ponctuation (sauf un point final), laissant indéfinies la grammaire et la syntaxe. Ce n’est pas seulement ce qui advient aux corps et entre les corps qui est indéfini, c’est l’ensemble du livre qui devient « quelque chose », pris dans une autre dimension du corps et de la langue, dans d’autres compositions des corps et de la langue, un processus d’anonymat, d’irrésolution – le processus du devenir. Il y a un « il y a », et l’on ne sait pas ce que c’est, car cela n’est pas mais s’impose comme un signe étranger, énigmatique, qui se diffracte à travers les corps, la langue, la pensée, le monde (« quelque chose que je cherche que je ne pensais pas chercher que je trouve pourtant »). Et cet « il y a » est aussi ce livre lui-même.

Agrandissement : Illustration 2

Quelque chose ouvre au monde du « quelque chose », monde du devenir, de l’écriture poétique. Dans ce livre, l’écriture ne dit pas ce qui est, elle extrait de ce qui est les devenirs, elle est elle-même cette extraction. Elle est un devenir du corps, comme le corps est un devenir de la langue, de l’écriture. Qu’est-ce que la langue lorsqu’elle est prise dans un devenir avec le corps, qu’elle se fait danse ou relation charnelle, relation sexuelle par-delà la sexualité organique, dans une relation au corps sans pouvoir, sans jugement, sans cadre a priori ? Elle advient comme événement d’une étrangeté, expérimentation de sensations insituables, lieu flottant d’une différence par laquelle le corps n’est plus le corps, la langue est poésie, donc autre chose qu’une langue – une vie, qui échappe à la langue autant qu’à l’organisme, et qui, par l’écriture, insiste, souveraine, dans son anonymat, son chaos, son silence. La beauté du livre d’Amandine André réside dans ce qu’il se tient au plus près de cette vie violente, nouvelle, étrangère, au plus près d’une immanence sans laquelle il n’y a pas d’écriture ni de vie.
Quelque chose dit la fascination pour les devenirs des corps et les effets incorporels de ces devenirs. Il y est question de deux corps, ou qui semblent être deux, peut-être plus. Ou, peut-être, un seul. Ou tout cela à la fois, ou successivement… Quelque chose advient entre ces corps, quelque chose devient, est le devenir même. Par ce devenir, les corps se mélangent, leurs frontières se déplacent, réciproquement poreuses, jusqu’à presque se brouiller et se confondre pour former un inconnu irréductible : « quelque chose qui n’est plus toi quelque chose qui n’est plus moi de ton corps à mon corps quelque chose qui n’est pas nous qui ne nous ressemble pas (…) quelque chose qui n’est plus ni toi ni moi ». Par le devenir, le corps s’élargit, se défait, devient sans cesse autre chose qu’un corps, un ensemble d’effets incorporels : être ouvert, s’ouvrir, être défait, remonté, élargi, étiré, plié, augmenté, etc. Si l’on peut lire ce vocabulaire comme la traduction dans la langue de mouvements érotiques et sexuels, il faudrait aussi les lire comme l’expression de forces et d’effets impliqués par le devenir, comme l’événement de sensations qui, comme dans un tableau de Francis Bacon, imposent aux corps – autant qu’à la langue – des postures qui les débordent, des intensités qui ne sont pas du corps bien qu’elles y aient leur lieu. Si le livre d’Amandine André est fortement sexuel, c’est à condition que le rapport sexuel ne soit pas organique mais atteigne au degré où, comme chez Bataille, la sexualité ouvre ce monde de forces, où elle est l’occasion d’une pensée et de corps par-delà la pensée et le corps – monde de la vie anorganique du devenir, qui est la mort aussi bien, mais une mort par-delà la mort, une mort qui est aussi la vie.
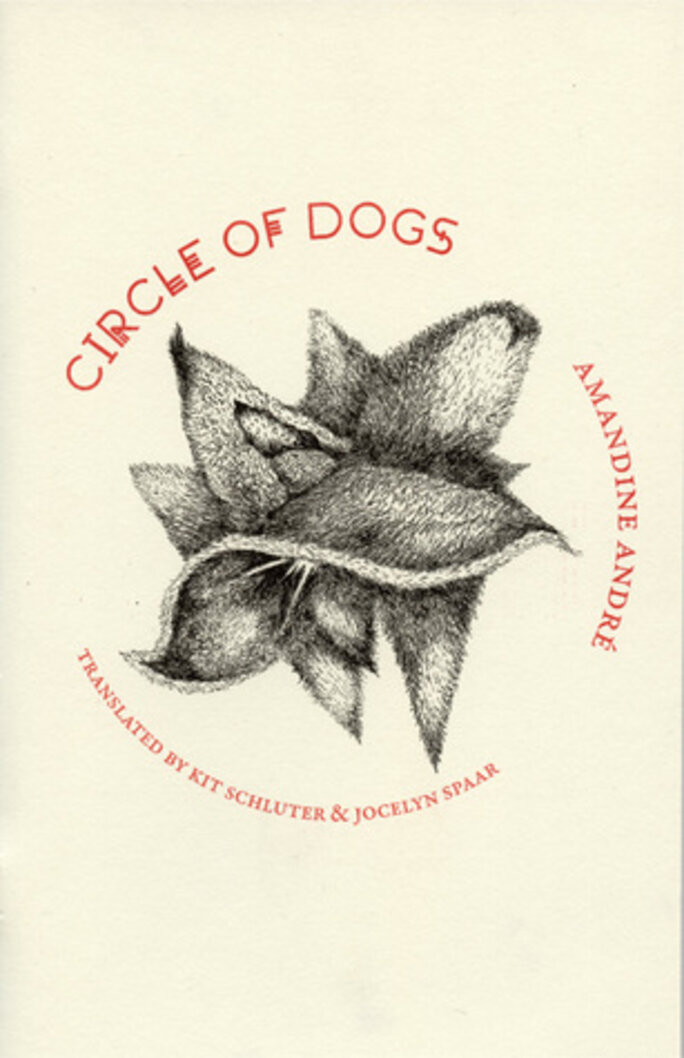
L’identité disparaît et n’a plus d’importance. L’identité est ce qui bloque les devenirs, les réduit à des états de choses fixes, immuables, codés : ceux du pouvoir. Peut-être les deux corps du texte sont-ils ceux d’un homme et d’une femme, ou ceux de deux hommes, ou peut-être encore l’un et l’autre, l’un ou l’autre en même temps, ou alternativement. Ou encore autre chose d’inassignable et inconnu. Peut-être que, dans le texte, n’existe qu’un seul narrateur, ou peut-être deux, alternant sans distinction, se mêlant l’un à l’autre, superposés, impliqués comme dans l’amour lorsqu’il atteint le plan où les coordonnées habituelles du genre, du sexe, des corps, des mots, voient leurs lignes brouillées, recomposées selon d’autres figures indéterminées et multiples. Ce qui dans le livre importe est que les deux deviennent indistincts, échangent leurs définitions, que le ou bien soit aussi un et : « ton corps d’homme a quelque chose en toi quelque chose que je ne connais pas du corps ton corps a quelque chose qui me serre quand tu bandes a quelque chose cependant que je prends l’homme en toi a quelque chose de tes bras de tes jambes de ta nuque quelque chose qui fait que je bande pour tes bras ta nuque ta mâchoire ». Ce n’est pas que ces deux corps soient les mêmes, c’est que pris dans un devenir commun – une communauté de différences –, ils existent dans une indifférenciation, une zone de voisinage comme l’écrit Deleuze, où en même temps ils sont et ne sont pas eux-mêmes et l’autre. Etre n’a plus de sens, pas plus que ne pas être. Persistent et règnent seulement le devenir incessant, les non identités paradoxales, les processus chaotiques d’une vie indéfinie, hybride, sans cesse mobile.
La poésie de Quelque chose est celle d’un mobilisme généralisé – contre les normes rigides, les dichotomies évidentes, le pouvoir des identités et des frontières fixes. Que signifie que son corps pénètre un autre corps ? Que signifie que son corps soit pénétré par un autre corps, ou plusieurs ? Le regard sur la sexualité est d’habitude pornographique, alors que le rapport sexuel n’est pas pornographique, il est charnel autant qu’intensif, philosophique et poétique : il est désir pour le monde d’une pensée et d’un corps vivants. C’est ce qu’Amandine André écrit ici, la langue de ce désir, l’écriture dépliant ce désir, en suivant les variables, les degrés, la logique folle et belle. Ce qui signifie aussi que si la poésie existe là où on ne l’attendrait pas, elle est d’autant plus surprenante qu’elle est en elle-même une politique, résistance au pouvoir, invention d’une vie.
Amandine André, Quelque chose, éditions Al Dante, 2015, 31 pages, 7 €.
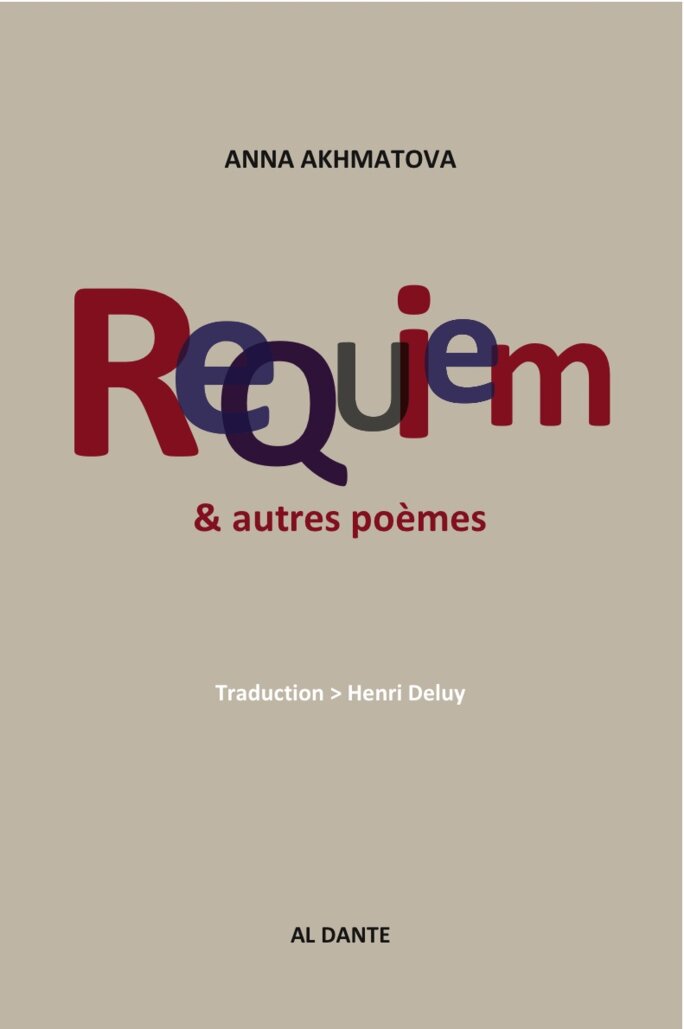
Agrandissement : Illustration 4
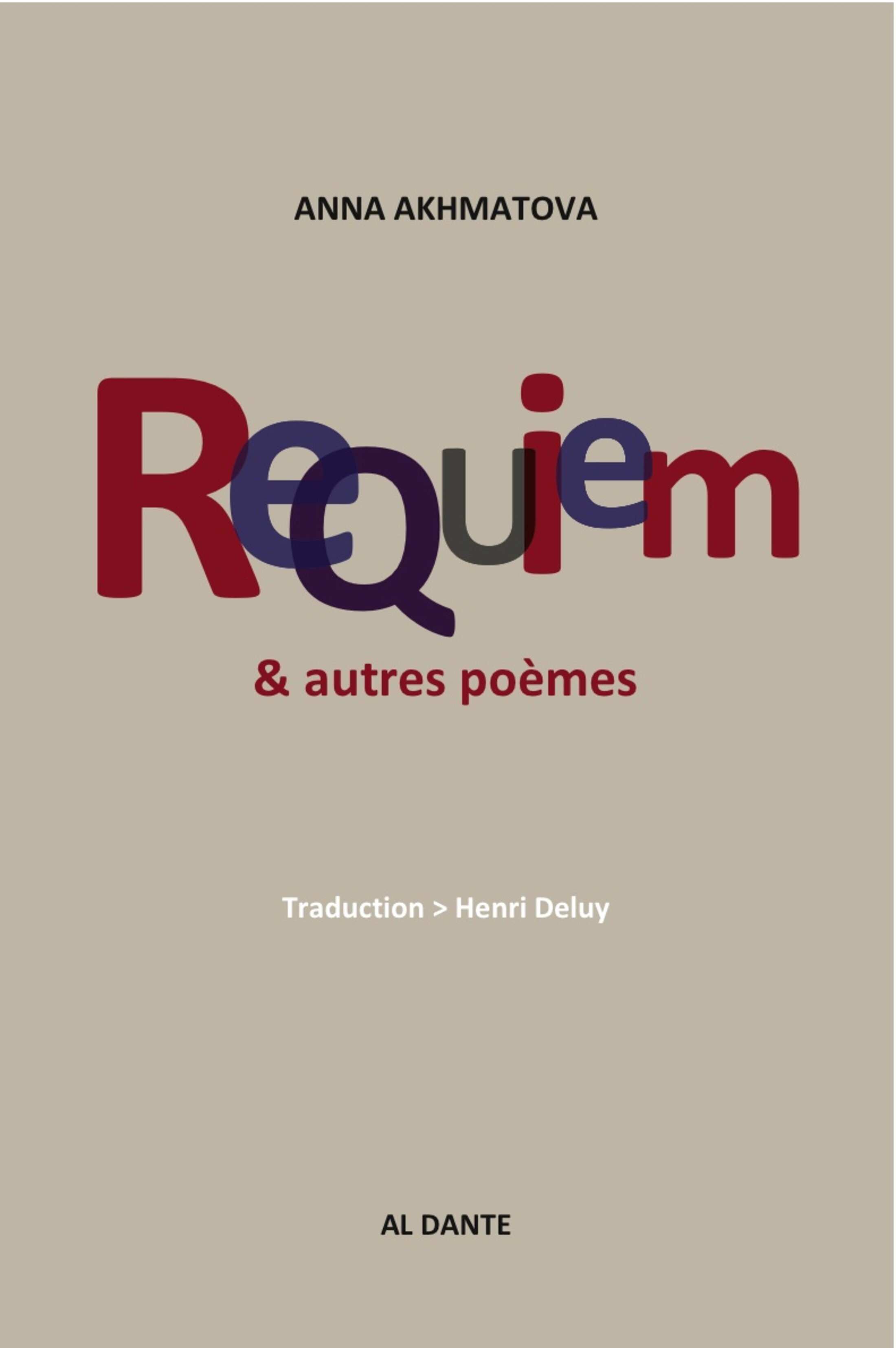
Signalons qu'en même temps que ce livre d'Amandine André, les éditions Al Dante publient une nouvelle version de l'anthologie Le Requiem et autres poèmes choisis, consacrée par Henri Deluy à la grande poétesse russe Anna Akhmatova (212 pages, 17 €)



