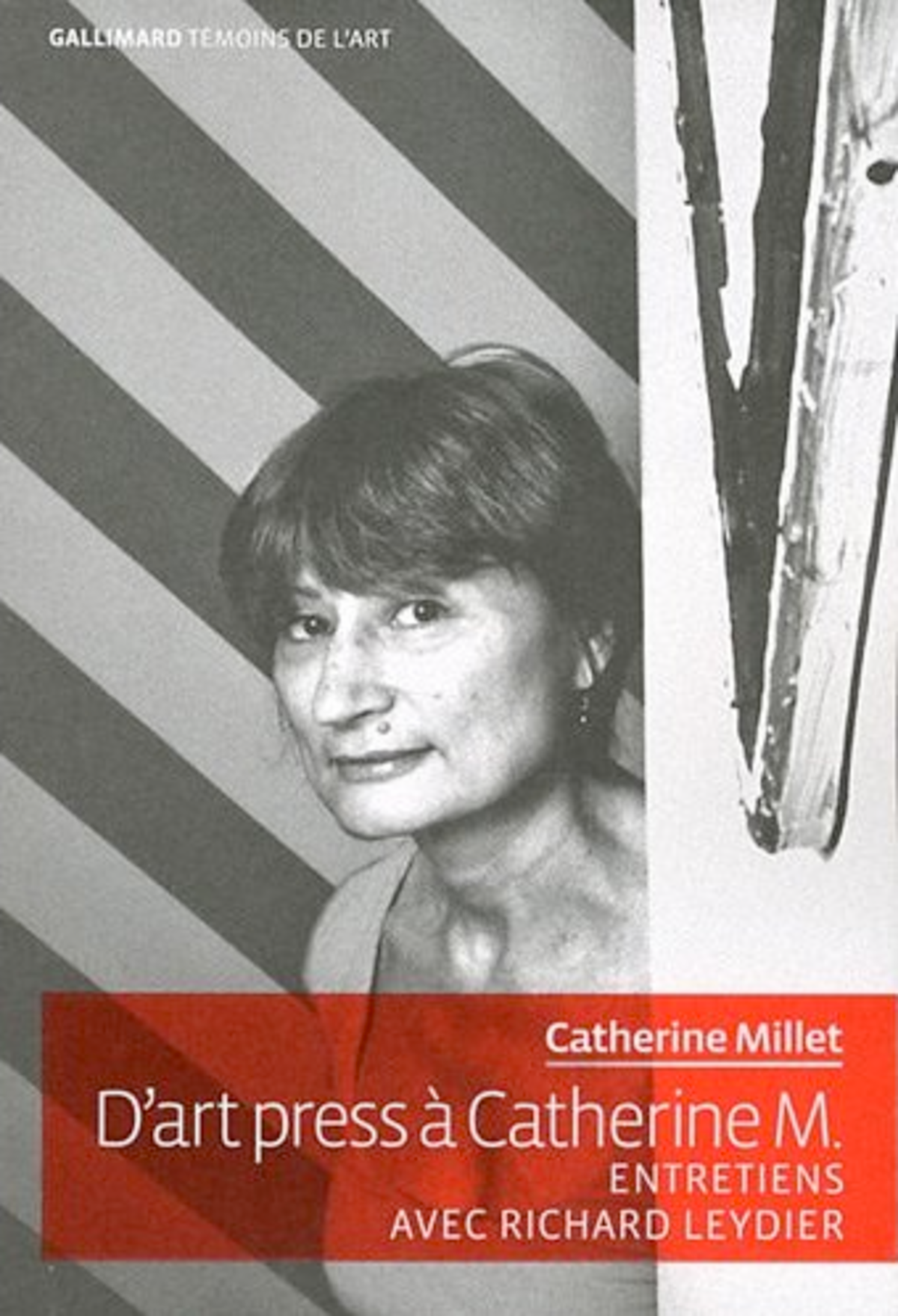
En 2001 et par après, La Vie sexuelle de Catherine M. s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires de par le monde. Succès médusant du récit que fait une femme «identifiable» de son existence libérée et débridée. Beaucoup qui achetèrent alors le volume ignoraient que Catherine Millet était la fondatrice et directrice d'art press –selon la graphie reçue–, une revue qui depuis Paris joua un rôle déterminant dans la réception internationale de l'art le plus contemporain.
Aujourd'hui, dans un livre alerte, Catherine Millet s'entretient avec Richard Leydier de l'aventure de sa revue tout en revenant sur ses écrits critiques et «romanesques». Leydier conduit l'interview avec adresse et une certaine complaisance: il n'a pas été collaborateur de la revue pour rien. Reste que Catherine Millet répond bien et raconte bien, et qu'elle le fait avec une franchise sympathique qui emporte l'adhésion...
La partie la plus passionnante du volume est sans doute constituée des trois premiers «chapitres», où la narratrice relate ses débuts et les années héroïques d'art press. Millet, qui n'a pas fait d'études et provient d'une famille de petite bourgeoisie, débarque un beau jour à Saint-Germain-des-Prés avec son compagnon Daniel Templon. Ils sont jeunes et pas mal inconscients. Lui ne tarde pas à ouvrir une galerie de peinture, elle se faufile aux Lettres françaises où, sous la houlette de Georges Boudaille, elle donne de petits comptes rendus d'exposition. L'un comme l'autre multiplient ainsi les contacts avec le milieu de l'art vivant et y nouent d'utiles relations. Leur compétence est réduite mais ils osent. C'est que, comme le note Millet, le «désir de faire» l'emporte sur le savoir. Début 73, forts du crédit acquis, ils décident de fonder une revue et lui donnent le premier titre qui vient. Ce sera art press !
Heureux temps, où moyennant beaucoup de culot et un peu d'entregent, on pouvait ainsi s'installer au cœur même de la «capitale mondiale des arts». Il est vrai que ladite capitale était plutôt New York, où prospéraient l'abstraction et le pop'art. Qu'à cela ne tienne: Catherine pousse jusqu'à Manhattan et y jette un pont avec les courants européens. Mais il faut de l'argent pour animer une revue. Un collectionneur fortuné, Hubert Goldet, se joint au duo initial. Et il y faut aussi des collaborateurs. Une équipe se constitue et trouve, grâce à Jacques Henric (aujourd'hui compagnon de Millet), des renforts auprès de Tel quel, revue amie à vocation littéraire.
L'audience d'art press ne cesse ensuite de croître et tient à plusieurs choses: la tranquille détermination d'une Millet qui se dit pourtant rêveuse et contemplative; son sens du travail en équipe; sa capacité à se porter à la fine pointe des courants nouveaux; le choix fait par la revue d'aborder des thématiques provocantes débordant largement le domaine de l'art –pornographie, drogue ou religion; un sens rare enfin du «mouvement du siècle», qui voit Catherine se lier avec de glorieux aînés comme le sculpteur César ou l'écrivain Klossowski.
Tout cela nourrit un récit vivant que scandent de nombreuses photos sur lesquelles on voit passer tous ceux qui ont accompagné Millet au long de son périple et qui formaient ses «réseaux». Car les «Entretiens» sont aussi, qu'ils le veuillent ou non, une analyse en petites touches de l'institution artistique comme univers d'alliances et de cooptations internes où les arrangements entre initiés ont toute leur part.
Mais le fil rouge qui traverse le livre -comme il a traversé une vie- est sans conteste la sexualité. Le thème est récurrent dans l'aventure d'art press, d'où était banni tout esprit de censure. Il émane des figures amies évoquées, Klossowski ou Dufour, tous deux hantés par la représentation du corps de la femme, ou Salvador de Dali et ses rêveries masturbatrices.
Tôt dans l'ouvrage, la narratrice déclare que «s'engager pour l'art demande de s'exposer» (p. 28). Oui, Catherine Millet s'est beaucoup exposée et non sans courage. Elle s'est exposée dans toute sa pratique comme elle l'a fait dans La Vie sexuelle, livre de désir dont est ici rapportée l'histoire. C'est déjà là une raison substantielle de lire les présents «Entretiens».
Catherine Millet, D'art press à Catherine M. . Entretiens avec Richard Leydier, Paris, Gallimard, «Témoins de l'art», 2011. 22,50 €.



